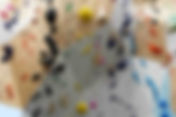FAIRE UNE RECHERCHE
1116 résultats trouvés avec une recherche vide
- Tanya Naville : « J'ai jamais su ouvrir une porte avec un coup de pied »
Directrice du festival Femmes en Montagne , Tanya Naville n’aime pas qu’on lui colle des étiquettes. Ni « militante », ni « féministe revendicatrice », elle préfère parler de récits, de symboles et d’humus collectif. Derrière son calme apparent, elle bouscule pourtant en profondeur un imaginaire montagnard longtemps bâti sur la conquête, la virilité et la performance. En programmant autrement, elle transforme ce que la montagne donne à voir – et à penser. Tanya Naville © Laurent Cousin Vertige Media : Programmer un film, c’est décider quel imaginaire de la montagne entre dans la mémoire collective. As-tu conscience que ce rôle, en tant que directrice du festival, est presque politique ? Tanya Naville : Mon objectif est avant tout de proposer d'autres récits, des nouveaux récits. Il y a vraiment cette volonté de sélectionner des choses qu'on ne verra pas ailleurs. On va avoir des films que tout le monde attend, et à côté de ça, ce que j'appelle des nouveaux récits – des films qu'on ne voit que chez nous et des sujets qu'on a envie de traiter. Parfois on est hyper contents de voir certains sujets abordés qu'on n'aurait pas pensé pouvoir traiter si vite. Je pense par exemple au film Fragments choisis d'Alicia Cenci, sorti il y a deux ans, sur un coming-out dans le monde du freeride . Ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de compléter l'imaginaire collectif de la montagne. D'éviter de retrouver les mêmes choses, d'apporter d'autres perspectives et d'élargir l'imaginaire de la montagne pour les gens. Vertige Media : Tu ne revendiques donc pas de dimension politique dans ta programmation ? Tanya Naville : Ma problématique, c'est que j'ai bossé en politique comme technicienne – les techniciens proposent, les élus disposent. Du coup, j'ai un petit côté langue de bois là-dessus. Je considère que c'est à chacun de faire sa conscience politique et que moi, je vais plutôt proposer le terreau, l'humus qui va leur permettre de créer eux-mêmes leur vision politique. La volonté depuis le début du festival, ça a toujours été d'inspirer, de ne jamais braquer les gens. Dans chaque projection, on ne va jamais faire une séance avec que des sujets hyper touchy , hyper politiques, ni une séance feel good avec que des films grand public. L'objectif, c'est de les saupoudrer partout pour sensibiliser un public qui ne serait pas venu sur des sujets plus sensibles, mais aussi d'inspirer tout le monde à progresser dans sa représentation. Vertige Media : Tu dis que les films réalisés par des femmes « font voir autrement ». De quoi parle-t-on concrètement ? Tanya Naville : Je pense que le genre – et pas le sexe – est construit sociétalement. Il y a eu dans l'éducation, dans l'évolution de la société, des différences qui font que forcément, les créations d'un genre ou de l'autre vont être un peu différentes. Je parle en général bien sûr – toutes les femmes ne pensent pas de la même façon, tous les hommes non plus. Mais il y a quand même un biais de genre dans le sens où on n'a pas vécu les mêmes choses. Beaucoup de personnes se disent qu'elles n'avaient pas conscience d'avoir un genre jusqu'à être confrontées à quelque chose. C'est souvent là qu'il y a cette prise de conscience : « Moi, j'avais l'impression d'être moi-même et pas une femme ou un homme, et d'un coup, bam, j'ai pris des rappels que j'étais une femme ». « Personne ne peut dire que ces films n'existent pas – même nous, on refuse des films ! » On part de deux univers complètement masculins. Le monde de la montagne est très, très masculin. Le monde du cinéma et du film l'est aussi dans sa réalisation. Le combo des deux est encore plus masculin. Donc les femmes qui arrivent à réaliser ont dépassé plusieurs choses : le syndrome de l'imposteur qu'on voit beaucoup plus chez le genre féminin, le fait de s'imposer dans deux milieux masculins, et elles ont osé proposer un message. Forcément, le traitement est différent, soit parce qu'elles ont su faire leur place pour qu'on leur fasse confiance, soit parce qu'elles ont ouvert des portes – en les ouvrant petit à petit ou en donnant des coups de pied dedans. L'histoire qu'elles racontent est différente parce que le chemin n'est pas le même. Vertige Media : Le cinéma de montagne s'est longtemps nourri du mythe de l'exploit solitaire, du sommet conquis. Les récits féminins inventent-ils d'autres mythologies ? Tanya Naville : Je pense que dans un premier temps, tu es obligée. Si tu regardes toute la littérature autour de la conquête des sommets, ils conquièrent une montagne comme ils conquièrent une femme. Tu sais, ils « déflorent » le sommet. Tu as tout ce vocabulaire de conquête de l'homme, ce côté amoureux. Donc forcément, en tant que femme, il fallait s'approprier un autre moyen d'en parler. Il y a un imaginaire collectif qui fait que l'explorateur est plus souvent « explorateur » qu'« exploratrice ». Svana Bjarnason et Tanya Naville lors de l'édition 2024 de Femmes en Montagne © Delphine Danielou Et on voit qu'en réalité, les femmes qui traitent de montagne ne se contentent pas du simple compte-rendu d'exploit. Elles se disent : « Pour une fois, j'ai une voix au chapitre, j'ai une opportunité ». Au lieu de ne traiter que de cet exploit, elles vont rajouter des sujets. On pense au film de Svana Bjarnason ( Climbing from the Ashes , ndlr ) l'année dernière, où elle parle aussi de son avortement, tandis qu'un homme aurait juste dit : « J'ai eu un souci personnel ». Les femmes profitent de ce moment pour sensibiliser d'autres femmes, montrer comment ça fonctionne, saisir cette opportunité. On voit des films qui vont plus loin, qui ont des discours plus universalistes. Quand une grimpeuse voit un film où une femme doute, échoue, réussit autrement, c'est une permission de se projeter. Vertige Media : Ton festival agit presque comme une fabrique de permissions symboliques, non ? Tanya Naville : Je me souviens d'une projection où un homme a levé la main et a dit : « Moi, je viens à votre festival chaque année. Merci de me proposer une autre vision de la montagne. En tant qu'homme, j'en ai marre de voir la montagne que par la performance. Pour moi, la montagne, ce n'est pas que ça. Parfois j'aime être performant, parfois j'aime profiter, avoir des partages ». Ça m'a fait hyper plaisir que ce soit un homme qui le dise. « Nous, on essaie de faire changer les choses comme le sachet de thé dans l'eau : en infusant, au bout d'un moment, ça change la couleur » C'est cette permission-là : montrer qu'en montagne, tu as le droit d'être leader, tu as le droit d'être second, tu as le droit de douter, tu as le droit de réussir, et que ce n'est pas le genre qui fait le pratiquant. Quand je m'occupais des groupes d'alpinisme féminin, des hommes m'ont dit : « Merci de parler de la familiarité de cordée, parce que ça permet aussi aux hommes de se dire qu'ils ont le droit d'être seconds ». Inconsciemment, à niveaux égaux, l'homme va se sentir obligé de se mettre devant. Montrer que la femme peut être devant permet à l'homme d'oser aussi douter, d'accepter d'être second sans ce côté « homme invincible ». Vertige Media : Ces permissions s'adressent donc autant aux femmes qu'aux hommes ? Tanya Naville : Exactement. Tu ne peux pas dire toi-même que c'est une safe place , mais quand quelqu'un te le dit, tu l'enregistres fort. Ce retour m'a fait comprendre que notre festival peut être perçu comme ça par le public masculin aussi. Vertige Media : Femmes en Montagne est aujourd’hui plus qu’un festival : vous avez des ateliers, une plateforme VOD, une approche inclusive. Les récits minorisés doivent-ils créer leurs propres structures pour survivre ? Tanya Naville : En fait, je me suis toujours dit qu'un jour, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'exister, et ce sera génial ! C'est comme les assos féministes : si un jour elles n'ont plus besoin d'exister, elles seront hyper contentes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça progresse énormément. Public lors de l'édition 2024 de Femmes en Montagne © Delphine Danielou Maintenant, il y a une vraie mixité dans sa programmation. Les Rencontres du Cinéma de Montagne de Grenoble viennent vers nous pour qu'on les aide à avoir plus de films sur les femmes. Tous les grands festivals font maintenant des efforts pour plus de mixité. Nous, on est contents d'exister parce qu'on montre que c'est possible de faire une programmation intégrale là-dessus. Personne ne peut dire que ces films n'existent pas – même nous, on refuse des films ! Vertige Media : Comment trouves-tu l’équilibre entre exigences militantes et exigences artistiques ? Tanya Naville : On ne dit pas qu'on est militant. On n'est pas militant, on est engagé et inspirant. J'ai jamais su ouvrir une porte avec un coup de pied – il y en a qui savent très bien le faire, c'est parfait ! Nous, on essaie de faire changer les choses comme le sachet de thé dans l'eau : en infusant, au bout d'un moment, ça change la couleur. On a un super comité de sélection avec Marion Paquet qui a vraiment l'œil pour dire si c'est de qualité cinématographique. Il y a le choix du discours, puis Marion vérifie si le récit est bien construit, si l'image est bien, si le son est bien. Dans le choix final, je dois équilibrer entre performance, sujets, rythme. Si je ne mets que des films plombants, ce sera dur pour les gens de sortir. Si je ne mets que des films punchy sans message, on perd l'intérêt de Femmes en Montagne . Je saupoudre pour garder cette essence : mixer les pratiques, les sujets, le rythme. Vertige Media : Finalement, si les femmes écrivent et filment la montagne, n’est-ce pas moins une lutte féministe qu’un changement cosmologique – transformer notre manière d’habiter le monde ? Tanya Naville : Je pense que c'est plus ça. Notre importance, c'est d'amener le terreau qui permettra à chacun de faire germer les graines qu'il souhaite. Si tu mets toujours une terre acide, tu auras toujours le même type de graines qui pousse. Nous, on rajoute un peu de terre basique pour que ça fasse germer des plantes différentes. Après, on laisse chacun en faire ce qu'il veut. Certains vont dire : « Ç a me change ma manière de vivre, je vais réfléchir différemment ». D'autres vont juste dire : « C'était cool ». Nous, on donne le substrat et c'est aux autres de pousser dessus. C'est pareil avec les scolaires. Des jeunes filles nous disent : « Grâce à vous, maintenant je vais faire un métier dans le monde de la montagne », alors qu'elles n'y pensaient pas avant. C'est ça qu'on veut. Le festival Femmes en Montagne reviendra du 13 au 16 novembre 2025 pour une nouvelle édition à Annecy. Une invitation à voir, écouter et penser autrement la montagne – à travers les récits de celles et ceux qui la vivent au pluriel. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du festival .
- « Les Grips » : vers une édition parisienne ?
Des stories publiées ce week-end sur le compte officiel des « Grips » ont ravivé l’hypothèse d’une édition parisienne. Contactée par Vertige Media , l'organisatrice de l'évènement Morgane Morel indique ne pas vouloir faire de communication pour l’instant. Mais tout laisse penser que l'évènement hors-normes organisé à Montbéliard en 2024 revienne pour une seconde édition dans la capitale. Avec ses stars, ses ambitions scéniques, ses enjeux de remplissage... et un prize money qui reste inconnu. Naïlé Meignan lors des Grips 2024 à Montbéliard © David Pillet Post-JO, la grimpe a changé d’échelle : projecteurs, écriture scénique, bande-son... La compétition d'escalade cesse désormais d’être un simple protocole sportif pour devenir un récit qui parle au-delà du cercle des initié·e·s. Les « Grips » s’inscrivent dans ce déplacement : faire du bloc un spectacle, non pas en l’édulcorant, mais en le mettant en scène dans des arénas capables d’absorber l’énergie (et la sono). À Montbéliard, l’Axone avec sa capacité de 6400 places a servi de laboratoire. Paris serait la suite logique. Pour l’heure, le signal vient d’Instagram. Côté organisation, silence méthodique. Les stories du week-end disent une chose simple : le projet bouge. Nous avons donc contacté l'organisatrice de l'évènement, Morgane Morel. Réponse sobre, de convenance : rien à communiquer pour l’instant. Pas de date, pas de salle, pas de format officialisé — ce qui n’empêche pas d’examiner ce que l’édition 2024 a mis sur la table, et ce qu’elle a laissé en suspens. Montbéliard 2024, laboratoire à ciel ouvert Les 14–15 décembre 2024, l’Axone — grande aréna modulable — s’est muée en arène de grimpe pour 40 athlètes internationaux. Le parti pris était clair : casser les codes de la compèt’ classique, étirer l’attention par la lumière et le son, composer des finales lisibles pour un public large sans abaisser l’exigence technique. Le line-up , lui, affichait du lourd : Tomoa Narasaki, Naïlé Meignan, Miho Nonaka, Yoshiyuki Ogata, Hannah Meul, Erin McNeice, Toby Roberts, Mejdi Schalck, Paul Jenft, Sam & Zélia Avezou, Camilla Moroni, Meichi Narasaki, Sohta Amagasa, Ievgeniia Kazbekova, etc. — autrement dit, la crème des grimpeur·ses pro . Même gratin chez les ouvreurs puisque « Les Grips » a également rassemblé l'équipe olympique : Pierre Broyer (lead), Rémi Samyn, Gen Hirashima, Manuel Hassler signent 16 blocs pensés pour bousculer le très haut niveau, pendant que Vandal X, Ugo et AASH tenaient la trame sonore. À Montbéliard, l’Axone — une aréna modulable à 6 400 places en configuration concert et 4 500 en sport — magnifie l’ambition… tout en mettant à nu la réalité du difficile remplissage. De l'argent et des questions Sur le papier, l’équation semblait gagnante. Dans les faits, les signaux de remplissage sont plus compliqués : à J-15, la salle rouvre 500 invitations pour le samedi et 500 pour le dimanche en parallèle de la billetterie , histoire de remettre la jauge dans le vert. Sur place, plusieurs personnes présentes relatent une annonce au micro invitant le public à faire venir des ami·e·s gratuitement — de quoi dérouter celles et ceux qui avaient payé leur place. Côté finances, aucun chiffre officiel n’a été communiqué sur le prize money ( somme d'argent pour les participant·e·s à la compétition, ndlr ) — une exception, plus qu’une habitude, dans le petit monde de l'escalade sportive, où les dotations sont généralement annoncées. Dans la communauté, en off, des montants élevés ont circulé. S’ils se confirmaient, cela aiderait à comprendre la densité et la qualité du plateau d'athlètes en lice. Faute de données vérifiables, on en reste à cet indice contextuel — utile pour éclairer l’attraction, insuffisant pour parler de transparence. Si Paris se confirme, « Les Grips » emprunteraient une trajectoire déjà éprouvée par le Salon de l’Escalade : après des étapes à Grenoble puis Lyon, le passage à Paris a validé l’évidence du bassin de public, de l’exposition et du maillage partenaires. À l’échelle d’une aréna, c’est un levier décisif : la densité de pratiquant·e·s en Île-de-France, la concentration de salles et de clubs, le flux étudiant et cadres — autant de facteurs qui peuvent résoudre la variable du remplissage. Reste à tenir l’équation spectacle : récit lisible, niveau sportif assumé, et conversion de l’attention en public payant. Montbéliard a donné la grammaire, Paris pourrait en fournir la démonstration.
- En Espagne, l'escalade dangereuse des modèles de gestion externalisée
À Vitoria-Gasteiz, capitale du Pays basque espagnol, les salarié·es qui gèrent les murs d’escalade municipaux dénoncent des salaires impayés, du matériel de sécurité défectueux, un manque de formation, et même un accident grave. Un signal d’alarme sur les dérives d’un modèle de gestion externalisée qui touche, parfois discrètement, bien au-delà des frontières basques. © Ryunosuke Kikuno Les rocódromos municipaux — autrement dit, les salles d’escalade publiques — ne sont plus seulement des lieux de loisir, mais le reflet d’une tension sociale plus profonde. Dans cette ville réputée pour sa politique sociale et environnementale, la grimpe devient un terrain où se jouent d’autres équilibres : ceux entre coût et sécurité, entre délégation et responsabilité. Derrière les baudriers et les prises multicolores, un modèle s’essouffle : celui d’un service public confié à des prestataires privés au nom de l’efficacité, mais qui, trop souvent, finit par user les cordes… et les gens. Trois murs et un contrat Dans les centres civiques d’Ariznabarra, d’Hegoalde et de Salburua, les grimpeur·euses de Vitoria se retrouvent chaque semaine dans les salles d’escalade municipales, ces rocódromos où l’on vient aussi bien s’initier qu’entretenir ses callosités. Des structures publiques, populaires, que la Ville a choisi de confier à une société privée : Prismaglobal. En juin 2024, l’entreprise a décroché le marché de la gestion intégrale pour deux ans — encadrement, maintenance, sécurité, nettoyage, ouverture des voies — pour un montant de 751 410 € TTC . Un seul candidat s’était présenté à l’appel d’offres. Le contrat promettait davantage de services : 158 heures supplémentaires de présence saisonnière et 74 heures d’ouverture de voies en plus, afin de « répondre à la demande croissante des usager·ères », précisait la municipalité dans son communiqué officiel . Mais à peine un an plus tard, la promesse d’efficacité s’est muée en réquisitoire. « Salaires impayés, EPI défectueux, accident passé sous silence » Le 7 octobre 2025, le média local GasteizBerri publie un communiqué signé par les salarié·es : ils y dénoncent le non-paiement des salaires d’août et de septembre, après des retards déjà chroniques l’année précédente — « jusqu’à sept mois de décalage », écrivent-ils. Dans le même texte, les employé·es évoquent l’absence d’équipements de protection individuels adaptés, des harnais non révisés et un manque de formation pour des tâches pourtant à risque : travaux en hauteur, nettoyage à l’acide, manipulation de cordes. Un épisode concentre leur colère : la chute d’un collègue d'environ 8 mètres, survenue il y a plusieurs semaines. Selon eux, aucune mesure corrective n’a suivi. Ni enquête interne, ni communication, ni protocole de sécurité mis à jour. « Les cordes usées ont été retirées, mais pas remplacées », ajoutent-ils. Résultat : certaines voies sont fermées, d’autres maintenues malgré des conditions discutables. L’affaire, reprise le lendemain par Gasteiz Hoy , évoque un « service public fragilisé, au détriment de la sécurité et du respect des travailleurs ». Une dérive structurelle Le malaise n’est pas nouveau. Avant Prismaglobal, la gestion était assurée par Disport Eki , déjà visée par des grèves pour impayés et conditions précaires. Les salarié·es parlent d’un « cycle sans fin » : des contrats publics toujours attribués sur le critère économique, sans contrôle réel des conditions d’exécution. La Ville change de prestataire, mais les problèmes restent — parfois aggravés par la pression sur les coûts. Le modèle espagnol des délégations sportives fonctionnent souvent sur le même schéma : externaliser pour « optimiser ». Résultat : les salarié·es passent d’un·e employeur·euse à l’autre, les responsabilités se diluent, les salaires stagnent et la sécurité s’érode. Et dans les salles, ce sont les mêmes visages qui continuent d’accueillir le public, mais avec des gants percés et des cordes à moitié révisées. La loi, pourtant, ne laisse aucune marge. Les textes espagnols sont clairs : le Real Decreto 773/1997 impose à tout·e employeur·euse de fournir, entretenir et vérifier les équipements de protection individuelle le RD 2177/2004 encadre strictement les travaux temporaires en hauteur, avec obligation d’un double système de sécurité et le RD 374/2001 oblige les entreprises à former et protéger leurs employé·es contre les agents chimiques, notamment les acides utilisés pour le nettoyage des prises. Ces obligations ne s’arrêtent pas à la porte d’une salle d’escalade. Leur non-respect engage la responsabilité directe de l’entreprise — et, par extension, celle de la collectivité qui en est la donneuse d’ordre. Pourtant, face à ces manquements présumés, la réaction institutionnelle se fait attendre. Une affaire locale, un symptôme global Sollicitée par les médias locaux, la Ville de Vitoria-Gasteiz n’a, à ce jour, publié aucun communiqué. Aucune mention d’audit, d’inspection ou de pénalités. Même silence du côté de Prismaglobal, dont le siège se trouve dans la ville. Le service municipal des Sports dispose pourtant, selon le cahier des charges, de leviers clairs : astreintes financières, suspension du contrat, voire reprise temporaire du service. Mais rien n’indique qu’ils aient été activés. Derrière l’image d’un sport « sain » et « propre », il y a des technicien·nes qui manipulent des acides, des ouvreur·euses perché·es à dix mètres du sol, des agent·es sous contrat précaire qui entretiennent les cordes pour que d’autres puissent grimper en confiance. Quand ce travail invisible craque, c’est tout l’édifice symbolique qui tremble. L’histoire de Vitoria-Gasteiz est celle d’un glissement silencieux : celle d’un service public qui délègue sans surveiller, d’un sport devenu vitrine économique, et d’un secteur où la sécurité dépend souvent du dévouement individuel plus que du cadre collectif.
- La bourde d'Arkose : « On admet un immense dérapage »
Une publication polémique sur l'escalade « à vue » impliquant une référence sexiste et malheureuse a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Supprimé après une heure en ligne, le post a ému une partie de la communauté des grimpeur·ses qui s'interrogent sur la cohérence entre les valeurs d'inclusion affichées par le géant français de l'escalade et sa communication. Alors, sale chute ou simple zipette ? (cc) Stacie Ong / Unsplash Le jeudi 9 octobre 2025 en fin d'après-midi, Arkose Climbing publiait un mea culpa en story Instagram. « On a fait une erreur et on tient à la reconnaître. Ce n'est ni ce que nous sommes, ni ce que nous voulons défendre chez Arkose », pouvait-on lire sans faire référence à une situation précise. Cette excuse publique fait suite à une publication polémique, rapidement supprimée après avoir suscité l'indignation de la communauté. « De l'instinct et des couilles » Selon nos informations et la capture d'écran du post, la publication initiale prétendait définir l'escalade « à vue » - une technique consistant à réussir une voie du premier coup sans information préalable - en évoquant la nécessité d'avoir « de l'instinct et des c **** ». Une formulation qui a immédiatement choqué les abonné·e·s d'Arkose, habitué ·e·s à des messages plus inclusifs de la part de l'enseigne. Les réactions n'ont pas tardé mais plus troublant encore pour la communauté, le community management de la marque semblait effectuer une modération systématique des commentaires critiques. Certains utilisateur·rices, comme Climbing Yoshi , interpellent directement l'enseigne : « Si vous avez de 'l'instinct et des C***' il faut assumer votre dérapage d'hier pour sauver votre communication ». Acteur majeur de l'escalade en France et en Europe, Arkose a pourtant maintes fois affiché des valeurs de diversité et d'inclusion. La semaine dernière, l'enseigne hébergeait notamment dans une de ses salles à Nanterre, une partie du festival Grimpeuses , un événement majeur dédié à l'escalade au féminin. Fondée en 2013 à Montreuil par quatre associés « animés par la même volonté : démocratiser l'escalade et l'art de vivre qui va avec », Arkose a franchi un cap symbolique en mars 2024 en devenant société à mission, formalisant ainsi ses engagements sociaux et environnementaux. Une communauté qui ne décolère pas Au-delà de la publication initiale, c'est la gestion de crise qui cristallise les critiques. Les commentaires négatifs continuent d'affluer sur des posts récents n'ayant aucun rapport avec la polémique. « Cette "erreur" comme vous dites en story publique, c'est beau mais ne pas la mentionner dans votre mea culpa , ce qu'est l'erreur en question, c'est ne pas assumer ce qui a été produit et vouloir cacher la poussière sous le tapis », mentionne un internaute. De toute évidence, la communauté de l'escalade, particulièrement sensible aux questions d'inclusion, ne se satisfait pas du mea culpa générique publié en story . Contactée par Vertige Media , la direction d'Arkose reconnaît « avoir pris conscience de cette erreur interne » tout en ne souhaitant pas rendre publics les détails des circonstances ayant mené à cette publication. L'entreprise invoque « la préservation de ses équipes et de ses prestataires externes » pour justifier son silence sur les modalités de ce qu’elle admet « complètement être un immense dérapage », mais assure « avoir pris les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus ». Selon nos informations, le post aurait été rédigé par un prestataire extérieur à l'entreprise mais a bel et bien été mis en ligne par ses équipes en interne. Cet épisode soulève des questions plus larges sur la responsabilité des acteurs dominants dans la promotion de valeurs inclusives. Qu'on le veuille ou non, Arkose et ses concurrents façonnent l'image de l'escalade moderne. Leur communication influence directement la perception du sport par le grand public et les nouveaux pratiquant·es. Dans un contexte dynamique, les leaders du secteur portent une responsabilité particulière dans la promotion d'une pratique. Et pour un secteur qui mise sur son ouverture et sa modernité, l'épisode est un rappel - s'il en fallait un - qu'une zipette peut aussi provoquer de grosses entorses.
- Aurélien Cirotte : les nouvelles voies du handicap
À 44 ans, Aurélien Cirotte ne grimpe pas seulement contre la gravité, mais avec tout un passé chirurgical cousu dans son corps. Son pied gauche raconte une histoire d’opérations et de plâtres, sa mémoire est hantée par la douleur, et pourtant, il parle d’esthétique, de spiritualité et d’invention de nouvelles pratiques. Portrait d’un grimpeur qui a fait de son handicap une manière singulière d’habiter le rocher et, plus largement, de lire la vie. Coll. Aurélien Cirotte Il y a des premiers souvenirs qui sentent la madeleine, d’autres la résine de sapin chauffée au soleil. Le premier souvenir d’Aurélien, lui, sent le désinfectant et le métal froid. « Je me souviens de la salle d’opération. On m’enlevait le plâtre. J’ai encore en tête la broche dans mon talon. » Difficile d’imaginer plus brutal comme entrée dans la vie. Et pourtant, c’est dans ce corps « bricolé », dans ce pied qui n’a jamais vraiment suivi le manuel, qu’il a construit son rapport au monde. « L’escalade m’a appris ce que je peux faire, et ce que je ne peux pas. » Entre lucidité et insoumission, il a tracé sa voie. Héritages montagnards Le décor initial est savoyard. Les Bauges, une famille « de montagne », un oncle accompagnateur, initiateur, directeur de colo, figure qui tenait autant du guide que du vieux sage du village. « J’ai découvert la montagne à travers lui. Le ski, la rando, l’escalade… mais aussi le four à pain qu’il avait remis en route ! », raconte Aurélien, mi-amusé, mi-nostalgique. Dans cet univers, tout semblait faire système : tailler une cuillère dans une branche, rallumer un four oublié, tracer une ligne dans une falaise. Trois façons différentes de dire la même chose : transformer la matière brute en possibilité. À six ans, il enfile son premier baudrier. La verticalité entre dans sa vie comme une évidence. « Tant que je pouvais l’encaisser, je me sentais vivant » Aurélien Cirotte Mais l’autre versant est moins idyllique. Celui des opérations, des plâtres, de la marche hésitante. Un pied que la médecine s’acharne à « corriger », comme on redresse une pièce tordue. Chaque cicatrice rappelle que son corps n’a jamais été livré clé en main. Entre 1987 et 1992, l’école primaire se vit en deux langues : celle des cabanes et des montagnes, et celle des hôpitaux et des salles d’attente. Puis vient l’adolescence. Le handball s’impose, refuge collectif, terrain de défouloir. L’esprit d’équipe, la chaleur des vestiaires, la sueur partagée : tout aurait pu coller. Mais les mots frappent parfois plus fort qu’un ballon. « On me renvoyait sans cesse à mon pied : si on gagnait, ça passait. Si on perdait, c’était de ma faute. » L’étiquette colle, lourde comme un scotch qu’on n’arrache jamais. La bascule est alors presque logique. « Par refus, ou par ras-le-bol des sports collectifs, j’ai choisi l’escalade. » Une pratique plus solitaire, certes, mais pas isolée. Le mur ne juge pas, il questionne. La contrainte ne condamne pas, elle devient moteur. La douleur comme compagne Il faut l’écouter pour comprendre : chez Aurélien, la douleur n’est pas une simple sensation, c’est un personnage. Une présence intime, presque une amante capricieuse, toujours là, jamais tout à fait invitée. « Tant que je pouvais l’encaisser, je me sentais vivant. » Il part grimper avec une canne planquée dans le sac, monte sur le mur comme on entre en résistance. La douleur devient repère, boussole tordue mais fiable. Jusqu’au jour où elle déborde, où encaisser ne suffit plus et où l’on se retrouve lessivé d’avoir trop voulu tenir. Alors l’hypnose s’invite dans sa vie, comme un interrupteur secret. « J’ai débranché la douleur. Aujourd’hui, je revis sans. Mais je ne veux pas oublier. Si ça revient, je veux être prêt. » Dans sa bouche, ce n’est pas une phrase spectaculaire mais un avertissement lucide. La douleur a été une épreuve formatrice, mais il n’en idéalise pas le retour. Elle n’est plus un moteur mais une cicatrice active : une mémoire en veille. Aurélien Cirotte © RemGoDrone Pendant ce temps, sur les tableurs des fédérations, rien. La douleur n’existe pas. « L’IFSC m’a répondu : la douleur, on ne sait pas la mesurer. Alors j’ai provoqué : "Je n’ai plus qu’à m’amputer, au moins ça sera mesurable". » Derrière la provocation, une évidence glaciale : l’institution n’a pas de case pour l’invisible, pas de place pour ce qui se vit mais ne se voit pas. Quand le corps invente une autre esthétique Pendant longtemps, Aurélien n’a pas vraiment grimpé avec deux jambes, mais avec une jambe et une ombre. La droite encaissait tout, la gauche se posait à peine, comme un figurant maladroit que l’on tolère sur scène mais qui n’a pas de texte. C’était son schéma corporel : un côté actif, l’autre en veille. Jusqu’au jour où la chiropraxie est venue fissurer ce script bien installé. « Pour la première fois, j’ai senti mes deux jambes en appui. Juste attendre un train et… découvrir un corps différent. » La scène est presque dérisoire : un quai, un train qui tarde, et soudain l’expérience intime d’un équilibre nouveau, une révélation muette. Depuis, sa jambe gauche reste singulière. Elle n’a jamais appris la grammaire classique du geste. Pas de pointe académique, pas de ligne tirée au cordeau. Toujours une carre interne, un pied qui rentre vers l’intérieur, un désaxement permanent. Mais ce défaut, parfois, devient une arme. « J’ai déjà profité de cette position particulière pour trouver des mouvements qu’un valide n’aurait pas imaginés. » Le corps contraint ouvre un imaginaire parallèle. « En tant que graphiste, je vois bien le message. Ce sont surtout les handicaps visibles qui passent. Ceux qui ont deux bras, deux jambes, restent dehors » Aurélien Cirotte Et c’est peut-être là que se loge l’essentiel : transformer une limite en vocabulaire. « On m’a dit : tu compenses tout, mais tu le rends. » Aurélien n’imite pas la technique, il la déforme, il la détourne. Ce qui pourrait passer pour une adaptation est en réalité une invention : une autre esthétique du mouvement, née dans l’interstice entre ce que la biomécanique exige et ce que son corps accepte de donner. L’injustice fondatrice La scène se déroule lors d’un stage d’initiateur falaise. Aurélien a tout coché : les manips, les relais, les consignes de sécurité, les aménagements gérés seul, sans chichi. Le jury salue le travail, valide le niveau, reconnaît la compétence. Puis le couperet tombe : refus. « On me dit : tu as réussi, mais tu ne peux pas l’avoir. C’était violent. » Le diplôme d’initiateur falaise lui est refusé, malgré la réussite du stage. Une phrase qui contient en elle toute l’absurdité : félicité et disqualifié dans le même souffle. « Voir Solenne Piret ou Thierry Delarue grimper, c’est porteur d’une image forte, incontestable. Moi, c’est plus subtil » Aurélien Cirotte L’explication est bureaucratique : pas de cadre légal pour certifier une personne en situation de handicap. On préfère « protéger », éviter de prendre la responsabilité. Protéger qui, au juste ? L’institution d’elle-même, plus que l’intéressé. Alors Aurélien se bat. Un an de courriers, une lettre ferme de son club, des échanges avec la fédération. Gain de cause, finalement. Mais la cicatrice symbolique reste, aussi nette qu’une suture mal fermée. « Ce moment m’a mis les deux pieds dedans. Avant, je doutais encore de ma légitimité. Là, il n’y avait plus de doute. » Coll. Aurélien Cirotte Aujourd’hui, il reconnaît des progrès : une page para-escalade sur le site de la FFME , des formations spécifiques, des journées de détection . Des signaux positifs, oui, mais qui ne suffisent pas. « Il faut que ça descende dans tous les clubs. » L’injustice fondatrice a donc laissé une trace paradoxale : elle a blessé, mais elle a aussi forcé l’institution à s’ouvrir. Une brèche s’est créée, et il s’y est engouffré. Jeux, images et hiérarchies La para-escalade fera son entrée aux Jeux Paralympiques de Los Angeles . Une victoire pour la discipline, mais une victoire sélective. Car toutes les catégories n’y seront pas conviées. Les RP1 — amputés — seront là. Mais les RP3, comme Aurélien, resteront à quai. « En tant que graphiste, je vois bien le message. Ce sont surtout les handicaps visibles qui passent. Ceux qui ont deux bras, deux jambes, restent dehors. » Il dit cela sans aigreur, calmement, mais la lucidité claque fort. L’institution a beau parler de critères sportifs, elle envoie un signal clair : ce qui compte, c’est l’image. Le handicap doit se voir pour exister dans le grand récit paralympique. Une jambe manquante ou un bras absent, ça se montre, ça frappe, ça s’imprime dans la rétine et ça cadre bien dans une affiche. Un pied atrophié, une douleur invisible, un corps qui compense en silence ? Trop subtil. Pas assez spectaculaire. Aurélien l’a compris. « Voir Solenne Piret ou Thierry Delarue grimper, c’est porteur d’une image forte, incontestable. Moi, c’est plus subtil. » Ce n’est pas seulement une question de performance, c’est une question de dramaturgie. Le paralympisme, comme l’olympisme, a besoin de héros. Et dans cette mise en scène mondiale, certains handicaps valent médailles et lumière, d’autres sont renvoyés aux coulisses. La hiérarchie n’est pas seulement médicale ou sportive : elle est esthétique. On choisit ce qui fait image, ce qui raconte bien une histoire. Le reste, on l’écarte. Spiritualité et transmission Sortir de la douleur n’a pas seulement offert un répit, il a ouvert pour Aurélien une dimension inédite, presque insoupçonnable. Pendant des années, il avait vécu sous la tyrannie de la souffrance, calibrant chacun de ses gestes à l’aune de ce qu’il pouvait ou non encaisser. Et puis, soudain, un monde s’est entrouvert : « Crocheter un talon gauche, courir à nouveau… des choses impossibles sur le papier que je peux faire ». Ces gestes minuscules, invisibles pour le reste du monde, prennent pour lui la valeur d’un séisme intime. Ce n’est pas la performance qui compte, c’est l’expérience : découvrir qu’un mouvement qu’il croyait interdit devient soudain possible. Aurélien Cirotte © RemGoDrone Il parle de spiritualité. Pas celle des dogmes ni des grands mots, mais une spiritualité du corps, physique, matérielle. Un état où l’on sent, dans chaque fibre, ce qui se rejoue. Comme si le corps, longtemps réduit à ses limites, retrouvait une part d’esprit, une clarté nouvelle. Le simple fait de poser son poids sur deux jambes devient une méditation, courir quelques mètres devient une forme d’extase discrète. Non pas religieuse, mais intensément existentielle : une manière de réapprendre à habiter sa propre carcasse. « On ne dit pas un handicapé. On dit une personne en situation de handicap. Les mots orientent le regard — et le regard, la pratique » Aurélien Cirotte Et demain ? Aurélien ne s’illusionne pas : son corps vieillit, la compétition ne sera pas éternelle. Mais tant qu’il peut, il continuera les championnats de France, parce que le goût d’aller « voir jusqu’où ça tient » reste intact. L’autre horizon, plus profond, c’est la transmission. Non pas une transmission verticale, professorale, où l’on transmettrait un savoir figé. Plutôt une mise en mouvement, une impulsion donnée. « Dire à d’autres que c’est possible. Leur faire gagner du temps. » Il sait la valeur de ces relais, parce qu’il en a bénéficié. Des rencontres qui changent un parcours, un mot juste qui renverse une certitude. Pour lui, transmettre, c’est occuper cette place modeste mais décisive : être la preuve vivante que d’autres possibles existent. Pas construire une école, mais ouvrir une brèche. Pas imposer un modèle, mais donner l’élan qui permettra à quelqu’un d’aller plus loin que lui. C’est peut-être là, finalement, la vraie spiritualité qu’il revendique : non pas seulement réapprendre son propre corps, mais offrir à d’autres la possibilité de se réinventer. « Dire que c’est possible » À la fin de l’entretien, Aurélien ne cherche ni posture héroïque ni effet de manche. Pas de grande phrase rédigée à l’avance, juste quelques mots qui reviennent, et qui disent l’essentiel : « Dire que c’est possible ». Possible de grimper avec une jambe bricolée, avec un pied qui refuse l’orthodoxie biomécanique. Possible de transformer la douleur en mémoire plutôt qu’en prison, de l’assumer comme cicatrice active sans la laisser devenir geôlière. Possible d’inventer des gestes différents, des pratiques adaptées, de sortir des cases préfabriquées par l’institution. Possible, enfin, de changer les mots, et à travers eux, les regards. Car les mots ne sont pas accessoires. « On ne dit pas un handicapé. On dit une personne en situation de handicap. Les mots orientent le regard — et le regard, la pratique. » C’est une bataille symbolique, mais une bataille décisive : dans la bouche des autres, se joue déjà une part de ce qu’on nous autorise à être. Et si, finalement, tout portrait d’Aurélien devait se résumer à cette obstination-là : faire sentir que le réel est toujours plus large que les cadres qu’on lui impose. Son corps, il l’a appris comme on apprend une voie complexe, exigeante, parfois douloureuse. On croit que c’est verrouillé, et puis on trouve une prise oubliée, une alternative, un pas de côté qui rend l’ascension possible. « Dire que c’est possible », ce n’est pas un slogan : c’est un style de vie. Une manière d’habiter la verticalité et, au-delà, de rappeler que chaque mouvement — même contraint — peut encore être une invention.
- Lydia Bradey & Jordane Liénard : le récit du succès en montagne
En partenariat avec Simond, Vertige Media prolonge l’expérience du podcast Learn from Altitude : alpinisme au féminin . Chaque épisode encorde deux trajectoires, deux époques, deux façons de se hisser au sommet. Dans ce huitième volet, Lydia Bradey, première femme au sommet de l’Everest sans oxygène, et Jordane Liénard, alpiniste contemporaine des 82 sommets, explorent, à travers cette cordée éphémère, une question essentielle : qu’est-ce qu’un succès, quand on est une femme en montagne ? L’alpinisme a ceci de cruel qu’il ne suffit pas d’arriver au sommet : il faut encore convaincre qu’on y est bien allé. Les hommes ont bâti leur légende sur des récits gravés dans le granite, entre journaux d’expédition et photos de sommet brandies comme des trophées. Les femmes, elles, ont souvent dû redoubler d’efforts pour faire exister leur réussite, parfois même pour être simplement crues. C’est là que se joue le cœur de ce nouvel épisode du podcast Learn from Altitude . Deux femmes, deux générations, deux combats : Lydia Bradey, dont l’ascension sans oxygène fut contestée avant d’être reconnue, et Jordane Liénard, qui a gravi les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes avec son guide, dans une démarche aussi radicale qu’éthique. Deux histoires qui posent la même question : à qui appartient la légitimité du récit ? Lydia Bradey, ou le sommet contesté 23 mai 2013. Dans une salle de Katmandou, Reinhold Messner et Lydia Bradey découpent un gâteau en forme d’Everest pour célébrer le soixantième anniversaire de la première ascension d’Hillary et Tenzing. Le symbole est limpide : ils sont les premiers, homme et femme, à avoir atteint le sommet sans oxygène. Pour Lydia, ce moment est une réparation, un quart de siècle après un exploit aussi pur que controversé. Retour en arrière. En 1988, la Néo-Zélandaise de 27 ans s’élance seule vers le sommet de l’Everest. Pas d’oxygène, pas de cordes fixes, pas de radio. Une ascension solitaire, méthodique et silencieuse. Au sommet, elle ne crie pas victoire. Elle respire, simplement. Mais en redescendant au camp de base, Lydia découvre un autre versant de la montagne : celui du soupçon. Ses compagnons d’expédition, Rob Hall et Gary Ball, contestent sa réussite. Elle aurait confondu le sommet sud avec le vrai sommet. Son appareil photo a gelé, il n’y a pas de cliché. Son permis n’était pas valable pour cette voie. Trop d’irrégularités pour un exploit si dérangeant. Elle a 27 ans, des dreadlocks, une liberté qui ne rentre dans aucun moule. Et pour certains, cela suffit à la disqualifier. Pendant trente ans, Lydia se tait. Ce n’est qu’en 2020, dans On ne m’a pas volé l’Everest (Guérin/Paulsen), qu’elle racontera enfin sa vérité, aidée par son amie écrivaine Laurence Fearnley. Le doute, l’humiliation, la colère. Et la lente conquête d’une reconnaissance officielle. Jordane Liénard, la constance d’une ascension sans artifices À plus de mille kilomètres du Népal, mais sur une ligne de crête similaire, Jordane Liénard interroge, elle aussi, la notion de réussite. Son défi, baptisé 4mil82, est de gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes, en compagnie de son guide Frédéric Bréhé, sans recourir à aucune remontée mécanique. De la Barre des Écrins à la Pointe Louis-Amédée, sur l’intégrale du Brouillard, ils s’en tiennent à cette ligne éthique : partir du bas, grimper, redescendre, repartir. Pas de raccourci, pas d’hélicoptère, pas de téléphérique. L’aventure durera des années. Elle s’achèvera le 23 août 2022 à 11h50, au sommet du dernier 4000. Jordane en tirera un livre, L’Appel des 4000 (Guérin/Paulsen, 2023), où elle raconte cette longue traversée de l’effort, entre engagement physique et quête intérieure. Jordane Liénard Dans un univers où la performance se mesure souvent à la vitesse ou au style « en solo » , son choix d’une ascension guidée et partagée interroge : la présence d’un guide dévalue-t-elle la réussite ? Jordane renverse la question : et si le succès se mesurait moins à l’autonomie qu’à la cohérence ? Son ascension, patiente et intègre, refuse le spectaculaire. Elle revendique un alpinisme lent, respectueux, ancré dans la continuité. Loin des records, mais au plus près du sens. Sans témoin, sans preuve, sans raccourci Lydia Bradey et Jordane Liénard partagent, à leur manière, une expérience commune : celle de devoir constamment justifier. La première, parce qu’elle n’a pas de photo. La seconde, parce qu’elle a un guide. L’une a trop peu de preuves, l’autre en a presque trop. C’est le paradoxe de la reconnaissance féminine en montagne : ce qui devrait aller de soi doit toujours être expliqué. Chez Bradey, le manque de preuve a ouvert la voie au soupçon. Chez Liénard, l’excès de transparence — un site, un blog, des traces GPS — la protège, mais change la nature du récit. Là où Lydia devait « être crue » , Jordane doit « être suivie » . Entre les deux, un siècle technologique, mais une même tension : comment raconter sans avoir à se justifier ? La montagne, elle, ne demande aucune preuve. Ce sont les hommes qui en ont fait une condition du succès. L’économie du succès L’histoire alpine a toujours hiérarchisé ses exploits : les solitaires, les premières, les plus rapides, les plus esthétiques. Mais la notion de « succès » est un prisme trompeur. Elle dit autant de la montagne que de ceux qui la racontent. Quand Reinhold Messner revendiquait la « pureté » du style alpin, il posait les bases d’un mythe masculin : celui du conquérant dépouillé, maître de sa trace. Lydia Bradey, par son ascension sans oxygène, s’inscrivait dans cette logique — mais son indépendance gênait. Jordane Liénard, elle, y oppose une lecture collective et patiente, où le partage du sommet compte autant que le sommet lui-même. Entre la preuve photographique et la preuve d’éthique, c’est toute une culture du succès qui s’écrit. Et si la montagne, finalement, n’était qu’un miroir de nos biais ? Là où l’on encense l’ambition d’un homme seul dans la face nord, on soupçonne encore la prétention d’une femme à vouloir la même ligne. Deux cordées, un même combat Les destins de Lydia Bradey et Jordane Liénard se rejoignent dans cette idée simple : grimper, pour elles, n’a jamais été seulement une affaire de sommet. C’est une manière de reprendre possession de leur récit. Lydia a mis trente ans à écrire le sien ; Jordane, elle, l’a raconté au fur et à mesure, étape après étape, sommet après sommet. Là où l’une a été privée de parole, l’autre s’en empare. Là où la première a subi le doute, la seconde choisit la transparence. Et dans ce mouvement, elles redessinent les contours du succès : non plus un verdict extérieur, mais une affirmation intime. La montagne comme épreuve de vérité On croit toujours que les sommets se gravissent en silence. En réalité, ils s’écrivent dans le bruit des récits. C’est là que Learn from Altitude : alpinisme au féminin trouve sa force : dans cette tentative de rendre la parole aux femmes dont la trace s’effaçait trop vite sous la neige du temps. Les cordées qu’il forme sont symboliques : elles relient les pionnières aux contemporaines, les visages d’hier aux voix d’aujourd’hui. Et chacune d’elles rappelle que la montagne ne se grimpe jamais seule — pas plus dans la neige que dans les mots. En associant Lydia Bradey et Jordane Liénard, cet épisode souligne la nécessité, toujours actuelle, de faire entendre d’autres voix dans le concert trop monocorde du récit alpin. Le succès, ici, n’est plus un drapeau planté au sommet : c’est une parole reconquise, une place reprise dans l’histoire. Parce qu’au fond, la montagne ne ment pas — mais les récits, parfois, oublient. Et c’est ce silence que ces cordées éphémères viennent fissurer. À découvrir dans l’épisode 8 de Learn from Altitude : alpinisme au féminin, disponible sur Globule Radio et toutes les plateformes ( Spotify , Apple Podcasts , Deezer ). Ce podcast est inspiré de l’ouvrage Une histoire de l’alpinisme au féminin (Éditions Glénat, 2024) de Stéphanie et Blaise Agresti, qui ont eu l'idée originale de former ces cordées éphémères entre des femmes alpinistes d’hier et d’aujourd’hui.
- Accueillir un championnat, à quel prix ? Leçons de Portland Rock Gym
Dans un échange dense avec Holly Chen pour le podcast The Impact Driver (Climbing Business Journal), Nick Gagliardi — ouvreur USAC niveau 3 et ancien directeur de l’ouverture au Portland Rock Gym (PRG) — déroule sans enjoliver la fabrique d’une compétition majeure : les Youth Nationals 2025. Architecture pensée pour l’épreuve, logistique à flux tendu, fatigue structurelle des équipes, diplomatie avec les membres et les voisin·e·s, et pédagogie par l’adaptation des blocs et des voies... Ici, pas de slogans : des méthodes, des aveux et des garde-fous. Youth Nationals 2025 à Portland © EP Climbing Le site de Beaverton, près de Portland, n’a pas été « adapté » à la compétition : il a été pensé pour elle. Profils multiples, circulation des spectateurs anticipée, espaces d’isolement calibrés… tout a été conçu pour accueillir des événements d’envergure. Mais derrière l’architecture, une philosophie domine. Comme le dit Gagliardi : « Je pense vraiment qu’il n’y a pas de style compétition. La différence, c’est l’intention ». Un rappel utile, à l’heure où de nombreuses salles françaises rêvent d’organiser « leur » compétition. Une salle pensée comme un outil, pas comme un décor Lorsqu’il décrit Beaverton, Nick Gagliardi ne parle pas d’esthétique, mais d’angles et de surfaces. « Je voulais autant d’angles différents que possible. On a tout, du toit de 80° jusqu’à la dalle à – 5°, des murs inspirés d’Arco pour faire des voies jumelées, et un grand mur de difficulté très déversant — mais stylisé. » Autrement dit, un cahier des charges clair : des façettes ouvertes et larges, capables d’accueillir volumes et prises modernes, pour que l’ouvreur·euse puisse imposer le mouvement plutôt que s’en accommoder. « On nous a proposé 15 000 dollars de prises au tarif USAC pour 10 000 dollars en frais d’organisation » Nick Gagliardi Et l’attention ne s’est pas arrêtée aux murs. La salle a été pensée comme un espace global : circulation fluide, multiples entrées et sorties, parkings, larges baies vitrées pour la visibilité… jusqu’à un bloc extérieur couvert, transformable en zone d’isolement avec point d’eau et paroi ajustable. Une obsession guide tout : la capacité à s’adapter. « Où met-on les gens qui ne sont pas sur les murs ? », interroge Gagliardi. Dans cette salle, la réponse existe : créer un amphithéâtre autour du bloc, maintenir des espaces publics ouverts et éviter le huis clos étouffant. Prévoir dès aujourd’hui ce qui permettra de rester pertinent dans quinze ans. Les coulisses d’une compétition nationale : une guerre d’usure Un championnat de ce niveau ne s’improvise pas. « Nous avons commencé à discuter des nationaux plus d’un an à l’avance », rappelle Gagliardi. À l’époque, certaines parois n’étaient même pas encore montées et il fallait déjà convaincre la fédération que l’espace tiendrait la charge. Puis viennent les tractations : budgets, matériel, volumes de prises. « On nous a proposé 15 000 dollars de prises au tarif USAC pour 10 000 dollars en frais d’organisation », explique-t-il. Un chiffre sec, derrière lequel se cache une réalité bien plus vaste : transformer une salle de grimpe en machine de compétition. « Même les ouvreur·euse·s qui n’étaient pas directement impliqué·e·s étaient “défoncé·e·s” — à cause de tout le décapage, du lavage, des déplacements » Nick Gagliardi Cela veut dire tout déplacer et tout réorganiser : stocker le matériel d’entraînement, louer des chaises et des gradins, sécuriser des zones, créer un isolement praticable, coordonner l’accès du public. Cela veut dire aussi absorber les aléas : un réseau internet qui lâche alors qu’il doit porter le streaming officiel, des vidéos à extraire en urgence après un incident, des machines de levage qui abîment les tapis, des perceuses et batteries qui disparaissent d’une équipe à l’autre. Autant de détails invisibles pour les spectateur·rice·s, mais dont dépend l’équilibre d’une semaine entière. Et au-delà de la technique, il y a les humains. « Même les ouvreur·euse·s qui n’étaient pas directement impliqué·e·s étaient “défoncé·e·s ” — à cause de tout le décapage, du lavage, des déplacements . » Pendant l’événement, Gagliardi a cumulé 140 heures de travail sur une seule période de paie. Ses journées consistaient à alterner : tester des chutes « scabreuses » pour valider la sécurité des relais, répondre aux besoins logistiques de la fédération, gérer le dialogue avec les équipes internes. Le lendemain de la finale, la salle exposait encore des voies de niveau national en plein milieu des créneaux membres. L’énergie manquait simplement pour tout démonter. Une compétition de ce calibre laisse une salle exsangue : du matériel abîmé, des équipes vidées, et la certitude que l’événement ne se limite pas à « un week-end de spectacle ». Membres, voisin·e·s : la vérité des coûts Accueillir un championnat, ce n’est pas seulement gérer des grimpeur·ses en compétition. C’est aussi composer avec celles et ceux qui paient un abonnement mensuel, et avec les voisin·e·s du quartier. « Nos membres sont comme : “Pourquoi il y a neuf voies en 8a dans la salle ?” », ironise Gagliardi. Le constat est brutal : quand une salle se transforme en arène nationale, elle cesse d’être un lieu du quotidien. Pour l’abonné·e qui vient deux fois par semaine après le travail, se retrouver face à une forêt de voies ultra-dures ou voir son créneau annulé peut vite tourner à la frustration. D’où l’importance, insiste-t-il, de prévenir, de contextualiser, de raconter l’histoire derrière les fermetures temporaires. La jeunesse, elle, devient l’argument économique central. « Nos programmes représentent quelque part entre 20 % et 25 % de tous nos revenus. » Ce n’est pas un à-côté, mais un socle. Une salle qui néglige ses jeunes compromet sa stabilité financière. À l’inverse, miser sur eux et elles implique d’assumer devant les autres membres que certaines semaines seront « prises » par des compétitions, parce qu’elles financent en partie le reste. L’impact dépasse même les murs. Dans le centre commercial où se trouve PRG-Beaverton, les restaurateur·rice·s se réjouissaient : « Notre chiffre d’un jour en une heure », rapportaient-ils. Mais d’autres commerces, privés de stationnement, criaient au scandale. La leçon est simple : une compétition ne se joue pas uniquement dans la salle, elle se joue dans son écosystème. Mal communiquer, c’est risquer de créer des allié·e·s enthousiastes d’un côté et des ennemi·e·s farouches de l’autre. Et cet équilibre, lui aussi, fait partie du prix à payer. Le travail relationnel de l’ouverture Derrière les prises et les volumes, il y a une vérité sociale : une équipe d’ouverture n’est pas une somme de CV mais une mosaïque de personnalités. « Tou·te·s les ouvreur·ses ne seront pas très extraverti·e·s. Tous ces gens ne pourront pas entrer dans une pièce pleine d’inconnu·e·s et se sentir chez eux », observe Gagliardi. Autrement dit, le facteur humain peut peser aussi lourd qu’une clé de 12. « Je ne veux pas être l’ouvreur qui a posé la voie qui a fait arrêter un enfant de grimper » Nick Gagliardi Il raconte sa formation pour passer le niveau 3 d’ouvreur USAC, en Alaska. Arriver seul, sans connaître personne. Enchaîner dix heures de travail sur les murs. Rentrer dans une maison partagée où vivent les autres ouvreur·ses, et devoir continuer à se comporter « en professionnel » alors que le soleil ne se couche jamais. La fatigue physique se double d’une fatigue sociale : impossible de couper, d’avoir un espace de respiration. De cette expérience, il tire une règle simple : annoncer d’emblée ses fragilités. Dire qu’on est nerveux·se, qu’on a besoin de temps pour formuler, qu’on peut paraître maladroit·e. Cette mise à nu change la donne : la discussion reste technique, elle n’est plus identitaire. C’est là, pour lui, la responsabilité d’un·e leader : non pas distribuer des blâmes, mais créer les conditions pour que chacun·e fasse mieux. Et rappeler que le rôle premier d’un·e ouvreur·euse en compétition n’est pas de briller mais de protéger. « Je ne veux pas être l’ouvreur qui a posé la voie qui a fait arrêter un enfant de grimper. » Derrière chaque pas de côté, derrière chaque réglage, il y a cette conscience : le spectacle ne vaut rien s’il met en danger. L’adaptation comme doctrine Parmi toutes les idées que développe Gagliardi, une revient comme un fil rouge : l’adaptation. « Je pense vraiment qu’il n’y a pas de style compétition… La différence, c’est l’intention. » Autrement dit, une voie de championnat n’est pas un catalogue de mouvements spectaculaires : c’est une partition pensée pour provoquer des chutes à des endroits différents du tracé. « Ce mouvement devrait te faire tomber », résume-t-il. « Toutes les salles ne peuvent pas accueillir des nationaux. Toutes ne peuvent pas accueillir des régionaux. Et c’est ok. » Nick Gagliardi L’art de l’ouvreur·euse consiste alors à régler la difficulté avec finesse. Un quart de tour sur une réglette, un pied déplacé de quelques centimètres, un rail légèrement aplati : de micro-manipulations qui suffisent à transformer l’expérience, sans dénaturer la ligne. C’est cette précision qui permet d’éviter l’écueil des blocs « tout ou rien » et de garder un contrôle sur le déroulement de la compétition. Intégrer ce principe dès les ouvertures commerciales, c’est préparer les équipes à l’exigence des grands événements. Construire des sections modulables permet, le jour J, d’ajuster en quinze minutes ce qui, autrement, nécessiterait de démonter un bloc entier. À la clé : du temps économisé, de la peau préservée, de l’énergie épargnée. Bref, une stratégie de survie pour les ouvreur·ses, mais aussi une philosophie : mieux vaut savoir affiner que repartir de zéro. Savoir renoncer, savoir inventer Toutes les salles n’ont pas vocation à accueillir un championnat national. « Toutes les salles ne peuvent pas accueillir des nationaux. Toutes ne peuvent pas accueillir des régionaux. Et c’est ok. » Le constat posé par Gagliardi n’a rien d’une condamnation : c’est un appel à la lucidité. Certaines structures, par leur taille, leurs moyens humains ou financiers, peuvent absorber le poids d’un tel événement. D’autres, au contraire, s’y épuiseraient. « La moitié de ce qu’on fait tient de la chance. On réduit le dé à six faces au lieu de vingt, mais on le lance toujours » Nick Gagliardi Et c’est là que s’ouvre une autre voie : inventer ses propres formats. Une petite salle n’a pas besoin de singer l’olympisme pour exister. Elle peut créer des compétitions citoyennes, des épreuves décalées, des rendez-vous locaux originaux qui parleront directement à sa communauté. Des événements plus modestes peut-être, mais plus incarnés, plus fédérateurs. La dignité d’une salle ne se mesure pas à l’étiquette d’un championnat, mais à l’adéquation entre ses ambitions et ses moyens. Dans cette logique, une « écologie des compétitions » devrait s’imposer : aux grandes structures de prendre sur elles les épreuves lourdes, aux petites de nourrir l’imaginaire de la grimpe autrement, en cultivant la créativité et le lien social. C’est cette diversité d’approches qui garantit la vitalité du milieu, bien plus qu’un mimétisme généralisé. Mesurer la réussite autrement On juge trop souvent un championnat à travers ses chiffres : le nombre de tops, la séparation entre les finalistes, l’élégance de la courbe de résultats. Pour Nick Gagliardi, ces indicateurs passent à côté de l’essentiel. « Est-ce que l’enfant veut revenir et faire une autre compétition ? », demande-t-il. Si la réponse est oui, l’objectif est atteint. Si, au contraire, une voie brise une motivation ou entraîne une blessure, alors c’est l’échec, quelle que soit la beauté des statistiques. Car derrière chaque compétition se cache une part irréductible d’aléa. « La moitié de ce qu’on fait tient de la chance. On réduit le dé à six faces au lieu de vingt, mais on le lance toujours. » Reconnaître cette incertitude, c’est admettre que même la meilleure équipe d’ouvreur·euse·s ne contrôle pas tout. C’est accepter qu’une compétition est une aventure fragile, faite de décisions humaines, d’imprévus et de hasard. Et que juger de l’extérieur est souvent illusoire. « Quand je vois une épreuve aux “ mauvais ” résultats, je refuse de juger : je n’y étais pas. Il y a de bonnes chances que, si j’y avais été, ça aurait fini exactement pareil. » Cette humilité n’est pas une excuse : c’est une méthode. Elle rappelle que l’ouverture n’est pas une science exacte, mais un équilibre délicat entre intention, ajustement et imprévisible. Et que la réussite d’un championnat se mesure d’abord à l’envie qu’il suscite de revenir, pas au tableau d’affichage final. Ce que raconte Nick Gagliardi n’est pas l’histoire d’un championnat éclatant, mais celle d’une salle qui a appris dans la douleur et qui en a tiré des règles. Concevoir l’architecture comme un outil, assumer l’impact sur les membres, désamorcer les tensions dans l’équipe, et surtout privilégier des voies ajustables plutôt que des numéros de cirque. Une salle n’a pas besoin d’un tampon « national » pour exister. Elle a besoin de lucidité sur ce qu’elle peut offrir et de cohérence dans son projet. Le reste suivra. Cet article s’appuie sur l’entretien mené par Holly Chen dans The Impact Driver Podcast , une production du Climbing Business Journal.
- Vertige Media est un média reconnu
Vertige Media vient d'obtenir la reconnaissance de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Pour un jeune média indépendant, c'est le Graal. Alors forcément, cette reconnaissance nous élève. Voici la petite histoire d'une légitimité acquise dans un paysage médiatique français en pleine tempête. © Vertige Media Nous l'attendions depuis des mois. Alors quand la nouvelle est tombée, nous avons un peu exulté. Avec quelques lignes administratives de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), l'État vient de valider Vertige Media . Nous obtenons ainsi sa reconnaissance. Pour un jeune média comme le nôtre, c'est bien plus qu'un simple tampon bureaucratique. Tampon, baudrier et fumée blanche Ce que ça veut dire exactement ? Un jury de confrères et consœurs a validé notre sérieux, notre déontologie, notre capacité à informer selon les standards du journalisme professionnel. Dans nos têtes, ce qu'on se plaît à imaginer ce sont des gens très importants qui se sont enfermés au sous-sol d'un lieu culte pour ressortir des heures après avec une fumée blanche, un baudrier et le tampon sur le manifeste de Vertige Media . Évidemment, ce n'est pas la réalité. Mais quand même, la vérité c'est que dans l'écosystème de la presse de loisirs et d'escalade, cette reconnaissance reste rare. Depuis le premier jour, nous nous sommes donné une mission : traiter l'escalade comme un « fait social, culturel et politique ». Cette validation officielle confirme cette ambition. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Nous pouvons désormais afficher le logo du ministère de la Culture sur notre site. C'est déjà ça. Comme cela reste le seul truc qui matérialise vraiment la décision, on ne s'est pas gêné. Pour le reste, on attendra d'avoir un nouveau gouvernement pour aller prendre le goûter rue de Valois. Blague à part, cette reconnaissance nous impose désormais une responsabilité renforcée envers vous, nos lectrices et nos lecteurs. La reconnaissance de Vertige Media par la CPPAP arrive au moment où nous avons multiplié les enquêtes, les portraits fouillés, les analyses sur des sujets que personne ne traitait dans notre secteur. C'est la reconnaissance que notre travail journalistique respecte les standards de la profession, même dans un domaine de niche comme l'escalade, qui compte aujourd'hui environ 2 millions de pratiquants en France. Elle intervient au moment où nos audiences augmentent sur le site, où notre compte Instagram est de plus en plus suivi et où notre newsletter compte près de 5000 abonné·e·s. Mais ce n'est pas tout. Quand l'information devient un champ de bataille Cette reconnaissance tombe aussi à un moment particulier de l'histoire médiatique française. Jamais l'information n'a été autant un enjeu de pouvoir. Les chiffres donnent le vertige : 11 milliardaires possèdent aujourd'hui 81% des ventes de presse quotidienne nationale, 95% des hebdomadaires généralistes et la moitié des audiences télés et radios. Une concentration qui pose de sérieux problèmes de pluralisme et alimente la méfiance du public envers les médias. Les tentatives d'influence se multiplient. Affaires de harcèlement dans les rédactions, demandes de limogeage de journalistes, rachats stratégiques... Le paysage médiatique français traverse une crise sans précédent. Les quelques aides publiques à la presse indépendante ont été supprimées cette année, fragilisant encore davantage les acteurs émergents. Dans ce contexte, les médias indépendants deviennent cruciaux. Ce sont eux qui révèlent les atteintes à la probité, documentent les bavures, enquêtent sur la pollution ou les violences sexistes et sexuelles. Sans eux, ces réalités n'existeraient pas ou peu dans le débat public. Derrière, ce sont des journalistes qui ne travaillent pas pour l'intérêt d'un actionnaire, mais au service de l'intérêt commun. L'information : un bien commun Pour un média spécialisé comme Vertige Media , cette mission de contre-pouvoir s'exerce à l'échelle de notre communauté. Nous avons révélé les dérives du marketing d'influence dans l'escalade, questionné l'impact environnemental des compétitions , analysé les enjeux de genre dans la pratique . Des sujets que les médias généralistes ne traitent pas, mais qui concernent directement notre lectorat. Notre reconnaissance CPPAP nous donne une légitimité supplémentaire pour porter ces sujets. Dans un secteur où l'information spécialisée reste fragile, cette validation officielle nous permet d'affirmer notre indépendance et notre sérieux journalistique. Car les défis sont nombreux pour un jeune média indépendant. Difficile de développer un modèle économique viable, de toucher une large audience, de faire sa place dans un milieu ultra-concurrentiel. La reconnaissance CPPAP ne résout pas tout, mais elle constitue un outil de crédibilité précieux. Face au constat alarmant de la concentration médiatique, chacun peut agir pour soutenir les médias indépendants. Notre reconnaissance CPPAP s'inscrit dans cette démarche : elle valide notre capacité à informer selon les standards professionnels, même dans les niches les plus spécialisées. Bref, on est fiers. Et on va tâcher de répondre à la promesse qu'on s'est faite depuis la création de Vertige Media : informer rigoureusement. Si cette reconnaissance nous élève, elle nous oblige toujours à suivre le même mantra : se mettre à la hauteur. Mention spéciale : Un grand merci au SPIIL de nous avoir accompagnés dans les méandres des démarches administratives de la reconnaissance.
- Janja Garnbret contre les hommes : le mauvais film de genre
C’est devenu un gimmick médiatique : et si Janja Garnbret, l’ogresse des murs artificiels, pouvait se frotter aux hommes et, pourquoi pas, les battre à leur propre jeu ? Le scénario plaît mais pourtant le film semble vu et revu. Peut-être parce que le récit ne raconte pas tant la grandeur de la championne slovène que l’obsession masculine de se poser en mètre-étalon. Janja Garnbret © David Pillet Depuis la double victoire de Janja Garnbret aux Championnats du monde de Séoul et son inscription désormais indélébile au panthéon de son sport, nous avons vu passer des dizaines d'articles et de vidéo. Avec eux, une seule question : « Est-elle plus forte que les hommes ? ». Alors, posons-le d'emblée : c'est un problème. Car derrière son vernis de légèreté, l'interrogation trahit une persistance : l’incapacité chronique du sport à célébrer une championne pour ce qu’elle accomplit dans son propre cadre de compétition. Il faudrait toujours lui inventer un miroir masculin, comme si la valeur de ses victoires dépendait de ce qu’elles laisseraient présager si, par hasard, elle venait à battre un homme. Et ce réflexe en dit sans doute plus sur les obsessions de nos récits sportifs que sur les performances de Janja Garnbret elles-mêmes. Duel imaginaire, miroir déformant « La question de savoir si Janja pourrait grimper avec les hommes, c’est typiquement une question née du male gaze , nous explique Climbing Yoshi , grimpeuse amatrice engagée sur les questions de genre . On regarde à travers le point de vue des hommes, comme si les femmes ressentaient le besoin de se mesurer à eux pour se sentir valorisées. » Il y a d'abord ces petites phrases : Le Monde glisse, dans une vidéo très partagée , « ses performances soulèvent une question rare dans le sport : pourrait-elle rivaliser directement avec les hommes ? ». Chez nos confrères de L’Équipe , la surenchère atteint son sommet : Alex Honnold, incarnation du free solo , déclare sans trembler — « Elle serait capable de gagner une compétition masculine, sur un bon jour, selon l’ouverture » — et l’ouvreur Thomas Ballet renchérit en la propulsant dans son « top 5 mondial chez les hommes ». De quoi faire saliver les rédactions en quête de duel épique : une héroïne seule contre tout un plateau masculin, comme si le sport se réduisait à un western d’intérieur. « Cette comparaison empêche de reconnaître à sa juste valeur le sport féminin. Maintenant qu’elle a fait ses preuves chez les femmes, on lui donnerait enfin le droit de se mesurer aux hommes — même pas forcément aux meilleurs. Ça entretient l’ego et la croyance des hommes qu’ils sont supérieurs aux femmes. » Climbing Yoshi, grimpeuse amatrice On comprend l’efficacité médiatique : le fantasme d’un affrontement mixte se lit comme une promesse de spectacle inédit. Mais ce récit n’a-t-il pas surtout pour fonction de réinstaller subrepticement un vieux réflexe ? Celui qui consiste à n’accorder du crédit aux victoires féminines qu’à condition qu’elles puissent se mesurer à l’étalon masculin. Or ce que Janja Garnbret accomplit depuis une décennie — dix titres mondiaux, une régularité sans pareille, une domination sans partage — ne souffre pas la comparaison, car il n’y a justement pas de comparaison à faire. Et c’est bien là le paradoxe : plus elle écrase sa catégorie, plus on semble tenté·e·s de déplacer le terrain, comme si cette domination ne pouvait pas, en elle-même, suffire à raconter l’exception. On préfère l’illusion d’un duel inventé à la reconnaissance pleine et entière d’un règne incontestable. « Cette comparaison empêche de reconnaître à sa juste valeur le sport féminin, poursuit Climbing Yoshi . Maintenant qu’elle a fait ses preuves chez les femmes, on lui donnerait enfin le droit de se mesurer aux hommes — même pas forcément aux meilleurs. Ça entretient l’ego et la croyance des hommes qu’ils sont supérieurs aux femmes. » Derrière le vernis du duel, du débat et de la question ouverte, on trouve une mécanique de domination bien plus ancienne. Celle qui refuse encore de laisser les victoires féminines exister par elles-mêmes. Vitesse, règlement et univers parallèle L’IFSC ( fédération internationale d'escalade, ndlr ) ne joue pas à l’ambiguïté : en bloc comme en difficulté, les voies sont distinctes pour les deux catégories. En pratique, on juge les grimpeur·euse·s dans leur cadre, point final. Et c’est bien normal : l’escalade n’est pas une discipline qui peut se réduire à un sprint sur piste. Pas de ligne de départ unique, pas de distance imposée, pas de chronomètre universel qui règle tout. Ici , chaque épreuve est une partition spécifique. C’est ce qui rend la comparaison directe illusoire. Quand on aligne les femmes et les hommes sur des murs différents, l’écart qu’on croit mesurer n’existe pas vraiment : ce sont deux histoires parallèles, deux dramaturgies construites par l’équipe en charge des ouvertures. La seule discipline qui permette un affrontement strict, c’est l'escalade de vitesse. Le règlement le formule sans détour : « Les hommes et les femmes s'affrontent sur des parcours identiques qui ne sont pas modifiés entre les manches » . Même mur, mêmes prises, même séquence de mouvements. Enfin, dira-t-on, un terrain neutre où tout le monde joue exactement la même partition. Mais ce « privilège » a un revers : il expose crûment les écarts de chronos, sans la médiation de l'ouverture, sans le confort de la nuance. Et sur ce terrain-là, le verdict, on le verra, n’a rien d’un secret bien gardé. Quand on cherche un terrain neutre, débarrassé du flou des styles et des voies sur-mesure, il reste donc la discipline reine du chronomètre : la vitesse. Ici, pas de débat possible : même mur de 15 mètres, mêmes prises boulonnées dans le même ordre, mêmes règles pour tout le monde. C’est le seul endroit où les comparaisons ne reposent pas sur des suppositions mais sur des secondes, et elles tombent comme des couperets. Ce qui est fascinant, c’est que la réduction de cet écart est devenue une histoire en soi. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en mai 2025, l’Américain Samuel Watson arrache le record en 4″64 . Quatre secondes et soixante-quatre centièmes pour avaler la voie standardisée du sol au top. En septembre, à Séoul, la Polonaise Aleksandra Mirosław fixe le sien à 6″03 . Traduction brute : environ 30 % d’écart. Pas besoin de conjectures ni de « et si ». Sur ce seul terrain commun, le verdict est immédiat et sans appel. Faut-il s’en émouvoir ? Pas nécessairement. Ce serait oublier que les deux records se sont effondrés en quelques années : Mirosław a fait tomber le record féminin à plusieurs reprises, Watson a gratté centièmes après centièmes. La dynamique est là, spectaculaire. Mais une parité absolue, non, il n’y en a pas. Et alors ? Qui avait décrété que c’était le but du jeu, sinon celles et ceux qui veulent à tout prix transformer une domination féminine en duel imaginaire ? Ce que Janja dit. Et ce qu’on lui fait dire La falaise n’a ni chronomètre ni règlement officiel. Elle se raconte en grades, en consensus collectifs, en débats parfois passionnés sur la cotation « juste ». C’est un autre théâtre, plus lent, mais pas moins spectaculaire. En avril 2025, la jeune Américaine Brooke Raboutou inscrit son nom dans l’histoire en réussissant Excalibur (9b+/5.15c) . Le magazine Climbing le note sobrement : « Brooke Raboutou devient la première femme à escalader du 5.15c » et souligne dans son article : « (...) la première femme de l'histoire à compléter une voie de cette difficulté ». Sobre, mais lourd de sens : un nouveau sommet féminin, arraché après des années de progression collective. « Pourquoi, d’ailleurs, rivaliser avec des hommes, pourquoi le ferais-je ? Je suis une femme et je veux être la meilleure… » Janja Garnbret dans L'Équipe Le Washington Post pousse l’interprétation plus loin , citant Stefano Ghisolfi : « L'escalade est l'un de ces sports où les performances des femmes et des hommes ne sont pas si éloignées... Excalibur est vraiment difficile... on peut vraiment voir que l'écart se resserre ». Beau slogan : l’écart est clos, rideau. Sauf que… non. Le 9c/5.15d — tel que proposé par Adam Ondra ( Silence ), puis par Sébastien Bouin ( DNA ), et plus récemment par Jakob Schubert ( BIG ) — n’a pas encore de répétition confirmée à ce jour, ce qui en fait une frontière active du possible dans l’escalade mondiale. Et côté bloc, les femmes tutoient aujourd’hui le V16/8C+ ( Katie Lamb en 2023 ), quand les hommes s’attaquent désormais au V17/9A, avec des lignes comme Burden of Dreams , Return of the Sleepwalker ou Alphane . Janja Garnbret © David Pillet Ce qui est fascinant, c’est que la réduction de cet écart est devenue une histoire en soi : chaque cotation franchie par une grimpeuse déclenche des superlatifs, comme si l’égalité totale était au coin du mur. Mais confondre une demi-cotation d’écart avec une prophétie de parité définitive, c’est oublier deux choses : d’une part que les cotations sont des conventions mouvantes, pas des absolus scientifiques. D’autre part que le simple fait d’atteindre ces niveaux historiques devrait suffire à raconter l’exception, sans qu’il soit nécessaire d’imaginer un duel fantasmé contre les hommes. Quand on lit ses propos, une chose saute aux yeux : Janja Garnbret n’a jamais revendiqué ce duel imaginaire, ce sont les autres qui le lui collent sur les épaules. Dans un entretien accordé à Reuters , elle se montre d'abord curieuse et lucide en déclarant qu'elle aimerait concourir sur les voies masculines, et que ses performances dépendraient de la configuration de la voie. Avant d'élargir le spectre : « J'ai toujours cru que les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes peuvent faire, nous pouvons être tout aussi fortes que les hommes ». Pas de provocation, pas de défi : simplement l’affirmation que l’escalade n’est pas un territoire réservé, et que les limites sont aussi culturelles que physiques. Mais dans L’Équipe , on la découvre plus tranchante encore : « Pourquoi, d’ailleurs, rivaliser avec des hommes, pourquoi le ferais-je ? Je suis une femme et je veux être la meilleure… » Avant d’ajouter plus loin : « Je pourrais gagner, si le style me convient. Mais, sur une autre voie, je ne pourrais pas faire quelques mouvements. Tout dépend du style ». En clair : elle n’exclut pas l’hypothèse, mais refuse d’en faire son horizon. Elle sait que son royaume, c’est la domination absolue de sa catégorie, une domination déjà suffisante pour marquer l’histoire. Autrement dit, Janja joue parfois le jeu des questions médiatiques — on devine l’amusement derrière certaines réponses — mais elle reste parfaitement consciente que le débat n’a pas été initié par elle. Ce sont les médias, les sponsors et les observateurs qui l’installent dans une arène qu’elle n’a jamais réclamée, comme si son hégémonie ne pouvait être légitime qu’en la confrontant à un étalon masculin. Ironie de l’histoire : Garnbret n’a pas besoin de ce duel pour être immense, mais c’est ce duel fantasmé qui permet à d’autres de continuer à écrire les gros titres. Réduire l’écart ou ouvrir les yeux ? Le récit du « gap closing » ( réduction de l'écart, ndlr ) a tout du slogan séduisant : il donne l’illusion d’un happy end sportif où femmes et hommes finiraient par courir côte à côte. Mais une tribune de Jane Jackson puliée dans Climbing Magazine vient rappeler combien cette histoire est trop belle pour être vraie, « trop ordonné, trop enthousiaste ». Trop propre, trop bien emballée pour refléter la réalité. Car l’égalité à conquérir n’est pas d’abord celle des chronos : elle se joue dans l’expérience vécue au quotidien, dans les vestiaires, sur les murs d’entraînement, dans la manière dont on crédite ou minimise une performance. « Est-ce que l’on a besoin de faire des compétitions mixtes pour rassurer ou remettre les hommes à leur place ? Moi je pense que l’on n’a pas besoin de ça. » Charline Vermont, grimpeuse amatrice Le Monde le rappelle clairement : la séparation entre catégories « est justifiée par des différences physiques perçues et des normes sociétales », et les inégalités persistent surtout parce que « l’allocation inégale des ressources et la faible médiatisation exacerbent ces inégalités ». Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de se demander si Janja Garnbret pourrait « réduire l’écart » en grimpant sur une voie masculine, mais de comprendre pourquoi cet écart s’est enraciné — dans les financements, l’encadrement, la reconnaissance — et comment le combler autrement qu’en inventant un duel spectaculaire. « Se cacher derrière le fun empêche le questionnement et limite la réflexion à une couche superficielle », souligne Climbing Yoshi. En d’autres termes, l’ironie ou la légèreté servent trop souvent d’alibi pour éviter de parler du fond : des biais structurels, de la répartition des moyens ou du cadre même des compétitions. Pour Vertige Media , une autre grimpeuse amatrice sensibilisée sur ses questions, Charline Vermont, confiait : « Est-ce que l’on a besoin de faire des compétitions mixtes pour rassurer ou remettre les hommes à leur place ? Moi je pense que l’on n’a pas besoin de ça. » Une formule simple qui dit beaucoup : ce n’est pas l’affrontement artificiel qui compte, mais la reconnaissance pleine et entière des performances pour ce qu’elles sont. Au fond, la vraie révolution ne viendra pas de l’image d’une championne qui « bat les hommes », mais d’un écosystème qui n’aura plus besoin de convoquer les hommes comme étalon. Moins de condescendance, plus de moyens, plus de diversité, et surtout un récit qui ne cherche plus à valider l’exception féminine par un hypothétique affrontement mixte. Réduire l’écart, oui, mais pas celui que l’on croit : non pas le différentiel de centièmes sur un mur de vitesse, mais celui qui persiste dans les structures, les représentations et les récits eux-mêmes. Le récit « Janja contre les hommes » a l’avantage d’un bon slogan : ça claque, ça intrigue, ça clique. Mais il repose sur un biais : faire des hommes le juge de paix ultime. Or Janja n’a pas besoin de ce détour. Elle écrase déjà sa discipline, elle pousse la falaise à des niveaux historiques, elle inspire une génération entière. La bonne bataille n’est pas de savoir si elle pourrait gagner une finale masculine, mais de créer des compétitions plus justes, des équipes d’ouverture plus mixtes, et des récits qui célèbrent les grimpeuses pour ce qu’elles font — pas pour ce qu’elles pourraient faire si on changeait les règles.
- Chaussons d’escalade : pourquoi un tel fétiche ?
Les grimpeur·euses vouent à leurs chaussons une passion qui dépasse largement le simple usage sportif. Serrés à la limite du supportable, ressemelés encore et encore, accumulés en petites séries spécialisées, ils incarnent une part d’identité et de performance. Mais pourquoi ce rapport quasi religieux à un bout de gomme et de cuir ? Retour sur l’histoire, la science et la culture d’un objet devenu fétiche. On pourrait penser qu’un chausson d’escalade est un banal consommable, comme une paire de baskets qu’on remplace quand elle s’use. Ça serait mal comprendre l’imaginaire des grimpeur·euses. Le chausson n’est pas qu’un outil : c’est le prolongement du corps, l’interface ultime entre le pied et la paroi, chargé de promesses et de symboles. De Pierre Allain bricolant ses premiers modèles à Fontainebleau aux éditions limitées que l’on collectionne comme des sneakers, il y a tout un monde. Celui où performance, douleur, identité et rareté se mélangent pour transformer une chaussure en objet de culte. Aux origines : de Fontainebleau à la révolution Stealth Avant les chaussons, il y avait les grosses de montagne : lourdes, rigides, conçues pour la neige et les éboulis, mais catastrophiques sur le grès ou le calcaire. Dans les années 1930, Pierre Allain, figure tutélaire de l’escalade à Fontainebleau, imagine une chaussure plus précise, avec une semelle lisse en caoutchouc. Ses « PA » marqueront une rupture. Dans les années 1950, le cordonnier Edmond Bourdonneau perfectionne l’idée et lance la marque EB, qui habillera les pieds de générations entières de grimpeur·euses en Europe. La vraie révolution arrive dans les années 1980, quand Charles Cole, alpiniste et ingénieur californien, met au point la gomme Stealth pour sa marque Five Ten. Première semelle véritablement « collante », elle change radicalement la gestuelle : le pied adhère aux dalles, s’agrippe aux grattons et autorise une escalade plus audacieuse. L’innovation se répand comme une traînée de magnésie, et très vite, le chausson devient un objet de désir autant que de nécessité. À partir de là, chaque marque joue sa partition : velcro, profils agressifs, rands actifs. Et chaque grimpeur·euse, sa fidélité. La science de la « collante » : l’alchimie de la gomme Le vocabulaire des grimpeur·euses dit tout : on parle de « grip », de « collante », comme si c’était une magie. Pourtant, derrière le ressenti se cache une science très concrète. La friction d’une gomme repose sur deux mécanismes : l’adhésion, quand la semelle accroche par cisaillement sur la surface, et l’ hystérésis , quand elle se déforme dans les micro-aspérités du rocher en dissipant de l’énergie. Ces phénomènes dépendent de variables multiples : rugosité du support, vitesse d’appui, humidité, et surtout température. Trop chaud, la gomme se ramollit et perd sa tenue sur les arêtes ; trop froid, elle se rigidifie mais garde sa précision sur les grattons. C’est ce qui explique l’obsession hivernale des grimpeur·euses pour « la collante » : ce moment où les doigts collent mieux à la roche, et où la gomme retrouve son mordant. Idée reçue fréquente : une gomme tendre serait toujours meilleure. Les essais tribologiques récents montrent que la dureté n’est pas un facteur unique. Certaines gommes plus rigides surpassent des gommes souples sur rocher dur et sec, précisément parce qu’elles déforment moins et maintiennent l’arête. Résultat : choisir sa semelle n’est pas une affaire de slogan mais de contexte. Et c’est bien là que l’essai en conditions devient indispensable. Essais tribologiques, kézako ? En laboratoire, les scientifiques font glisser des échantillons de gomme sur différentes surfaces pour mesurer précisément leur friction, leur usure et leur comportement selon la température et l’humidité. Ces tests, appelés « essais tribologiques », permettent de confirmer — ou de démonter — certaines idées reçues des grimpeur·euses. Quand le serrage vire au masochisme La légende veut qu’un·e vrai·e grimpeur·euse doive souffrir dans ses chaussons. L’image a la vie dure : on a tou·tes vu des grimpeur·euses retirer leurs paires entre chaque essai, les orteils marqués, parfois à la limite du saignement. Mais les données médicales sont formelles : chaussons trop serrés = déformations de l’hallux, douleurs métatarsiennes, compressions nerveuses, paresthésies. Les podologues parlent même de « pieds de grimpeur·euses » comme d’une pathologie spécifique. Faut-il pour autant tout relâcher et grimper en pantoufles ? Pas vraiment. La performance demande un ajustement précis, surtout sur petites prises. Mais il existe un seuil où la douleur n’ajoute plus rien à la précision. La majorité des pratiques – bloc indoor, falaise sportive, grandes voies – s’accommodent très bien d’un serrage franc mais supportable. Les modèles ultra cambrés et douloureux n’ont de sens que sur des tentatives courtes et ciblées. Autrement dit : serrer, oui. Se mutiler, non. P3, Bi-Tension et autres raffinements : anatomie d’une arme Derrière le fétichisme, il y a la technique. Les marques ont inventé des systèmes pour conserver l’agressivité d’un chausson même après des centaines d’heures. La Sportiva a introduit le système P3 ( Permanent Power Platform ), une bande qui maintient la cambrure et concentre la puissance sur l’avant du pied. Scarpa a développé de son côté les rands actifs Bi-Tension et Active Randing , conçus pour tendre le chausson sans l’écraser. Résultat : une précision durable, une meilleure redistribution des forces, et la promesse que l’objet fétiche restera performant plus longtemps. Ces innovations nourrissent aussi le discours marketing. Elles construisent l’idée que chaque modèle est unique, doté d’un « ADN » technique. Et c’est précisément ce storytelling qui renforce la fétichisation : posséder une paire de Solution ou de Drago , ce n’est pas seulement acheter un outil, c’est afficher une identité technique et culturelle. Collection, rareté et appartenance Peut-on vraiment se contenter d’une seule paire ? Peu de grimpeur·euses confirmé·es le croient encore. La collection de deux ou trois chaussons est devenu la norme : une paire rigide pour les micro-règlettes, une souple et cambrée pour le bloc moderne, une plus confortable pour les grandes voies. La rotation des paires permet aussi de prolonger leur durée de vie et de toujours avoir une solution adaptée. Mais au-delà de l’efficacité, il y a la loyauté de marque et le culte des modèles. Certains chaussons deviennent iconiques, au point de se transmettre presque comme des reliques. Les éditions limitées accentuent le phénomène : Scarpa a sorti une Furia 80 en seulement 900 exemplaires numérotés, aussitôt collectée par les fans. L’escalade rejoint ici une logique comparable à celle des sneakers : on n’achète plus seulement pour grimper, mais pour appartenir. Mythe ou réalité : quelques idées reçues passées au crible « Plus serré, plus fort. » Faux au-delà d’un certain point : la douleur finit par dégrader la performance et par abîmer le pied. « Gomme tendre = meilleur grip. » Pas toujours. Le comportement dépend du rocher, de la température et de la vitesse. « Un seul chausson suffit. » Possible, mais avoir plusieurs paires reste plus rationnel pour adapter la performance et prolonger la durée de vie des paires. Entre science et passion Pourquoi les grimpeur·euses fétichisent-ils leurs chaussons ? Parce qu’ils concentrent tout à la fois : l’histoire d’une pratique, la science des matériaux, le goût du sacrifice, l’appartenance à une marque ou à un modèle. Le chausson est une mémoire au bout des orteils, une extension du corps et un signe d’identité. Et pour celles et ceux qui veulent confronter la théorie à la pratique, le rendez-vous est donné : FRICTION, les 19 et 20 octobre à Climb Up Paris. Deux jours organisés avec Au Vieux Campeur pour tester, comparer, comprendre. Et peut-être, enfin, trouver chaussure à son pied. Inscriptions sur ce lien . Article sponsorisé par Au Vieux Campeur
- Escalader sans voiture : le topo qui veut changer la donne
À Grenoble, un guide d’un genre nouveau voit le jour : Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture . Plus qu’un simple topo, un pavé de 384 pages qui se présente comme un manifeste en faveur d’une autre manière d’habiter la montagne, où la question du transport devient centrale. Derrière ce projet auto-édité, Florian Garibal et l’aquarelliste Fanny Audigé, convaincu·e·s que repenser nos déplacements, c’est déjà repenser notre rapport à l’escalade. © Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture Pour une fois, voilà un topo qui ne s’écrit pas les chaussons aux pieds et la corde déjà posée. Il démarre dans les rues encombrées de Toulouse, là où, pour arpenter les montagnes, il faut d’abord avaler une heure et demi de route. L’équation devient alors absurde : beaucoup de temps perdu, une énergie gaspillée, et trop souvent des projets avortés à la dernière minute. « Je pense que je peux dire au moins 25 fois que j’ai annulé une sortie le samedi matin, parce que les gens s’étaient dégonflés dans la nuit », raconte Florian Garibal, moniteur d'escalade et co-auteur du topo. De cette frustration est née une conviction : et si le problème n’était pas la falaise, mais bien la voiture ? Quelques années plus tard, installé à Grenoble, il transforme ce constat en projet éditorial : Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture . Quand la logistique devient une philosophie Il aura suffi d’un changement de décor pour que tout bascule. En arrivant à Grenoble, Florian découvre une évidence que des années de galère toulousaine lui avaient rendue impensable : la falaise n’est plus une expédition, mais une voisine. Ici, on peut grimper à la demi-journée, voire après le travail, et surtout, on peut s’y rendre autrement qu’en allumant un moteur. « Non seulement je pouvais aller grimper en une demi-journée, voire après le travail, mais en plus je pouvais y aller à vélo, en bus, ou même à pied. » Ce renversement a valeur de révélation. Ce qui, pour beaucoup d’habitant·e·s grenoblois·e·s, relevait encore de l’automatisme automobile — la voiture comme réflexe, comme habitude culturelle — devient pour lui une évidence inversée : si la distance se réduit, pourquoi ne pas réduire aussi l’empreinte ? C’est là que la logistique cesse d’être un détail pour devenir une philosophie : la mobilité n’est plus l’obstacle, elle devient la condition même du plaisir de grimper. « Mettre en page un livre de 400 pages en deux mois, ça a été 16 heures par jour pendant 25 jours d’affilée » Florian Garibal, co-auteur du topo Et ce glissement n’est pas resté anecdotique. Très vite, ses ami·e·s s’y intéressent, intrigué·e·s par cette pratique qui, loin d’être une contrainte, prend l’allure d’une aventure plus simple et plus joyeuse. Les sorties se multiplient, la curiosité grandit, et Florian commence à en garder une trace. D’abord sous forme de récits bricolés sur un blog, La Crèmerie , qui finit par rassembler plusieurs centaines de lecteur·rices. Puis l’idée s’impose d’aller plus loin : « Ça faisait deux ans que je réfléchissais à faire un livre, c’était le moment », dit-il. Du blog artisanal au livre-manifeste Avec Fanny Audigé, illustratrice grenobloise, Florian décide de passer à l’échelle supérieure. Finies les anecdotes sur son blog. Cette fois, il s’agit d’assembler un monstre éditorial : 384 pages, 89 grandes voies, 41 secteurs, et l’ambition de faire tenir dans un seul objet ce que la plupart n’osent même pas imaginer. © Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture Le projet avance comme une ascension longue : chaque longueur apporte son lot de frissons. D’abord convaincre les équipeurs, ce qui fut plus simple qu’attendu : « Comme on reverse de l’argent à l’équipement, ils ont tous dit oui directement. » Ensuite, naviguer entre parcs naturels, métro, transporteurs, institutions, chacun avec ses règlements et ses zones d’ombre. Puis la collecte, le vrai chantier : « Sur les 90 grandes voies, j’en ai eu 20 envoyées par la communauté, 40 que j’ai faites moi-même, et pour le reste j’ai contacté des gens directement. » « Ça ne touche pas les gens de Brest ou de Bordeaux, mais ça montre qu’à l’échelle d’un territoire, il y a une vraie demande » Florian Garibal La petite communauté WhatsApp et la newsletter grossissent, chacun·e apporte sa pierre, ses photos, ses récits. À mesure que le topo prend forme, l’aventure cesse d’être celle d’un binôme pour devenir une cordée élargie. Et puis arrive le crux : la mise en page. « Mettre en page un livre de 400 pages en deux mois, ça a été 16 heures par jour pendant 25 jours d’affilée. » Là, plus de fissures ni de réglettes : seulement du texte, des images et des PDF. Une paroi abstraite, mais qui use tout autant. Et au milieu de cette grimpe d’un autre genre, Florian découvre aussi un univers parallèle : celui de l’impression. Ses rouleaux de papier de plusieurs kilomètres, ses formats qui décident du gaspillage ou non. « C’était important de comprendre comment fonctionne un imprimeur pour choisir un format qui gaspille le moins possible. » Un topo qui parle de mobilité douce, mais qui pousse la cohérence jusque dans ses fibres de cellulose. Le crowdfunding comme révélateur À première vue, ça aurait pu rester une aventure discrète : un topo local, destiné aux Grenoblois·es motivé·es par le vélo ou le bus. Mais la campagne Ulule a fait office de test grandeur nature. Objectif affiché : 100 préventes. Un chiffre modeste, calibré pour rassurer et déclencher l’effet boule de neige. « L’objectif affiché, c’était 100, mais dans nos têtes, on en avait un autre », explique Florian, qui connaît bien les ficelles du financement participatif. Résultat : presque 300 préventes en quelques jours. Et ce n’est pas anodin. Cela confirme qu’il existe bel et bien un désir d’alternatives, une appétence pour un imaginaire où l’on peut partir grimper autrement que moteur allumé. « Ça ne touche pas les gens de Brest ou de Bordeaux, mais ça montre qu’à l’échelle d’un territoire, il y a une vraie demande. » « Les récits de voyage qu’on trouve en librairie parlent de destinations lointaines, souvent en avion, mais comme si le transport n’existait pas. Comme s’il y avait une téléportation » Florian Garibal © Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture Cette réussite ouvre d’ailleurs un horizon plus large : et si Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture n’était que le premier tome d’une collection ? Florian et Fanny l’imaginent déjà : une maison d’édition capable de reproduire ce modèle ailleurs, en accompagnant des auteur·e·s locaux·ales. Une sorte de contrepoids aux géants du récit d’aventure, qui vendent encore à la pelle des voyages en avion maquillés en « retour à la nature ». En somme, le crowdfunding donne corps à une intuition : la mobilité douce n’est plus un fantasme de marginaux, elle devient un désir collectif, assez fort pour s’incarner dans un livre. Un projet politique assumé Florian ne s’en cache pas : « Ce livre, c’est un projet politique ». Non pas au sens partisan, mais au sens le plus direct : déplacer les normes, changer le cadre de ce que l’on considère comme « normal » quand on parle de montagne. Il suffit d’ouvrir les rayons « voyage » ou « aventure » en librairie pour comprendre ce qu’il veut dire : des récits d’explorations lointaines, la plupart rendues possibles par un billet d’avion qu’on préfère passer sous silence. « Les récits de voyage qu’on trouve en librairie parlent de destinations lointaines, souvent en avion, mais comme si le transport n’existait pas. Comme s’il y avait une téléportation. Le problème, c’est que le plus gros impact, il est là, dans le trajet. » « Ce qu’on veut, c’est qu’un jour, dans une librairie de montagne, la mobilité douce soit un choix parmi d’autres, et pas juste une curiosité marginale » Florian Garibal Refuser cette ellipse, c’est déjà une prise de position. Et c’est aussi ce qui a conduit à l’auto-édition. Pas question de déléguer le sens à une maison qui aurait lissé les angles ou imposé ses process . « On paye presque deux fois plus cher en travaillant avec la Manufacture des Deux Ponts, mais on reste alignés avec nos valeurs. » Le choix de cet imprimeur grenoblois, certifié ISO 14001, n’est pas un détail : c’est l’idée que la cohérence se joue dans chaque fibre du papier, jusque dans la manière dont les chutes sont recyclées. © Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture En somme, Escalades depuis Grenoble – Aventures sans voiture est une déclaration : liberté artistique, cohérence écologique, exigence éditoriale. Trois piliers qui, mis bout à bout, déplacent l’objet « topo » du côté du manifeste. Et après ? L’avenir s’appelle Aventures sans voiture . Après Grenoble, les Pyrénées sont déjà évoquées, et d’autres massifs pourraient suivre. Mais il ne s’agit pas seulement de décliner le modèle, tome après tome : l’ambition est plus vaste. Il s’agit de peser dans l’imaginaire collectif, d’offrir aux grimpeur·ses autre chose que l’alternative entre la voiture obligatoire et le récit exotique qui commence par un embarquement discret dans un avion low-cost . « Ce qu’on veut, c’est qu’un jour, dans une librairie de montagne, la mobilité douce soit un choix parmi d’autres, et pas juste une curiosité marginale. » Et les chiffres sont là pour rappeler que ce n’est pas une coquetterie idéologique mais une urgence bien concrète : 69 % des émissions du tourisme viennent du transport. Autrement dit, le problème n’est pas dans la verticalité des parois, mais dans l’horizontalité des trajets pour les rejoindre. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement « où grimper », mais bien « comment s’y rendre ». Pendant la conversation, Florian le résume avec simplicité : « Pour nous, grimper sans voiture, ce n’est pas seulement réduire l’impact. C’est retrouver une forme de simplicité, une liberté d’inventer d’autres manières d’aller en montagne ». Derrière le pavé de 384 pages, on retrouve cette idée de fond : l’escalade n’est pas qu’un sport, c’est une manière d’habiter le monde.
- Balin Miller : un prodige de 23 ans meurt en rappel sur El Capitan
Le grimpeur originaire d’Alaska, auteur du premier solo de la Slovak Direct au Denali, est mort le 1ᵉʳ octobre en redescendant la voie Sea of Dreams à Yosemite. Selon des témoins, il aurait poursuivi son rappel au-delà du bout de sa corde en tentant de récupérer un sac coincé. L’accident, encore en cours d’investigation, illustre le danger récurrent de ces manœuvres de descente en grande voie, souvent à l’origine d’accidents mortels. Balin Miller © Millet Il avait terminé son ascension. Balin Miller, 23 ans, venait de sortir Sea of Dreams , l’une des voies les plus redoutées d’El Capitan. Mais, selon plusieurs témoins, son sac de hissage se serait coincé, l’obligeant à redescendre. Dans cette manœuvre devenue routinière, une erreur probable : poursuivre le rappel au-delà du bout de la corde, sans nœud d’arrêt. Sa chute, estimée à plusieurs centaines de mètres, lui a été fatale. L’enquête du National Park Service doit encore en préciser les circonstances exactes. Un scénario fréquent dans une voie extrême Sea of Dreams n’a jamais eu la réputation d’être une voie clémente. Ouverte en 1978 par Jim Bridwell, Dale Bard et Dave Diegelman, elle reste classée A4, symbole de l’artif engagé d’El Capitan. C’est pourtant sur une phase a priori plus anodine, le rappel final pour dégager un sac coincé, que tout aurait basculé. D’après des observateurs depuis la vallée, Miller aurait poursuivi sa descente au-delà du bout de sa corde. Une hypothèse encore à confirmer, mais qui renvoie à l’un des scénarios d’accidents les plus fréquents en grande voie. L’ascension interrompue en direct Le drame n’a pas seulement marqué par son issue, mais aussi par sa visibilité. Un spectateur, Eric Kufrin, suivait au télescope les cordées engagées sur El Capitan et diffusait en direct sur TikTok. Il ne visait pas spécifiquement Miller, mais la scène a été captée devant environ 500 spectateurs en ligne. Certains ont d’abord cru que le grimpeur diffusait lui-même, ce qui a été démenti. Reste que la chute d’un athlète au sommet de son art a été vue en temps réel, révélant l’exposition nouvelle des grandes parois à l’œil numérique. Une trajectoire fulgurante Né à Anchorage, Miller avait grandi dans les falaises locales avec son père et ses frères et sœurs. Pour financer ses expéditions, il enchaînait les jobs saisonniers – pêche au crabe, chantiers dans le Montana – et investissait tout dans ses projets alpins. En 2025, il avait frappé trois fois fort : En janvier, avec la deuxième ascension connue de Reality Bath dans les Rocheuses canadiennes, réalisée en solo ; En mai, avec French Connection sur le Mont Hunter, en solo ; En juin, avec le premier solo de la Slovak Direct sur le Denali, 2 700 mètres avalés en environ 56 heures, une performance saluée comme historique. À 23 ans, son nom circulait déjà dans la communauté comme celui d’un futur grand. Les erreurs de rappel, talon d’Achille des grandes parois L’American Alpine Club recense chaque année plusieurs accidents mortels liés au rappel . En 2023, 14 accidents ont été documentés, dont 8 fatals, souvent pour des raisons similaires : corde trop courte, absence de nœud, distraction. Le cas de Miller, tel que rapporté par les témoins, rappelle que la gravité ne réside pas uniquement dans la difficulté technique des voies, mais aussi dans la routine des manœuvres. À El Capitan, où l’engagement est déjà extrême, la moindre faille peut être fatale. Balin Miller n’était pas un influenceur cherchant à nourrir l’algorithme, mais un grimpeur obsédé par les parois les plus hostiles. Surnommé « Orange Tent Guy » pour son portaledge visible dans la vallée de Yosemite, il incarnait une génération prête à vivre léger et à grimper fort, quitte à repousser les marges. Sa mort, brutale et filmée malgré lui, laisse l’image d’un talent stoppé net au seuil d’une carrière hors norme.