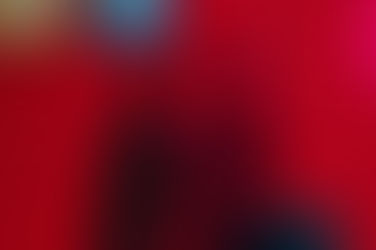Lydia Bradey & Jordane Liénard : le récit du succès en montagne
- Sponsorisé par Simond

- 9 oct. 2025
- 5 min de lecture
En partenariat avec Simond, Vertige Media prolonge l’expérience du podcast Learn from Altitude : alpinisme au féminin. Chaque épisode encorde deux trajectoires, deux époques, deux façons de se hisser au sommet. Dans ce huitième volet, Lydia Bradey, première femme au sommet de l’Everest sans oxygène, et Jordane Liénard, alpiniste contemporaine des 82 sommets, explorent, à travers cette cordée éphémère, une question essentielle : qu’est-ce qu’un succès, quand on est une femme en montagne ?

L’alpinisme a ceci de cruel qu’il ne suffit pas d’arriver au sommet : il faut encore convaincre qu’on y est bien allé. Les hommes ont bâti leur légende sur des récits gravés dans le granite, entre journaux d’expédition et photos de sommet brandies comme des trophées. Les femmes, elles, ont souvent dû redoubler d’efforts pour faire exister leur réussite, parfois même pour être simplement crues. C’est là que se joue le cœur de ce nouvel épisode du podcast Learn from Altitude. Deux femmes, deux générations, deux combats : Lydia Bradey, dont l’ascension sans oxygène fut contestée avant d’être reconnue, et Jordane Liénard, qui a gravi les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes avec son guide, dans une démarche aussi radicale qu’éthique. Deux histoires qui posent la même question : à qui appartient la légitimité du récit ?
Lydia Bradey, ou le sommet contesté
23 mai 2013. Dans une salle de Katmandou, Reinhold Messner et Lydia Bradey découpent un gâteau en forme d’Everest pour célébrer le soixantième anniversaire de la première ascension d’Hillary et Tenzing. Le symbole est limpide : ils sont les premiers, homme et femme, à avoir atteint le sommet sans oxygène. Pour Lydia, ce moment est une réparation, un quart de siècle après un exploit aussi pur que controversé.
Retour en arrière. En 1988, la Néo-Zélandaise de 27 ans s’élance seule vers le sommet de l’Everest. Pas d’oxygène, pas de cordes fixes, pas de radio. Une ascension solitaire, méthodique et silencieuse. Au sommet, elle ne crie pas victoire. Elle respire, simplement. Mais en redescendant au camp de base, Lydia découvre un autre versant de la montagne : celui du soupçon.
Ses compagnons d’expédition, Rob Hall et Gary Ball, contestent sa réussite. Elle aurait confondu le sommet sud avec le vrai sommet. Son appareil photo a gelé, il n’y a pas de cliché. Son permis n’était pas valable pour cette voie. Trop d’irrégularités pour un exploit si dérangeant. Elle a 27 ans, des dreadlocks, une liberté qui ne rentre dans aucun moule. Et pour certains, cela suffit à la disqualifier.

Pendant trente ans, Lydia se tait. Ce n’est qu’en 2020, dans On ne m’a pas volé l’Everest (Guérin/Paulsen), qu’elle racontera enfin sa vérité, aidée par son amie écrivaine Laurence Fearnley. Le doute, l’humiliation, la colère. Et la lente conquête d’une reconnaissance officielle.
Jordane Liénard, la constance d’une ascension sans artifices
À plus de mille kilomètres du Népal, mais sur une ligne de crête similaire, Jordane Liénard interroge, elle aussi, la notion de réussite. Son défi, baptisé 4mil82, est de gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes, en compagnie de son guide Frédéric Bréhé, sans recourir à aucune remontée mécanique.
De la Barre des Écrins à la Pointe Louis-Amédée, sur l’intégrale du Brouillard, ils s’en tiennent à cette ligne éthique : partir du bas, grimper, redescendre, repartir. Pas de raccourci, pas d’hélicoptère, pas de téléphérique. L’aventure durera des années. Elle s’achèvera le 23 août 2022 à 11h50, au sommet du dernier 4000.
Jordane en tirera un livre, L’Appel des 4000 (Guérin/Paulsen, 2023), où elle raconte cette longue traversée de l’effort, entre engagement physique et quête intérieure.

Dans un univers où la performance se mesure souvent à la vitesse ou au style « en solo », son choix d’une ascension guidée et partagée interroge : la présence d’un guide dévalue-t-elle la réussite ? Jordane renverse la question : et si le succès se mesurait moins à l’autonomie qu’à la cohérence ? Son ascension, patiente et intègre, refuse le spectaculaire. Elle revendique un alpinisme lent, respectueux, ancré dans la continuité. Loin des records, mais au plus près du sens.
Sans témoin, sans preuve, sans raccourci
Lydia Bradey et Jordane Liénard partagent, à leur manière, une expérience commune : celle de devoir constamment justifier. La première, parce qu’elle n’a pas de photo. La seconde, parce qu’elle a un guide. L’une a trop peu de preuves, l’autre en a presque trop. C’est le paradoxe de la reconnaissance féminine en montagne : ce qui devrait aller de soi doit toujours être expliqué.
Chez Bradey, le manque de preuve a ouvert la voie au soupçon. Chez Liénard, l’excès de transparence — un site, un blog, des traces GPS — la protège, mais change la nature du récit. Là où Lydia devait « être crue », Jordane doit « être suivie ». Entre les deux, un siècle technologique, mais une même tension : comment raconter sans avoir à se justifier ?
La montagne, elle, ne demande aucune preuve. Ce sont les hommes qui en ont fait une condition du succès.
L’économie du succès
L’histoire alpine a toujours hiérarchisé ses exploits : les solitaires, les premières, les plus rapides, les plus esthétiques. Mais la notion de « succès » est un prisme trompeur. Elle dit autant de la montagne que de ceux qui la racontent.
Quand Reinhold Messner revendiquait la « pureté » du style alpin, il posait les bases d’un mythe masculin : celui du conquérant dépouillé, maître de sa trace. Lydia Bradey, par son ascension sans oxygène, s’inscrivait dans cette logique — mais son indépendance gênait. Jordane Liénard, elle, y oppose une lecture collective et patiente, où le partage du sommet compte autant que le sommet lui-même.
Entre la preuve photographique et la preuve d’éthique, c’est toute une culture du succès qui s’écrit. Et si la montagne, finalement, n’était qu’un miroir de nos biais ? Là où l’on encense l’ambition d’un homme seul dans la face nord, on soupçonne encore la prétention d’une femme à vouloir la même ligne.
Deux cordées, un même combat
Les destins de Lydia Bradey et Jordane Liénard se rejoignent dans cette idée simple : grimper, pour elles, n’a jamais été seulement une affaire de sommet. C’est une manière de reprendre possession de leur récit. Lydia a mis trente ans à écrire le sien ; Jordane, elle, l’a raconté au fur et à mesure, étape après étape, sommet après sommet.
Là où l’une a été privée de parole, l’autre s’en empare. Là où la première a subi le doute, la seconde choisit la transparence. Et dans ce mouvement, elles redessinent les contours du succès : non plus un verdict extérieur, mais une affirmation intime.
La montagne comme épreuve de vérité
On croit toujours que les sommets se gravissent en silence. En réalité, ils s’écrivent dans le bruit des récits. C’est là que Learn from Altitude : alpinisme au féminin trouve sa force : dans cette tentative de rendre la parole aux femmes dont la trace s’effaçait trop vite sous la neige du temps.
Les cordées qu’il forme sont symboliques : elles relient les pionnières aux contemporaines, les visages d’hier aux voix d’aujourd’hui. Et chacune d’elles rappelle que la montagne ne se grimpe jamais seule — pas plus dans la neige que dans les mots.
En associant Lydia Bradey et Jordane Liénard, cet épisode souligne la nécessité, toujours actuelle, de faire entendre d’autres voix dans le concert trop monocorde du récit alpin. Le succès, ici, n’est plus un drapeau planté au sommet : c’est une parole reconquise, une place reprise dans l’histoire.
Parce qu’au fond, la montagne ne ment pas — mais les récits, parfois, oublient. Et c’est ce silence que ces cordées éphémères viennent fissurer.
À découvrir dans l’épisode 8 de Learn from Altitude : alpinisme au féminin, disponible sur Globule Radio et toutes les plateformes (Spotify, Apple Podcasts, Deezer). Ce podcast est inspiré de l’ouvrage Une histoire de l’alpinisme au féminin (Éditions Glénat, 2024) de Stéphanie et Blaise Agresti, qui ont eu l'idée originale de former ces cordées éphémères entre des femmes alpinistes d’hier et d’aujourd’hui.