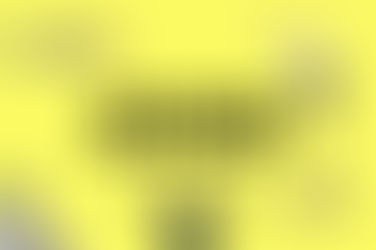La société du risque : pourquoi accepte-t-on le danger en escalade ?
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 17 nov. 2025
- 14 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 nov. 2025
Autrefois perçue comme une pratique marginale et dangereuse, l’escalade s’invite aujourd’hui au cœur d’une société obsédée par la sécurité, les normes et le « risque zéro ». Entre salles surprotégées, auto-assureurs, free solo et statistiques d’accidents, Vertige Media mobilise la notion de « société du risque » du sociologue Ulrich Beck pour comprendre pourquoi nous continuons, malgré tout, à choisir le danger – et ce que cela raconte de notre époque.

Paris, un mardi soir. À l’entrée de la salle, on signe une décharge de responsabilité en deux clics sur une tablette. On scrolle mécaniquement jusqu’en bas, on coche « J’ai lu et j’accepte les conditions générales », sans avoir rien lu du tout. Sur un bloc au milieu de la salle, une adolescente tombe de trois mètres sur un tapis épais comme un matelas de palace, éclate de rire, se relève, frappe ses mains sur ses cuisses et repart déjà sur une autre voie. Au pied du devers de 15 mètres, un moniteur répète pour la cinquième fois de la soirée les mêmes consignes de sécurité : « On s’encorde, on se fait vérifier par son partenaire, on ne lâche jamais la corde ».
Tout est dit noir sur blanc : il y a un danger. Tout est fait pour que ce danger soit maîtrisé, documenté, encadré, sécurisé, absorbé par des tapis, des normes et des procédures. Et pourtant, on grimpe. Nous sommes des millions, en France et ailleurs, à accepter joyeusement de monter sur des murs dont on sait qu’une erreur peut, parfois, très mal finir. Dans une société obsédée par la sécurité, hantée par les catastrophes industrielles, le réchauffement climatique et les crises sanitaires, cette acceptation volontaire du risque a quelque chose de paradoxal.
Pourquoi accepte-t-on, voire revendique-t-on, le danger en escalade alors même que notre époque semble vouloir traquer le moindre grain de risque, des aires de jeux des enfants jusqu’aux normes alimentaires ? Pour comprendre cette tension, la grille de lecture proposée par le sociologue allemand Ulrich Beck, théoricien de la « société du risque », offre un éclairage particulièrement précieux.
Bienvenue dans la société du risque
Ulrich Beck publie en 1986 « Risikogesellschaft », traduit quelques années plus tard en anglais sous le titre « Risk Society : Towards a New Modernity ». Pour lui, nous avons basculé d’une société industrielle centrée sur la production de richesses vers une société où l’enjeu principal devient la gestion des risques que cette même modernisation a engendrés. Non pas les risques « externes » – tempêtes, épidémies, famines – que l’on imputait autrefois au destin, au climat ou à la fatalité, mais des risques « fabriqués » par l’activité humaine elle-même : pollution, catastrophes nucléaires, dérèglement climatique, perturbateurs endocriniens, crise financière, etc.
Dans cette perspective, la modernité ne se contente pas d’apporter confort, mobilité, technologies et loisirs : elle produit aussi ses propres menaces. C’est ce que Beck appelle la « modernisation réflexive » : une société contrainte de se retourner sur elle-même pour gérer les conséquences de son propre développement. Les débats sur le nucléaire, les OGM, les pandémies ou l’intelligence artificielle en sont des exemples quotidiens : nous devons apprendre à vivre avec des risques que nous avons nous-mêmes fabriqués.
Plusieurs études menées dans des salles européennes montrent que le taux de blessure aiguë en escalade indoor tourne autour de 0,02 blessure pour 1 000 heures de pratique
Société du risque ne veut pas dire société plus dangereuse qu’avant au sens propre du terme. Cela renvoie plutôt à une société où le risque devient le mode central d’organisation, de débat et de gouvernement. On calcule, on modélise, on anticipe, on assure. Les États légifèrent, les experts publient des courbes de probabilité, les industriels affichent des procédures de « gestion des risques », les individus eux-mêmes intègrent la figure du « citoyen responsable » censé veiller à sa santé, à sa retraite, à sa carrière, à ses assurances, à son empreinte carbone.
Dans cette logique, le risque n’est plus seulement un danger objectif. Il devient un objet politique, économique et moral. Qui a le pouvoir de définir ce qui est acceptable ou non ? Quels risques sont tolérés, au nom de quel bénéfice, pour qui, et avec quelle répartition des conséquences en cas de problème ? Beck résume cela en une formule dérangeante : la société contemporaine ne se définit plus seulement par la distribution des richesses, mais par la distribution des risques – risques qui, loin d’être partagés équitablement, frappent plus fortement certains groupes que d’autres.
Partant de là, l’escalade devient un laboratoire fascinant : un sport où le danger est à la fois exhibé, rationalisé, normalisé et revendiqué, à l’intérieur même d’une époque qui affiche partout la promesse du « zéro risque ».
Un sport dangereux… mais raisonnablement
On ne le répètera jamais assez : l’escalade n’est pas un jeu vidéo. On peut se faire vraiment mal, voire mourir. Des accidents graves surviennent chaque année, en falaise comme en salle. Des assureur·ses relâchent la corde au mauvais moment, des grimpeur·ses oublient de s’encorder ou de se clipper à un auto-assureur, des dégaines sont mal posées, des rochers se décrochent, des relais s’arrachent, des crash-pads mal positionnés transforment une chute anodine en fracture.
Pourtant, si l’on sort des impressions pour regarder les chiffres, le tableau est plus nuancé. Plusieurs études menées dans des salles européennes montrent que le taux de blessure aiguë en escalade indoor tourne autour de 0,02 blessure pour 1 000 heures de pratique – un niveau très faible comparé à de nombreux sports collectifs ou de contact. La plupart de ces blessures sont d’ailleurs bénignes à modérées : entorses de cheville, doigts abîmés, petites luxations, traumatismes musculaires.
Certes, d’autres travaux montrent qu’entre 30 et 50 % des grimpeur·ses déclarent avoir déjà été blessé·es au cours de leur pratique, en particulier à cause de sursollicitations des doigts, des épaules ou des coudes. Mais il s’agit majoritairement de pathologies chroniques, de « sur-usage » plus que de chutes dramatiques. La gravité des accidents varie fortement selon le type de pratique : bloc sur tapis épais, grande voie, trad engagé, alpinisme mixte. Une revue de littérature citée par Simon Rauch montre ainsi que le trad engagé présente, historiquement, des taux de blessures par heure plus élevés que certains sports réputés accidentogènes comme le football américain ou la moto.
Dans les salles, la plupart des incidents qui tournent mal sont liés à quelques scénarios bien identifiés : erreurs d’assurage (mauvaise manipulation, inattention, mauvaise utilisation du système), oublis de clipper un auto-assureur, mauvaise réception sur les tapis de bloc. Des analyses menées sur des bases de données d’accidents en salles parlent d’un retour au sol pour environ 20 000 visites, avec, là encore, une forte concentration sur les erreurs humaines plutôt que sur les défaillances matérielles.
La société du risque moderne se structure précisément autour de cette ambivalence : nous vivons dans un univers saturé de dangers abstraits que nous ne maîtrisons pas, tout en développant des espaces très codés où l’on peut, au contraire, expérimenter un danger hyper-localisé que l’on estime contrôler.
On se retrouve donc avec une situation paradoxale : objectivement, l’escalade – notamment en salle – est un sport dont le taux d’accident grave reste relativement faible, surtout si on le rapporte au nombre d’heures pratiquées. Mais subjectivement, le danger est omniprésent : on tombe de haut, on voit des images de free solo, on signe des décharges, on entend parler de la moindre chute spectaculaire sur les réseaux sociaux.
C’est précisément là que la logique de la société du risque entre en scène. Le danger n’est pas nié. Il est rendu calculable, assurable, organisable. La communauté de la grimpe produit des statistiques, des recommandations, des classifications de risques – jusqu’à la Commission médicale de l’UIAA qui propose une typologie des pratiques selon le niveau de danger objectif et la gravité attendue en cas de chute.
L’escalade devient un risque « raisonnable », acceptable parce que chiffré, encadré, et compatible avec les exigences d’une société qui tolère le risque à condition qu’il soit géré.
Danger choisi, danger subi
Pour Beck comme pour d’autres sociologues, une des grandes fractures du monde contemporain tient à la différence entre les risques que l’on subit et ceux que l’on choisit. Les premiers sont diffus, invisibles, globaux : particules fines, pesticides, perturbations climatiques, volatilité financière. Ils traversent notre existence sans qu’on puisse les pointer du doigt, ils s’étendent bien au-delà de notre zone de contrôle. Les seconds sont localisés, concrets, momentanés : sauter à l’élastique, surfer une grosse houle, rouler trop vite, jouer en bourse… ou monter à 12 mètres sur un mur.
La société du risque moderne se structure précisément autour de cette ambivalence : nous vivons dans un univers saturé de dangers abstraits que nous ne maîtrisons pas, tout en développant des espaces très codés où l’on peut, au contraire, expérimenter un danger hyper-localisé que l’on estime contrôler. L’escalade s’inscrit pleinement dans cette seconde catégorie.
Les fédérations, les organismes internationaux, les assureurs, les exploitants de salles forment ensemble un dispositif qui transforme un danger en risque acceptable – et donc commercialisable.
Les grimpeur·ses se racontent volontiers une histoire rassurante : ici, au moins, le risque est visible. On sait où il se trouve (la hauteur, le rocher, la prise douteuse, le mousqueton mal verrouillé), on peut s’y préparer, se former, s’équiper. On apprend à faire son nœud, à vérifier l’encordement, à placer une protection, à lire une voie. On répète des rituels de sécurité, on fait des « checks », on suit des cours, on passe des tests d’assurage. L’idée sous-jacente est simple : le danger existe, mais il obéit à des règles.
Cette narration touche un point nerveux de la société du risque : la quête d’un danger qui resterait, malgré tout, maîtrisable. Dans un monde où l’on ne contrôle ni la fonte des glaciers ni les marchés financiers, l’escalade apparaît comme un territoire où l’on peut au moins décider de la voie que l’on tente, du niveau d’engagement, du partenaire avec lequel on grimpe. On ne supprime pas le risque, on le requalifie comme « risque choisi », au nom d’un bénéfice clair : la sensation d’intensité, le sentiment d’exister, la construction d’un récit de soi.
Cette distinction entre risque subi et risque choisi explique aussi pourquoi de nombreuses personnes qui se déclarent « anxieuses » face à l’actualité globale acceptent paradoxalement de se mettre sciemment en danger sur une paroi. Ce n’est pas de l'inconséquence, c’est, d’une certaine façon, une stratégie psychique : déplacer l’angoisse vers un espace concret, limité, dans lequel l’effort, la technique et l’attention semblent pouvoir faire la différence.
La salle, usine à fabriquer du risque acceptable
Regardons de près une salle d’escalade moderne : c’est un petit condensé de société du risque. À l’accueil, on signe la fameuse décharge de responsabilité. On y lit, en substance, que la pratique comporte des risques graves, que l’exploitant ne peut pas tout maîtriser, que chacun grimpe sous sa propre responsabilité. Cet acte, d’apparence purement administrative, est typique de la logique décrite par Beck : le risque est identifié, énoncé, contractualisé, partiellement transféré à l’individu via un geste juridique.
Sur les murs, la surface dangereuse est soigneusement organisée : hauteur limitée, angles cassés, volumes dessinés pour éviter les pièges mortels, tapis en mousse certifiée, dégaines rapprochées, points d’ancrage contrôlés, auto-assureurs inspectés. Des panneaux rappellent les règles de bonne conduite, parfois accompagnés de pictogrammes pédagogiques : ne pas courir sur les tapis, ne pas grimper sur la voie d'à côté, ne pas traverser sous quelqu’un.
Les ouvreur·ses payent parfois physiquement le prix de cette industrialisation du risque « acceptable ». Travailler suspendu des heures sur corde, manipuler des volumes lourds, évoluer dans des environnements semi-publics avec du passage, c’est exposer son corps à des dangers structurels que le/la client·e final·e ne perçoit pas toujours.
Dans la plupart des salles, on ne peut pas assurer un·e partenaire sans avoir passé un test de validation. On vérifie le type de système d’assurage utilisé, on impose des gestes standardisés, on refuse de laisser grimper quelqu’un qui ne respecte pas ces protocoles. On organise des sessions de sensibilisation, on diffuse des vidéos « bonnes pratiques » pour inciter à la prudence.
Tout cela n’est pas seulement de la « sécurité » au sens pratique du terme. C’est une véritable infrastructure de gestion du risque, parfaitement alignée avec la logique décrite par Beck : rendre le danger prévisible, calculable, compatible avec les attentes des assurances, des pouvoirs publics, des parents qui laissent leurs enfants grimper. Les fédérations, les organismes internationaux, les assureurs, les exploitants de salles forment ensemble un dispositif qui transforme un danger en risque acceptable – et donc commercialisable.
De ce point de vue, la salle n’est pas un espace en dehors de la société du risque, mais l’une de ses expressions les plus visibles : chaque prise vissée dans le mur, chaque consigne de sécurité, chaque harnais contrôlé participe à une gigantesque opération de traduction du danger en probabilité supportable.
Accidents et boomerang
Bien sûr, tout cela n’empêche pas les accidents. Les rapports d’incidents des clubs comme des fédérations montrent, année après année, les mêmes mécanismes : erreurs d’assurage, incompréhensions entre binômes, mauvaise manipulation d’auto-assureurs, sous-estimation de la hauteur de chute en bloc.
Les auto-assureurs, en particulier, constituent un symbole presque caricatural de la société du risque : un dispositif conçu pour réduire le danger (supprimer le facteur « assureur inattentif ») introduit de nouveaux scénarios catastrophiques (oubli de se clipper, fausse impression de sécurité). Le secteur des salles de grimpe a connu plusieurs accidents graves, voire mortels, liés à ces appareils, au point que la fédération a publié des recommandations spécifiques après une série d’incidents jugés préoccupants.
Dans la perspective de la société du risque, cette figure du free solo n’est pas un simple délire marginal. Elle fonctionne comme miroir extrême d’une époque qui tente, partout, de domestiquer la dangerosité.
Beck parle, à propos des risques modernes, d’un « effet boomerang » : ceux qui produisent ou gèrent le risque finissent tôt ou tard exposés à ses conséquences. Dans l’escalade, on voit bien ce mécanisme à l’œuvre. Les salles qui misent sur un équipements massif en auto-assureurs pour attirer des publics débutants et fluidifier l’exploitation se retrouvent, en cas d’accident, en première ligne médiatique, juridique et économique. Les constructeurs de matériel, les assureurs, les fédérations également. L’incident d’un individu devient affaire de filière.
Les ouvreur·ses payent parfois physiquement le prix de cette industrialisation du risque « acceptable ». Travailler suspendu des heures sur corde, manipuler des volumes lourds, évoluer dans des environnements semi-publics avec du passage, c’est exposer son corps à des dangers structurels que le/la client·e final·e ne perçoit pas toujours. Là encore, la question de qui encaisse effectivement le risque – et qui encaisse la valeur produite par la pratique – rejoint la trame analysée par Beck dans d’autres domaines : le risque n’est pas seulement une affaire individuelle, il est socialement distribué.
L’acceptation du danger par les pratiquant·es se nourrit en partie de l’illusion que tout cela est « sous contrôle ». Les accidents rappellent régulièrement que ce contrôle a des failles, et que la vieille phrase de l’alpinisme traditionnel – « le risque zéro n’existe pas » – reste vraie, même dans un univers bardé de normes et de procédures.
Le spectre du risque total
À l’autre bout du spectre, il y a l’image qui hante autant qu’elle fascine : celle du grimpeur ou de la grimpeuse en free solo, sans corde, sur une paroi verticale où la moindre erreur serait fatale. Le succès mondial du film Free Solo (Oscar du meilleur documentaire en 2019, ndlr), retraçant l’ascension d’El Capitan par Alex Honnold, a projeté ce type de pratique à la une des écrans et des imaginaires.
Dans la perspective de la société du risque, cette figure du free solo n’est pas un simple délire marginal. Elle fonctionne comme miroir extrême d’une époque qui tente, partout, de domestiquer la dangerosité. Là où la majorité des pratiquants s’inscrivent dans un régime de risque sécurisé, calculé, contractualisé, le free solo exhibe la version sans concession du danger : pas de tapis, pas de dégaines, pas d’assureur, pas de corde, pas de marge d’erreur.
On pourrait croire que cette radicalité contredit la logique de Beck, comme un retour archaïque à un rapport primitif au danger. En réalité, elle lui est profondément liée. Car si ces exploits nous fascinent, c’est justement parce qu’ils se donnent à voir sur fond de société hyper-sécurisée. Plus notre quotidien est balisé par des ceintures de sécurité, des airbags, des normes, des check-lists, plus la vision d’un corps « nu » face à la paroi surgit comme une transgression absolue. Le free solo devient une sorte de contre-point spectaculaire à la promesse de sécurité généralisée.
Il y a d’ailleurs quelque chose de profondément contemporain dans la façon dont ces exploits sont produits, filmés, diffusés. L’ascension d’El Capitan par Honnold est à la fois une performance individuelle extrême et un dispositif médiatique parfaitement calibré : équipe de tournage, sponsoring, narration, diffusion mondiale, récompense aux Oscars. La prise de risque radicale d’un individu s’inscrit dans un écosystème technique, économique et symbolique qui relève pleinement de la modernité réflexive : on mesure, on documente, on discute publiquement de la « rationalité » de ce choix de vie.
Entre la salle de bloc surprotégée et le big wall en solo intégral, entre la couenne sportive à spits rapprochés et la fissure trad engagée, c’est tout un spectre d’acceptation du danger qui se dessine. Ce spectre n’est pas seulement technique, il est culturel : chaque sous-communauté de la grimpe produit ses normes implicites de ce qui est « normal » de faire ou non, de ce qui est vu comme courage, comme excès, comme inconscience.
Pourquoi accepte-t-on le danger ?
À ce stade, la question initiale peut se reformuler : dans une société qui valorise la sécurité, pourquoi autant de personnes trouvent-elles raisonnable, voire souhaitable, d’aller grimper sur des parois où la chute peut faire mal ?
Une première réponse tient à la comparaison implicite que chacun fait, souvent sans le formuler : l’escalade est perçue comme un risque faible pour un bénéfice élevé. D’un côté, la majorité des séances se déroulent sans incident majeur, surtout en salle ; de l’autre, le plaisir ressenti – sentiment d’intensité, d’absorption, d’appartenance à une communauté, d’accomplissement physique – est immédiat. Et encore une fois, des études statistiques qui montrent que le taux de blessure grave par heure d’escalade indoor est plus bas que dans beaucoup d’autres sports confortent ce sentiment.
Nous faisons confiance aux tapis, aux cordes, aux normes, aux assureurs, aux parois en contreplaqué, de la même manière que nous faisons confiance aux pilotes d’avion, aux ingénieur·es du nucléaire ou aux algorithmes de nos assurances santé.
Une deuxième réponse tient à la distinction entre danger visible et danger invisible. Dans la hiérarchie intime des peurs contemporaines, nombre de personnes redoutent davantage un diagnostic médical, un licenciement, une crise climatique ou une guerre lointaine que la perspective de chuter sur un tapis ou au bout d’une corde dynamique. Là encore, le risque que l’on peut voir, toucher, anticiper, semble plus supportable que celui qui flotte dans l’horizon global.
Une troisième réponse, plus inconfortable, touche au narcissisme contemporain. Dans un univers saturé d’images, la capacité à se montrer comme personne capable de « gérer le danger » devient une forme de capital symbolique. Poster une vidéo sur un bloc engagé, raconter sa première chute en tête, exhiber une cicatrice, deviennent des micro-récits identitaires : preuve qu’on n’est pas seulement un·e individu·e statistiquement exposé·e aux risques abstraits du monde, mais quelqu’un·e qui a choisi de les affronter à sa manière.
Enfin, une quatrième réponse renvoie à la quête de sens. La société du risque ne produit pas seulement des angoisses, elle produit aussi un sentiment d’absurde : pourquoi rester sagement assis dans un monde où l’on peut, de toute façon, être frappé·e par une catastrophe globale qu’on n’aura ni vue venir ni pu stopper ? L’escalade offre une forme de contre-proposition : mettre son corps en jeu, ici et maintenant, sur un défi dont les paramètres sont tangibles. Pour beaucoup, cette mise en danger volontaire devient une manière de reprendre la main sur une existence perçue comme largement déterminée par des forces extérieures.
Ce que cela dit de nous
Regarder l’escalade à travers Ulrich Beck, ce n’est pas faire de la sociologie de salon, c’est accepter de lire dans notre manière de grimper un symptôme plus large de notre époque. Nous acceptons le danger en escalade parce que nous avons appris, collectivement, à préférer les risques que l’on peut cadrer à ceux que l’on subit passivement. Nous faisons confiance aux tapis, aux cordes, aux normes, aux assureur·es, aux parois en contreplaqué, de la même manière que nous faisons confiance aux pilotes d’avion, aux ingénieur·es du nucléaire ou aux algorithmes de nos assurances santé.
Mais cette confiance a un prix : elle nous habitue à l’idée que tout danger peut – et doit – être maîtrisé, chiffré, absorbé. Or l’escalade, précisément, dément régulièrement cette illusion. Un mauvais clippage, un rocher qui casse, un moment d’inattention, et le réel s’invite brutalement dans l’espace pourtant saturé de procédures.
Dans ce décalage entre danger maîtrisé et danger réel, il y a toute l’ambivalence de la société du risque. Grimper, aujourd’hui, c’est jouer avec cette ambivalence. C’est jouir d’un risque suffisamment encadré pour rester socialement acceptable, tout en flirtant avec la possibilité qu’il déraille. C’est se raconter qu’on maîtrise, tout en sachant très bien qu’une part du jeu nous échappe.
Reste une dernière question, peut-être la plus essentielle : que fait-on de cette lucidité ? On peut continuer à consommer du danger comme on consomme un loisir encadré, en confiant au système le soin de nous protéger « au maximum ». On peut, à l’inverse, se réfugier dans une quête illusoire du zéro risque, qui ne fera que déplacer l’angoisse vers d’autres zones.
Ou bien on peut essayer autre chose : habiter la grimpe comme un espace de responsabilité partagée. Prendre au sérieux les statistiques, les retours d’expérience, les alertes sur les auto-assureurs. Former les nouveaux, questionner les pratiques, accepter de renoncer parfois à une tentative trop hasardeuse. Refuser à la fois la naïveté du « ça passe » et le cynisme du « tant pis ».
La société du risque, disait Beck, ne nous condamne pas à vivre dans la peur, mais à vivre dans la conscience. L’escalade, à sa manière, nous propose le même contrat : accepter le danger, oui, mais à condition d’ouvrir les yeux sur ce que nous faisons réellement quand nous passons la corde dans le pontet de notre baudrier. Ce n’est pas se prendre pour des héros, ni pour des victimes, c’est être des citoyen·nes lucides d’un monde où l’on ne grimpe jamais seulement sur du rocher ou du bois, mais aussi sur une montagne de choix collectifs, de normes, de récits et de risques partagés.