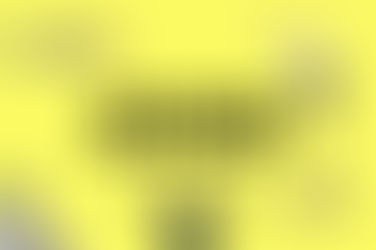Deux ascensions remettent Gaza au sommet des conversations
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 12 nov. 2025
- 3 min de lecture
Au Colorado (États-Unis) puis à Java (Indonésie) : en quelques jours, deux actions spectaculaires rappellent — n’en déplaise à celles et ceux qui somment de « laisser la montagne tranquille » — qu’une paroi n’est plus seulement un décor, c’est aussi un média.

Alors que l’attention internationale portée à Gaza se relâche au gré d’annonces de cessez-le-feu et de bilans qui descendent en bas de page, des grimpeur·euse·s choisissent la verticalité pour rappeler que le conflit n’est pas clos. À Golden (Colorado, États-Unis), une bannière « Stop the Genocide » surgit au-dessus d’un secteur très fréquenté. Sur le mont Raung (Java, Indonésie), une expédition plante côte à côte les drapeaux indonésien et palestinien. Deux gestes courts, impeccablement visibles, qui font remonter le sujet en haut des fils d’actualité — et des conversations.
Deux gestes, une scène mondiale
Le 9 novembre 2025, au secteur Canal Zone (Clear Creek Canyon), huit personnes suspendent une bannière « Stop the Genocide » d’environ 7,5 m × 3 m — la même toile déjà utilisée sur El Capitan en 2024. L’installation est annoncée « réversible » : pas de perçage, temps court (environ deux heures), retrait immédiat. Le porte-voix du groupe, Parker Schiffer, enseignant et grimpeur, assume une stratégie de visibilité ordinaire : installer le message sur un axe routier où passent automobilistes, cyclistes et grimpeur·euse·s, autrement dit un public mixte et non captif. Le pari est simple : rappeler plutôt que convaincre, remettre un sujet à hauteur de regard dans un moment de relâchement médiatique.
Le 11 novembre 2025, l’expédition « 1,000 Mountain Climbers for Palestine » atteint le mont Raung (3 344 m) et tient une brève cérémonie : lecture d’un texte de soutien, drapeaux indonésien et palestinien plantés côte à côte, images reprises par la presse locale. L’action s’inscrit dans le Bulan Solidaritas Palestina 2025 (Mois de solidarité avec la Palestine), coordonné par des organisations indonésiennes de sensibilisation et de collecte — dont l’Aqsa Working Group, réseau associatif très implanté. À la clé : pédagogie (expliquer, contextualiser, ritualiser) et levée de fonds (notamment pour un projet d’hôpital mère-enfant à Gaza), avec des images pensées pour une large circulation nationale.
Ce qui relie Golden et le Raung dépasse la géographie : dans les deux cas, la hauteur sert d’outil de récit. Une falaise de bord de route et un volcan n’ont pas la même symbolique, mais ils partagent une propriété rare : transformer un message en image immédiatement lisible, facile à relayer, qui déborde le seul milieu de la grimpe.
Pourquoi maintenant ?
D’abord, le moment. Une trêve, même partielle, ralentit la couverture sans éteindre la crise. L’agenda médiatique se réorganise, l’actualité « chaude » se déplace, et ce déplacement produit un angle mort : on sait que « quelque chose » se joue encore, sans le voir. Ces actions s’attaquent précisément à ce vide : elles réinjectent de la présence — non par la démonstration sportive, mais par l’évidence visuelle.
Ensuite, les publics. Aux États-Unis, la bannière de Golden vise le quotidien : on passe dessous, on photographie, on débat, parfois on s’agace — mais on re-met des mots sur un sujet qu’on croyait « en pause ». En Indonésie, où la solidarité pro-palestinienne est massive et durable, la séquence du Raung fonctionne comme un rite civique : elle agrège associations, médias et donateur·rice·s, et s’inscrit dans un calendrier national de soutien. Deux dramaturgies très différentes, une même fonction : maintenir la visibilité.
Enfin, la forme. Là où la montagne se politise, la réversibilité devient la ligne de crête : temps court, aucune trace, pas d’entrave durable aux autres usager·ère·s. Cette hygiène d’intervention n’est pas un détail. C’est une condition d’acceptabilité dans des milieux où l’accès se négocie (écologie, foncier, capacité d’accueil). Elle distingue une action qui ajoute du sens d’un coup d’éclat qui fabrique une réaction hostile.
Ce que ces gestes disent de la montagne — et de nous
La montagne n’a jamais été neutre : elle est traversée par des arbitrages (accès, biodiversité, tourisme), des récits (héros, tragédies, conquêtes) et des prises de position. La nouveauté n’est donc pas la politisation, mais le mode opératoire : des gestes brefs, soignés, contextualisés, conçus pour vivre autant sur place que dans l’économie des images. C’est là que la grimpe joue un rôle spécifique : elle offre trois atouts logistiques — hauteur, lisibilité, compacité — à condition d’assumer trois devoirs : respect du lieu, des autres, des règles locales.
On peut discuter de l’opportunité — certain·e·s continueront de dire « la montagne, c’est le refuge, laissez-la tranquille ». On peut aussi constater que ces actions n’usent pas ce refuge. Elles l’empruntent pour signaler : « ce n’est pas terminé ». Dans un paysage saturé de discours, l’ascension — brève, propre, assumée — devient pointeur : elle ne clôt rien, elle désigne ce qu’on s’apprêtait à ne plus voir.