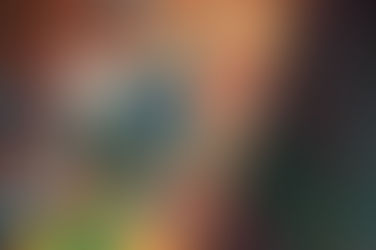La grimpe torse nu : symbole du manque d'inclusivité des salles d'escalade françaises
- Matthieu Amaré

- 27 nov. 2025
- 12 min de lecture
Un collectif anonyme de grimpeur·ses vient de publier la première enquête française sur l'interdiction du torse nu dans les salles d'escalade. Au-delà de la question vestimentaire, leurs données révèlent les mécanismes invisibles de l'appropriation masculine de l'espace sportif. Entre témoignages de terrain, décryptage sociologique et voix de grimpeurs masculins, plongée dans un débat qui cristallise toutes les tensions autour de l'inclusivité. Mais qui pourrait aussi tirer les structures vers le haut.

Un mardi soir de juin, 19h30. La chaleur colle aux murs de la salle d'escalade. Au pied d'une voie, un grimpeur retire son t-shirt avant de s'encorder. Suée, poussière de magnésie, cris d'encouragement, allez. Le grimpeur chute, recommence, hurle sa frustration. Son assureur le réceptionne en criant - « Solide frérot ! » - avant de lui mettre une grande claque dans le dos. Quelques mètres plus loin, une grimpeuse observe la scène en silence. Elle ne dit rien, mais quelque chose dans sa posture trahit un malaise diffus.
La scène est fictive et pourtant bien fidèle aux innombrables témoignages de grimpeur·ses gêné·e·s par les hommes à demi-nu qui évoluent dans les salles d'escalade françaises. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les conversations d'après séance, au sein de plusieurs articles, l'escalade torse nu et sa régulation alimentent de plus en plus les conversations autour de sa pratique en intérieur. Depuis le 25 novembre dernier, le sujet vient même de faire l'objet d'une enquête chiffrée, documentée et largement sourcée. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des minorités de genre, un collectif anonyme de grimpeur·ses a publié une enquête menée auprès de 30 salles d'escalade françaises, associée à une tentative de faire un état des lieux des réflexions sur l'inclusivité dans le monde de l'escalade.
À l'arrêt de buste
L'histoire commence par une frustration. À partir de 2023, plusieurs grimpeur·ses multiplient les démarches contre la grimpe torse nu auprès de leur salle située dans l'Est de la France. Cela commence par des mails répétés et se solde par une pétition, lancée en juin 2023, qui recueille à ce jour 69 signatures. Depuis lors, la direction répond poliment mais n'agit pas. « Ils nous expliquaient que le sujet les intéressait, qu'ils se posaient des questions, en repoussant systématiquement le moment de prendre des actions », raconte à Vertige Media l'une des membres du collectif. Ces dernier·es, « une poignée de personnes sexisées » , souhaitent garder l'anonymat et communiquent notamment depuis le compte Instagram @gardetontop. C'est face à l'inertie de leur salle d'escalade que le collectif décide de se lancer dans une enquête ainsi que le recueil de ressources et de données. Le groupe le martèle - au téléphone, en préambule -, il ne rend pas compte d'un travail scientifique mais d'une tentative de « voir ce qui se faisait ailleurs » en essayant de « centraliser toutes les ressources publiées sur le sujet ». Il n'empêche, la démarche bénévole est substantielle et inédite en France. Entre janvier et mars 2025, le collectif contacte près de 70 structures avec un questionnaire sur les mesures concernant la grimpe torse nu mais aussi d'autres points comme la disposition de protections hygiéniques ou le nombre d'ouvreuses et de monitrices employées dans la salle. La grande majorité se dit intéressée, 30 répondent véritablement. Parmi elles : toutes appartiennent à des grands réseaux de salles comme Arkose, Climb Up ou Block'Out, sauf une.
« Quand vous pénétrez dans une salle, regardez où sont les hommes. Vous verrez qu'ils sur-investissent le dévers, les voies dures et physiques »
Aurélia Mardon, sociologue.
Il en ressort que 70% des salles qui ont répondu interdisent la grimpe torse nu. Placée en regard des 300 salles privées de l'Hexagone et du millier de Structures Artificielles d'Escalade (SAE) d'intérieur, cela peut paraître peu représentatif. Néanmoins, l'enquête du collectif et le croisement des données qu'elle propose donnent quelques enseignements. Le plus marquant étant la tendance de corrélation entre l'interdiction de la grimpe torse nu des salles et la présence dans leur staff de monitrices ou d'ouvreuses. Dit autrement : il semblerait que plus les femmes sont représentées dans le personnel des salles d'escalade – surtout à des postes techniques – plus les mesures d'inclusivité sont importantes. Ce postulat projette le rapport dans un champ sociologique qu'elle mobilise d'ailleurs largement. À la faveur de travaux académiques et d'articles scientifiques, le document du collectif fait éclabousser une théorie : une salle qui interdit le torse nu n'est pas juste une salle qui pose une règle vestimentaire. C'est souvent une salle qui a pensé l'inclusivité de façon systémique.
Une sacrée paire de manches
Si la question du t-shirt fait autant débat dans l'escalade, c'est parce que la question de la politisation du corps lui préexiste. Dans tous les espaces publics, et a fortiori dans les lieux où il est plus visible, le corps est traversé par des questions sociales, culturelles et politiques. Pour comprendre, il faut d'abord se pencher sur les travaux de Judith Butler, précisément ceux publiés dans son ouvrage publié en 1990, Trouble dans le genre . Selon la philosophe américaine, le genre n'est pas une essence biologique, mais une performance répétée. Chaque geste corporel réitère des normes sociales ou les subvertit. En clair, d'après elle, le corps n'est jamais neutre. Il est toujours pris dans un réseau de significations. Enlever son t-shirt n'est donc pas un geste « naturel » dicté par la chaleur ou le confort : c'est un rituel genré qui produit des effets sociaux radicalement différents selon celui ou celle qui le fait.
Pour les hommes cisgenres, le torse nu en salle d'escalade évoque volontiers la liberté, le relâchement, parfois une forme de virilité assumée. C'est un geste anodin, sportif, fonctionnel. Pour les femmes, le même geste reste un acte transgressif, potentiellement réprimé. Cette asymétrie s'ancre d'abord dans le droit : un homme torse nu est autorisé partout – sous réserve des règlements intérieurs privés. Une femme torse nue peut théoriquement être accusée d'exhibition sexuelle selon l'article 222-32 du Code pénal. Dans certaines enceintes sportives et privées, la loi autorise techniquement les femmes à être torse nues. Mais dans les faits, le risque d'agressions, de regards sexualisants et de remarques déplacées rend cette « égalité formelle » inopérante.
« Dans notre salle ils sont beaucoup, ils prennent de la place de manière physique et sonore. Plusieurs grimpeur·ses nous confient leur malaise face au contact visuel, aux odeurs aussi parfois »
Membre du collectif @gardetontop
Au bout du fil, notre interlocutrice membre de @gardetontop abonde : « Même si, théoriquement, nous autoriser à être torse nu serait une forme d'égalité, on vivrait des violences que les hommes ne vivent pas. Si vraiment il fallait qu'on soit égaux, il faudrait aussi que les salles d'escalade garantissent notre sécurité et notre sentiment de sécurité ». Comprendre : si le torse masculin est vu comme neutre, celui des femmes est sexualisé par défaut. Pour Aurélia Mardon, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Lille, cette différence de traitement révèle une conception profondément genrée de la visibilité corporelle. Celle-ci ne se limite pas au droit : elle imprègne les interactions sociales quotidiennes. La sociologue, qui a publié en 2024 un ouvrage intitulé Prendre de la hauteur - Escalade en salle et fabrique du genre à l'adolescence (Presses Universitaires de Lyon, 224p.), a aussi grimpé pendant 25 ans. Dans sa pratique et lors de ses enquêtes de terrain, elle témoigne d'un investissement imposant de la présence physique des hommes au sein des salles d'escalade. « Quand vous pénétrez dans une salle, regardez où sont les hommes, apostrophe-t-elle. Vous verrez qu'ils sur-investissent le dévers, les voies dures et physiques. » Aurélia Mardon précise que souvent, le torse nu masculin s'accompagne d'autres formes d'occupation de l'espace : des cris pour célébrer une réussite, des expressions sonores de frustrations... D'après nos interlocutrices, ces comportements créent des dynamiques spatiales très concrètes. La « performativité du genre » qu'introduit Judith Butler dans ses travaux éclaire alors ce mécanisme : le torse nu masculin devient un acte performatif qui réaffirme la masculinité hégémonique.
Hard corps
Le collectif @gardetontop le partage crûment : « Dans notre salle ils sont beaucoup, ils prennent de la place de manière physique et sonore. Plusieurs grimpeur·ses nous confient leur malaise face au contact visuel, aux odeurs aussi parfois ». Leur enquête le précise : ces comportements ne sont pas nécessairement conscients ou malveillants. Mais ils produisent un effet cumulatif : les grimpeur·ses interrogé·e·s parlent d'un sentiment de « ne pas être bienvenue », de « se faire petit », de « raser les murs ». Aurélia Mardon nomme ce phénomène « l'appropriation masculine de la pratique ». Se mettre torse nu, ce serait marquer son territoire, signifier qu'on est chez soi. Souvent spectatrices, les femmes victimes de cette appropriation traversent l'espace mais ne l'habitent jamais.
Cette appropriation repose sur ce qu'Aurélia Mardon appelle aussi la « neutralité supposée du genre », un mythe tenace dans l'escalade. Selon la sociologue, la grimpe se pense souvent comme un sport technique, mixte, où la force brute compte moins que dans d'autres disciplines. « Et pourtant, se rejouent des logiques de discrimination », insiste-t-elle. Dans Prendre de la hauteur, l'universitaire montre que les compétences sont valorisées différemment selon le genre : la force est associée aux garçons, la technique et la prudence aux filles. La grimpe torse nu réaffirme cette hiérarchie : c'est l'exhibition de la force physique, du muscle, de la légitimité corporelle. « C'est la raison pour laquelle l'enquête de ce collectif est importante, continue-t-elle. C'est un point de vue situé. C'est parce que les femmes font l'objet d'un regard sexualisé qu'elles sont capables de montrer qu'il y a une inégalité de traitement entre le corps des hommes et des femmes. » Les auteur·ices de l'enquête ne disent pas autre chose. Pour eux/elles, « les hommes cisgenres, blancs et socialement privilégiés, que l'on retrouve majoritairement parmi les pratiquant·e·s d'escalade, ne voient pas le sexisme parce qu'ils ne l'ont jamais subi ». Selon les enseignements de Judith Butler, l'expérience du genre masculin devient la norme invisible et donc « neutre à leurs yeux ». Le torse nu masculin bénéficie de cette invisibilité du privilège.
Ce que pensent les hommes
Face à des mécanismes qu'ils ne conscientisent pas toujours et des inégalités qu'ils n'ont pas vécues, comment les hommes, et plus précisément ceux qui grimpent torse nu, ressentent la question ? Pas forcément très bien. De tous ceux que Vertige Media a interrogés, tous souhaitent garder l'anonymat, exprimant souvent un « débat sur-investi et passionné ». Reste que la plupart expliquent ôter leur t-shirt pour des raisons, liées selon eux, à la culture de la grimpe. Un grimpeur nous indique par exemple que les toutes premières images de grimpeurs sur les blocs de Fontainebleau, comme celles de Pierre Allain dans les années 40, s'affichaient déjà torse-nu. Idem pour les premiers grimpeurs d'artif' dans le Yosemite dans les années 70. Certains parlent d'un « effet plage » associé à l'habitude, au confort et à la liberté sensorielle de grimper torse nu. D'autres associent l'absence du t-shirt à un rituel de performance. « Enlever son t-shirt, c'est engager un corps-à-corps avec la voie, partage un grimpeur. Quand je m'apprête à faire un essai dans une voie dure, garder mon t-shirt signifierait que je ne suis pas tout à fait sincère, que je ne me suis pas donné à fond. » Ce dernier file d'ailleurs la métaphore du boxeur qui retire son peignoir avant de rentrer sur le ring.
« Je comprends qu'une salle pleine de gens torse nu puisse faire effet de repoussoir pour quelqu'un de débutant, et pas forcément très à l'aise avec son corps. Généralement, ce sont les grimpeurs forts qui se mettent torse nu. Cela crée forcément un entre-soi. Et dans certaines salles où ce n'est pas interdit, j'ai déjà entendu des gens les montrer en disant : "Regarde c'est les grimpeurs torse nu qui se la pètent" »
Un grimpeur qui pratique torse nu
Beaucoup d'entre eux reconnaissent toutefois un effet intimidant. « Je comprends qu'une salle pleine de gens torse nu puisse faire effet de repoussoir pour quelqu'un de débutant, et pas forcément très à l'aise avec son corps, partage un autre grimpeur. Généralement, ce sont les grimpeurs forts qui se mettent torse nu. Cela crée forcément un entre-soi. Et dans certaines salles où ce n'est pas interdit, j'ai déjà entendu des gens les montrer en disant : "Regarde c'est les grimpeurs torse nu qui se la pètent". » Pour Aurélia Mardon, ces arguments ne tiennent pas. Que ces derniers convoquent la culture grimpe ne change finalement pas grand-chose, « l'histoire de l'escalade est avant tout masculine », souffle-t-elle. Pire, ou mieux, c'est selon, l'argument du confort confirme, selon elle, les dominations à l'oeuvre – conscientisée ou pas. « Une femme qui dirait : "J'ai chaud, j'enlève mon t-shirt" dans une salle serait immédiatement sexualisée, victime de ce qu'on appelle le male gaze (concept critique pour décrire le regard masculin, ndlr). L'asymétrie du confort est aussi une asymétrie de pouvoir. »
Le sujet du port du t-shirt en escalade n'est pas nouveau. Ces dernières années, plusieurs personnalités assez influentes dans le milieu de l'escalade partagent des témoignages gênés de grimpeuses, sensibilisent aux formes de domination que la démarche exprime voire mènent des actions visibles pour faire éclabousser la problématique. En 2023, l'influenceuse Sophie Berthe relance la question lors d'un évènement réputé, le Master of Fire à Bruxelles. Des grimpeur·ses gravissent les parois, le dos peint d'une inscription au feutre : « Ceci est un torse ». À cette occasion, la grimpeuse publie un manifeste où elle appelle les salles d'escalade à adopter des chartes contre les violences sexistes et sexuelles. L'initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de féminisation et de sécurisation des espaces d'escalade. Charline Vermont – @orgasme_et_moi sur Instagram – travaille sur le female gaze dans la grimpe. Girls in Bleau crée des espaces de pratique non-mixte pour permettre aux grimpeuses de se sentir légitimes sans le regard masculin. Soline Kentzel, Caroline Sinno, et d'autres militantes anonymes alimentent cette dynamique.
En 2025, le sujet de la grimpe torse nu est largement documenté, comme en témoigne la longue liste de références que convoque le collectif @gardetontop dans leur enquête. Alors, pourquoi cette résistance de la part de certaines directions de salles et grimpeurs masculins ? « Moi, je pense que quand tu es une personne qui vit peu d'oppression, c'est dur de se représenter ce que ça fait, commente une des membres du collectif anonyme. Je pense aussi qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que ça les embête qu'on leur demande de se restreindre. Pour eux, c'est une perte de liberté. Du coup, c'est plus facile de ne pas voir le problème. » Depuis sa lorgnette de sociologue, Aurélia Mardon identifie quant à elle deux facteurs de résistance. D'abord, la défense consciente de privilèges masculins. Ensuite, l'ancrage profond de la socialisation genrée : « Nos identités de genre sont liées à des socialisations, dit-elle. C'est nos manières de penser, de voir, de sentir. Notre rapport au genre, c'est avant tout une construction sociale. Pour beaucoup d'hommes, grimper torse nu fait partie de leur identité de grimpeur, de leur masculinité incorporée. Y renoncer, ce n'est pas juste remettre un t-shirt. C'est accepter de remettre en question une part de ce qu'ils croient être leur nature. Et c'est inconfortable. »
Le futur de la conquête spatiale
Forte de plusieurs analyses consacrées à la présence des femmes dans l'espace public, la revue française des Cahiers du développement urbain mobilise souvent le concept de justice spatiale, largement étudié par la sociologie. Ce dernier est décrit comme la redistribution équitable de l'usage et de l'occupation des espaces. Transposée aux salles d'escalade, la justice spatiale, en interdisant le torse nu, ne signifie pas brimer la liberté de quelques-uns. Il s'agit de permettre à tout le monde de grimper sans se sentir de trop. Et d'empêcher les dominations implicites – virilité imposée, regards pesants – et protéger les corps vulnérables.
« Il serait faux de croire qu'on va atteindre l'égalité en laissant les choses se faire. Quand on laisse la mixité s'organiser toute seule, elle va s'organiser au détriment de certains et à l'avantage d'autres. Donc il faut poser des règles »
Aurélia Mardon, sociologue.
Reste la question sur la manière de faire justice. Comment transformer les pratiques sans tomber dans l'autoritarisme moralisateur ? Comment faire comprendre à des grimpeurs de bonne foi que leur confort individuel participe d'un système d'exclusion ? Aurélia Mardon est catégorique : la pédagogie seule ne suffit pas. « Il serait faux de croire qu'on va atteindre l'égalité en laissant les choses se faire. Quand on laisse la mixité s'organiser toute seule, elle va s'organiser au détriment de certains et à l'avantage d'autres. Donc il faut poser des règles », affirme-t-elle.
Certains concepts issus des études sur les espaces publics parlent de « régulation consciente » : il ne s'agit pas seulement d'interdire, mais d'inviter chacun·e à interroger l'impact de sa présence corporelle. Concrètement quand on grimpe torse nu, quand on fait du bruit ou quand on occupe le dévers, il s'agit de se poser des questions. « Mon comportement repousse-t-il ? », « Invisibilise-t-il ? », « Comment ma présence transforme-t-elle l'espace ? ». De ce qu'elle observe dans ses travaux, Aurélia Mardon note que les manifestations bruyantes et trop visibles s'amenuisent à mesure que les salles d'escalade régulent. Si des réactions décomplexées, violentes, virilistes s'affichent encore sans honte sur Internet, la sociologue confie que la masculinité est en train de se reconfigurer. Et la plupart des grimpeurs masculins sont encore pris entre un confort qu'ils ne veulent pas abandonner et une incapacité à se représenter ce que vivent les grimpeuses.
Le collectif @gardetontop pose l'interdiction de la grimpe torse nu comme « une mesure symbolique ». Pas la seule, mais celle qui envoie un signal immédiat. Ensuite, la priorité absolue reste l'embauche d'ouvreuses et de monitrices : l'enquête montre sans ambiguïté qu'en ce qui concerne l'inclusivité de genre, c'est un facteur primordial. Voir une femme tracer des voies, donner des cours, occuper des fonctions techniques, c'est légitimer la présence féminine dans l'espace. Au-delà, il s'agit de penser les vestiaires inclusifs, de réfléchir aux tarifs pour ne pas exclure les personnes précaires, de former les équipes aux questions de sexisme, de harcèlement, de validisme, de racisme. Autant de mesures qui convergent vers un fait éprouvé : un espace n'est pas safe parce qu'il l'affirme : il le devient par des actes concrets, une équipe formée, des règles claires et une vigilance réelle. De son propre aveu, le collectif @gardetontop souhaite participer à la prise de conscience du problème en encourageant une réflexion globale sur l'inclusivité, en termes de genre mais pas que. Reste à savoir si les salles d'escalade se saisiront des réponses éprouvées, documentées et claires que leurs interlocutrices ont apportées avec leur enquête. Et si elles dépasseront la simple régulation du port du t-shirt pour se projeter dans l'ensemble des questions d'inclusivité que posent les salles d'escalade partout en France. Car le torse nu n'est pas le problème. C'est simplement le plus visible.