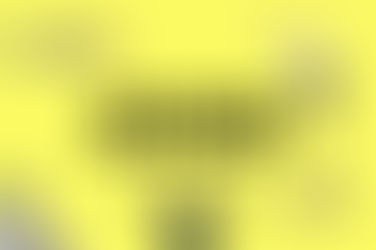Réinventer la montagne : sortir de l’or blanc
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 24 nov. 2025
- 11 min de lecture
Dans « Réinventons la montagne. Alpes 2030 : un autre imaginaire est possible » (Éditions du Faubourg), Fiona Mille, présidente de Mountain Wilderness France, dresse le portrait d'un territoire en surchauffe climatique et sociale. Entre recul des glaciers, fuite en avant vers la neige artificielle et spéculation immobilière, elle documente l'impasse d'un modèle économique fondé sur l'or blanc – et esquisse les pistes d'une réinvention possible. Un travail d'enquête qui résonne avec les constats formulés par d'autres acteurs de terrain, des rapports officiels aux initiatives locales qui tentent déjà de tracer d'autres chemins.

Quand Fiona Mille raconte son histoire, on entend en filigrane celle de la montagne française. Une famille de mineurs du Nord, l'extraction du charbon comme horizon, puis un basculement vers l'or blanc : ces décennies où l'économie des vallées s'est alignée sur le ski et la neige. Aujourd'hui, depuis Belledonne où elle vit à 1 100 m d'altitude, la présidente de Mountain Wilderness France parle d'un autre basculement : celui d'une montagne qui devient le révélateur de nos impasses climatiques et sociales, et d'un imaginaire qu'il va falloir changer plus vite que prévu. Dans un entretien vidéo publié par Reporterre le 15 novembre dernier, mené par Hervé Kempf – fondateur et directeur de la publication – dans la série « Le Monde d'après », Fiona Mille résume d'une formule ce travail à mener : « On ne part pas d'une page blanche ». Il existe déjà des initiatives, des conflits, des expériences locales qui dessinent autre chose. Encore faut-il les regarder en face.
Une montagne en surchauffe
Les données climatiques sont implacables. Selon le ministère de la Transition écologique et l’Observatoire national sur les effets du réchauffement, la température moyenne a augmenté d’environ 2 °C au cours du XXᵉ siècle dans les Alpes et les Pyrénées, contre 1,4 °C pour le reste de la France. Ce différentiel se lit à l’œil nu : manteau neigeux plus mince, pluie à la place de neige en moyenne montagne, éboulements plus fréquents, glaciers qui reculent. Une étude internationale publiée en 2025 estime que les glaciers du monde ont perdu près de 6 500 milliards de tonnes de glace entre 2000 et 2023, soit l’équivalent de trois piscines olympiques par seconde. Les Alpes figurent parmi les régions les plus touchées.
Fiona Mille insiste sur ce point : ces chiffres ne sont pas une abstraction lointaine. Ils reconfigurent déjà la manière d’habiter les vallées, l’accès à l’eau, la sécurité des versants, la saisonnalité des activités agricoles et touristiques. Dans Réinventons la montagne, elle cite les projections d’enneigement qui annoncent des hivers de plus en plus aléatoires sous 1 800 ou 2 000 m, et rappelle que maintenir coûte que coûte le modèle du ski de piste n’est pas seulement une question de goût, mais de finances publiques et d’usage des ressources.
Ces constats font écho aux observations de Baptiste Bouthier (La Revue Dessinée) et Laury-Anne Cholez (Reporterre), qui dans leur hors-série Le mal des montagnes documentent un « modèle à bout de souffle » : « La neige se raréfie, et pourtant, les investissements sont toujours plus importants », résume Baptiste Bouthier. Une « espèce d'aveuglement collectif massif » dont il ne mesurait pas « complètement la dimension avant ce travail ».
La Cour des comptes, dans un rapport publié début 2024 sur les stations de montagne face au changement climatique, arrive à une conclusion très proche : les domaines de basse et moyenne altitude n’ont aucune garantie de viabilité à moyen terme, même en cas de politique climatique ambitieuse. Les investissements dans la neige de culture peuvent retarder l’échéance, mais pas renverser la tendance. Autrement dit, les montagnes servent de thermomètre géant. Et la colonne de mercure grimpe plus vite là-haut que partout ailleurs.
La fin de la monoculture « neige »
Dans ce contexte, la réaction dominante consiste moins à changer de modèle qu’à le prolonger. Canons à neige, retenues collinaires, réseaux de neige de culture, voire « usines à neige » capables de produire de la poudreuse par températures positives : tout ce qui peut donner quelques saisons de répit est mobilisé. À Super-Besse, dans le Massif central, l’installation d’une Snow Factory a cristallisé ce mouvement : produire de la neige « à la demande » pour sécuriser l’ouverture des pistes, même en l’absence de froid durable.
Fiona Mille voit dans cette fuite en avant une forme de déni organisé. Au lieu de poser la question de fond – de quoi vivront ces territoires quand le ski de piste ne pourra plus porter l’essentiel de leur économie ? –, on investit dans des solutions qui repoussent le problème. Le parallèle avec l’histoire du charbon vient naturellement : dans les deux cas, une ressource considérée comme quasi-éternelle devient, en quelques décennies, un pari à perte.
La critique ne vient pas seulement des associations écologistes. Comme l'ont montré Bouthier et Cholez, « aujourd'hui, la montagne est exploitée via des domaines skiables qui ne bénéficient qu'aux populations les plus riches », soulignant la dimension de justice sociale souvent invisibilisée. La Cour des comptes souligne elle aussi le risque de « dépendance aux subventions » pour des domaines skiables déjà déficitaires, en particulier dans les petites stations de moyenne montagne. Les travaux menés dans le cadre du projet AdaPT Mont-Blanc, porté par l’Observatoire de l’espace Mont-Blanc, montrent que la dégradation du permafrost et le recul des glaciers déstabilisent les versants et fragilisent déjà certaines infrastructures de haute montagne. D’autres études sur les risques d’origine glaciaire dans les Alpes constatent, elles, une augmentation du nombre de structures endommagées et des coûts de maintenance de ces ouvrages.
Le débat ne se limite plus à un affrontement entre « amis du ski » et « ennemis du ski ». Il porte sur une question très concrète de hiérarchie des priorités : dans des territoires où l’on sait que les hivers seront plus courts et plus pauvres en neige, à quoi consacre-t-on l’argent public, les ressources en eau, l’énergie disponible ?
Le logement comme ligne de fracture
L’un des déplacements forts opérés par Fiona Mille consiste à troquer le mot « attractivité » contre celui d’« habitabilité ». La plupart des politiques de montagne continuent de se juger à l’aune des lits touristiques, des nuitées, des taux d’occupation. Or la question se pose de plus en plus crûment : les territoires qui accueillent les vacanciers peuvent-ils encore loger celles et ceux qui y vivent à l’année ?
Les chiffres de l’Insee sonnent comme un diagnostic. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les logements de particuliers sont désormais détenus à 75 % par des ménages multipropriétaires, largement portés par la dynamique des résidences secondaires. Dans les communes touristiques, notamment en stations de ski, ces résidences dominent très largement le parc. Une analyse publiée le mois dernier montre qu’« en montagne, deux logements sur trois sont des résidences secondaires » dans plusieurs bassins des Alpes du Sud. Autrement dit, l’immobilier se remplit, mais pas nécessairement de vie.
Chamonix en est l'illustration la plus marquante. La commune, haut lieu des sports de montagne, a décidé en 2025 d’interdire les nouvelles constructions de résidences secondaires, après avoir perdu 10 % de sa population en vingt-cinq ans. Plus de 70 % des logements y sont aujourd’hui des résidences secondaires ou des meublés touristiques. Le maire résume la situation d’une phrase : « Nous perdons notre âme à force de perdre des habitants ».
Ce que décrit Fiona Mille – les saisonniers qui ne trouvent plus à se loger, les jeunes ménages contraints à des trajets interminables, les écoles qui ferment – se vérifie dans les études statistiques comme dans les récits de terrain. Les vallées continuent d’attirer des capitaux, mais elles perdent des habitants permanents. Le risque, à terme, est celui d’un décor vide : des villages transformés en copropriétés saisonnières, animés quelques semaines par an, silencieux le reste du temps.
Là encore, l’enjeu n’est pas seulement social. Il est politique. Quand une part croissante du bâti appartient à des propriétaires absents, la capacité de décision locale se fragilise : moins de monde pour s’engager dans les associations, pour débattre des projets, pour contester ou soutenir des choix d’aménagement. La montagne devient un actif patrimonial, plus qu’un espace de vie.
JO 2030 : l’impasse sous les projecteurs
Dans ce paysage déjà fragilisé, les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 jouent le rôle d’accélérateur. Les Alpes françaises ont obtenu l’organisation de l’événement. Officiellement, il s’agira des « Jeux d’hiver les moins chers de l’histoire ». Le budget du comité d’organisation, adopté à l’automne 2025, s’élève à 2,132 milliards d’euros, dont près de 75 % de recettes privées, selon les chiffres communiqués par le COJO et relayés par la presse régionale. En coulisses, un rapport des inspections générales pointait pourtant dès 2025 un risque de déficit de plusieurs centaines de millions d’euros, malgré une contribution publique annoncée à 462 millions (État et régions).
Pour Laury-Anne Cholez, comme elle l'expliquait à Vertige Media, l'absurdité du projet saute aux yeux : « Intellectuellement, je ne comprends pas comment on peut projeter des Jeux olympiques d'hiver en 2030, dans un contexte financier comme le nôtre, au vu des coûts et surcoûts. C'est quoi l'imaginaire que ça projette ? Ça m'échappe complètement. »
Au-delà des chiffres, c’est le cadre juridique qui interroge. Un projet de loi spécifique, dit « loi olympique », a été présenté au printemps 2025 pour adapter la législation à l’événement : procédures d’urbanisme simplifiées, expropriations accélérées, voies olympiques, extensions du travail dominical, prolongation de dispositifs de vidéosurveillance algorithmique. Plusieurs ONG et élus ont dénoncé les dérogations prévues au droit de l’environnement, notamment la possibilité de contourner, pour certains aménagements, l’objectif de zéro artificialisation nette.
Dans la vallée de Briançon, des habitants réunis à l’appel de Mountain Wilderness ont déjà exprimé leur malaise : difficile de parler de « Jeux durables » quand les projets envisagés reposent sur l’extension de pistes de ski, l’aménagement de nouveaux espaces pour la neige artificielle et la transformation d’un fort historique en village olympique. Certains collectifs, comme le CAOJOP, plaident pour des solutions beaucoup plus sobres, s’appuyant sur des infrastructures existantes ailleurs en Savoie.
Fiona Mille place ces JO 2030 au cœur de sa réflexion : non pas comme un épiphénomène, mais comme un révélateur. Organiser, au milieu des années 2030, une grande fête du ski dans des Alpes déjà à +2 °C, mobiliser des milliards d’euros et une loi d’exception pour quelques semaines de compétition, c’est, de son point de vue, prolonger l’impasse plutôt que d’ouvrir le débat. La question qu’elle pose est simple : à quoi ces sommes et ces dérogations pourraient-elles servir si elles étaient orientées vers la transition des vallées ?
Vercors : un projet XXL stoppé net
Le bras de fer autour du projet de complexe touristique de Tony Parker, dans le Vercors, illustre une autre facette de cette bataille. L’ancien basketteur, via sa société Infinity Nine Mountain, portait le projet « Ananda Resort » : près de 700 lits haut de gamme, 99 appartements, commerces, séminaires, activités « indoor », le tout présenté comme un moteur pour un tourisme « quatre saisons » à Villard-de-Lans. En face, l’association Vercors Citoyen s’est structurée, a rassemblé plus de 800 adhérents, produit des arguments sur l’eau, le foncier, le trafic, l’emploi local. Le 15 septembre 2025, la préfecture a finalement rejeté la demande d’« Unité touristique nouvelle structurante », jugeant le projet « manifestement excessif » au regard des ressources disponibles et des impacts environnementaux.
Un tel refus rappelle le cas historique de Cervières, ce village documenté par La Revue Dessinée et Reporterre qui, dans les années 1970, avait réussi à refuser l'implantation d'une station de ski. Des habitants, principalement bergers et agriculteurs, avaient fait plier les aménageurs – une victoire devenue « presque inimaginable aujourd'hui », souligne le hors-série.
Cette décision ne résout pas tous les problèmes du Vercors. Mais il montre que des habitants peuvent faire bouger les lignes face à des investisseurs puissants et à des élus séduits par la promesse de « relance ». Pour Fiona Mille, ce type de victoire locale n’est pas anecdotique : il signale qu’un autre rapport de force devient possible, à condition d’argumenter sur ce qui fait l’habitabilité d’un territoire : l’accès à l’eau, la sobriété foncière, la capacité à maintenir des emplois diversifiés et pas seulement des postes saisonniers à bas salaire.
Belledonne, là où elle vit, fournit d’autres exemples : réutilisation de bâtiments collectifs plutôt que construction neuve, projets de tiers-lieux mêlant culture, hébergement, télétravail, initiatives agricoles visant à relocaliser une partie de l’alimentation. Dans son essai, elle dresse une cartographie de ces micro-expériences, souvent portées par des collectifs, des coopératives ou des communes volontaires.
Rien de spectaculaire : pas de ruban tricolore au pied d’un nouveau télésiège, pas de milliardaire à la manœuvre. Mais un travail patient pour remettre de la vie à l’année dans des bâtiments qui s’éteignaient.
Changer d’approche, au sens littéral
Dans le débat public, la question de la mobilité pourrait passer pour un détail. Elle ne l’est pas. Depuis 2007, Mountain Wilderness porte la campagne « Changer d’approche », qui promeut les sorties en montagne sans voiture individuelle et recense des itinéraires accessibles en train, en car ou en covoiturage sur le site changerdapproche.org.
Le message est double. D’un côté, il s’agit de réduire l’empreinte carbone des loisirs en montagne : la voiture reste la première source d’émissions liées à ces pratiques. De l’autre, il s’agit de rappeler que la montagne est un territoire vivant, traversé de villages, de commerces, de gares, qui ne se résume pas au parking du front de neige. Une brochure de la campagne le formule ainsi : parcourir la montagne en mobilité douce, c’est aussi « participer à la vie locale ». Cette vision fait écho aux préoccupations de Laury-Anne Cholez sur la « consommation des lieux en montagne » : « On va quelque part, on consomme et on repart pour le mettre sur Instagram », déplore-t-elle, avant d'ajouter : « Il faut arrêter de se géolocaliser quand on fait une rando sur Instagram. Le lendemain, c'est 150 personnes qui se rendent à l'endroit où vous étiez seul·e. »
Là encore, Fiona Mille ne présente pas ces choix comme des sacrifices héroïques, mais comme des façons concrètes de basculer d’une logique de consommation rapide à une logique de séjour, de rencontre, de temps long. On accepte un trajet plus lent, on compose avec les horaires des trains, on découvre d’autres vallées, d’autres saisons.
Ce changement d’approche ne suffira évidemment pas, à lui seul, à résoudre les contradictions d’un modèle touristique très carboné. Mais il donne une idée de ce que pourrait être une montagne réellement réinventée : un espace où l’on vient moins souvent, plus longtemps, en tissant des liens avec celles et ceux qui y vivent, plutôt qu’en survolant le territoire entre deux rotations de télésiège.
Un laboratoire politique à ciel ouvert
L’intérêt du livre de Fiona Mille et de l’entretien publié par Reporterre tient peut-être à ceci : ils ne parlent pas de la montagne comme d’un « cas particulier », mais comme d’un concentré de questions qui traversent toute la société.
Dans les courbes de température des Alpes, on lit le réchauffement global qui s’emballe. Dans la multiplication des résidences secondaires, on retrouve la spéculation immobilière qui vide aussi les centres-villes. Dans les JO d’hiver 2030, on voit se rejouer le récit des méga-événements censés apporter prospérité et rayonnement, mais financés pour une large part par de l’argent public et des dérogations juridiques. Dans le projet Parker du Vercors, on reconnaît l’attrait persistant pour les grandes opérations « clé en main », malgré les alertes écologiques. La montagne apparaît alors moins comme une périphérie que comme un laboratoire. Ce qui s’y décide – en matière de logement, d’eau, de mobilité, d’événements sportifs, de foncier – préfigure ce qui pourrait se jouer ailleurs demain. Comme le résumait Baptiste Bouthier dans son échange avec Vertige Media : « Cette contradiction se joue à l'échelle collective et individuelle. Quand on ne vous a jamais montré qu'un autre modèle était possible, vous ne savez pas qu'il existe. » C'est précisément ce manque d'imaginaire alternatif que tentent de combler les travaux de Fiona Mille, La Revue Dessinée et Reporterre.
Fiona Mille ne propose pas de plan quinquennal ni de recette miracle. Elle plaide pour un changement d’imaginaire : accepter que la montagne ne soit plus d’abord un décor pour sports d’hiver, mais un ensemble de territoires habités, vulnérables, capables aussi de réinventer leurs usages. En creux, une chose est claire : si l’on continue à empiler pistes, résidences secondaires, JO et projets XXL sans se soucier des habitants, des glaciers et de l’eau, ce ne sont pas seulement les stations qui seront en crise, mais l’idée même de vivre en montagne.
L’alternative se dessine déjà, dans les lignes parfois discrètes des rapports d’experts, des études de l’Insee, des arrêtés préfectoraux et des assemblées de village. Elle tient dans quelques mots simples : ralentir, partager, habiter. Le reste n’est, au fond, qu’une question de courage politique.