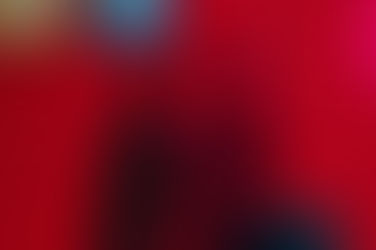Fabrice Guillot : habiter la ville comme une falaise
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 25 nov. 2025
- 13 min de lecture
Grimpeur élevé à Fontainebleau, co-signataire du manifeste des 19, pionnier de la danse verticale, Fabrice Guillot n’a jamais vraiment choisi entre le rocher et la ville. Avec la compagnie Retouramont, créée en 1989, il transforme façades, HLM et monuments historiques en terrains d’habitation poétique. Et pose une question vertigineuse : comment habiter le monde autrement que les pieds cloués au sol ?

Fabrice Guillot reçoit dans un ancien dojo de banlieue parisienne, reconverti en studio de danse verticale. C’est là qu'il vit et qu'il travaille, lui le « banlieusard d’Île-de-France », grimpeur doué mais jamais « acharné », compagnon de cordée d’Antoine Le Menestrel et cofondateur, en 1989, de la compagnie Retouramont, aujourd’hui associée au Ballet de l’Opéra national du Rhin. Sa trajectoire tient de la grande traversée : des dimanches sous la pluie à Fontainebleau aux échafaudages de Notre-Dame pour l’ouverture des Jeux olympiques, des premiers murs d’escalade bricolés à des sculptures aériennes qui envahissent l’espace public. Depuis plus de quarante ans, Fabrice Guillot transforme l’escalade en langage chorégraphique et la verticalité en outil pour relire la ville, déplacer les regards et rouvrir ce qu’on croyait figé dans le béton.
Petite pierre, grande question
Son histoire commence par un non-choix. « Depuis tout petit, je me suis retrouvé à aller à Fontainebleau tous les dimanches, même sous la pluie, et à Chamonix tous les étés. Du coup, je n’ai pas du tout eu le choix. Ma mère grimpait même quand elle était enceinte », confie-t-il. Enfant de kinés passionnés de montagne, Fabrice grandit avec un rythme de grimpeur pro. Très vite, Fontainebleau devient pour lui bien plus qu’un terrain de jeu. « C'est presque une espèce d’archétype de la relation qu’on peut avoir au monde, dans le sens où tu es face à un petit rocher, qui va faire peut-être trois mètres, et ce rocher, c’est une question, en fait. C’est une question minérale », philosophe-t-il. Plutôt que d’y voir un « problème » à résoudre – comme dans le fameux boulder problem à l'anglaise – le chorégraphe y voit une énigme qui oblige à regarder de près, à imaginer, à composer avec la matière. Il continue : « Plus ce rocher est à ta limite de difficulté, plus tu es obligé de scruter la matière, de faire marcher ton imagination, d’imaginer un mouvement. Parce que je crois que si on est un peu attentif et éveillé, le monde est une question. »
« Avec Antoine [Le Menestrel], on s’est dit qu’on n’avait pas envie de rentrer en compétition, mais que ça nous paraissait plus intéressant et plus créatif d’inventer les voies »
Enfant, pourtant, il ne théorise rien. « On se tirait la bourre entre potes, comme tout le monde. Le sujet, c’était d’aller faire des blocs ou des voies difficiles », explique Fabrice Guillot. Ce n’est qu’après coup qu’il relit ces « petits objets », ce « concentré de difficultés incroyables », comme une école du regard et de l’invention. La falaise, elle, ajoute un paramètre : le vide. « Je pense que c’était surtout l’appréhension du vide, l’acceptation du vol, l’acceptation de se retrouver à 20 mètres de haut, avec les pieds à 3 mètres au-dessus du point, de ne pas savoir, tu ne peux plus redescendre, de continuer. Se retrouver loin au-dessus du point, comme ça, c’est… » Il laisse la phrase en suspens. On comprend que ce flottement-là – quelque part entre la peur et le plaisir – va devenir, plus tard, sa matière première.
La recette du geste et le four de Bercy
Dans les années 1980, au moment où les premiers murs artificiels d’escalade surgissent, avec eux arrivent les premières compétitions, leurs règles, leurs formats, leur promesse de reconnaissance. Antoine Le Menestrel et lui signent le manifeste des 19, un engagement contre la compétition dans l'escalade. Mais ils acceptent finalement d'y jouer tout de même un rôle : pas celui des athlètes, mais celui des ouvreurs. « Avec Antoine, on s’est dit qu’on n’avait pas envie de renter en compétition, mais que ça nous paraissait plus intéressant et plus créatif d’inventer les voies », explique le Francilien. Leur parti pris est radical : que le vainqueur soit celui qui maîtrise le plus large « répertoire gestuel ». Concrètement, cela veut dire poser des énigmes : « En compète, on mettait des voies où, par exemple, tu pouvais avoir un dièdre très dur. C’est quelque chose où tu vas avoir deux prises sur quatre mètres. Bon, j’exagère peut-être un peu. Deux prises sur trois mètres. Où il faut valoriser le pied-main. C’était quasiment illisible, en fait ».
« Quand tu es à Bercy et que tu as peut-être 2 000 personnes, c’est un four, c’est clair »
À l’époque, on les traite de doux dingues pendant que les copains s’entraînent « dans les plafonds, pour être très puissants ». Eux défendent l’idée que la force brute ne suffit pas dans un dièdre « avec deux grattons qu’il faut valoriser à mort ». Et on leur donne les clés du camion. Littéralement. « À l’époque, on nous a demandé : “Bon, il vous faut combien de temps pour ouvrir ?” Nous, on a dit : un mois. “Bon, d’accord, allez-y.” » Pour Bercy, les murs sont prémontés en morceaux, les profils dessinés avec Jean-Marc Blanche, sculpteur de surfaces et d’architectures verticales. Deux tours reliées par un pont, des dièdres, des fissures : un répertoire de reliefs « beaucoup plus développé que celui d’aujourd’hui, qui est hyper standardisé », lâche Fabrice Guillot.
Le résultat, dans l’histoire de l’escalade, est devenu un cas d’école : un four médiatique. Un article du Monde parlera d’une catastrophe de lisibilité, d’un public perdu, d’une salle qui ne comprend pas ce qu’elle regarde. Fabrice Guillot ne nie pas : « Nous, quelque part, on avait envie de défendre ce que c’était que l’escalade libre, et cette pratique dans son ouverture gestuelle. On avait conscience qu’il y avait quelque chose qui était poussif au niveau de la forme spectaculaire. Un mec qui a une grosse résistance, il pouvait rester 20 minutes dans la voie. »
Pas assez de public, pas assez de codes partagés, trop de lenteur. « Quand tu es à Bercy et que tu as peut-être 2 000 personnes, c’est un four, c’est clair », continue-t-il. L’épisode laissera des traces et nourrira durablement la prudence — pour ne pas dire la frilosité — de la grimpe française vis-à-vis des grands formats de compétition. Mais c’est aussi là que se cristallise un savoir-faire d’orfèvre en lisibilité. Quand il devient chef ouvreur à l’étranger, en Allemagne ou ailleurs, avec dans son équipe Wolfgang Güllich et Kurt Albert, il comprend que la réussite d’une compétition, c’est autant l’inventivité des mouvements que la clarté du podium. « Il faut absolument que le troisième tombe à mi-voie, le deuxième tombe encore quelques mètres plus haut et le premier peut-être qu'il sort. Et donc ce réglage, c’est un réglage de difficultés qui est hyper fin. Pour moi, la réussite de la compétition, c’était aussi ça : arriver à cette lisibilité, cette compréhension pour le public », explique l'ancien ouvreur. Là encore, derrière la technique, une idée revient : créer des situations lisibles, des récits de verticalité que des non-initié·es peuvent suivre. Ce souci de dramaturgie — tomber plus bas, tomber plus haut, sortir — migrera plus tard de la compétition vers le spectacle.
Alors on danse
La bascule vers la scène ne vient pas d’un coup de tête, mais d’une série de repérages. Les chorégraphes de Rock in Lichen s’intéressent à ce drôle de mouvement qui se développe à la Loubière (à La Turbie, près de Monaco, ndlr) autour d’un ovni nommé Patrick Bérault, ses traversées interminables et son gros caractère physique qui laisse « tout le monde sur le carreau ». Avec lui, avec Jean-Marc Blanche, ils créent « Salle de bain à la verticale », pièce pionnière de danse-escalade devenue culte. Suspendre une baignoire dans les gorges du Verdon, accrocher un décor domestique à une falaise : succès énorme en danse contemporaine, incompréhension totale du côté des grimpeur·ses, « Qu’est-ce que vous foutez avec votre truc ? ».
« À un moment donné, je me suis dit : il y a tellement d’intérêt à travailler dans l’espace public, justement pour questionner ce territoire qui est difficile. Du coup, j’ai fait le choix de ne plus travailler dedans, mais d’être que dans l’espace public »
Fabrice Guillot et Antoine Le Menestrel, eux, font partie de la vague d’après. Repérés, intégrés à la pièce suivante, Rosaniline, au Centre national de danse contemporaine d’Angers (CNDC). « Un lieu un peu ultime, avec, je ne sais plus, 2-3 mois de résidence, raconte l'intéressé. On faisait une barre classique tous les matins, il fallait aussi qu’on danse au sol. » C'est une rupture brutale car il s'agit de passer du rocher au cours de classique, du dièdre aux studios du CNDC. Mais il y trouve un plaisir inattendu : celui d’apporter un bagage gestuel, des « situations », des « règles du jeu » issues de l’escalade. Là où la danse contemporaine apporte une histoire de dramaturgie et de composition, l'escalade injecte une culture du mouvement utile, des prises, des appuis, du vide.

Très vite, l’envie de voler de ses propres ailes surgit. En mai 1989, avec Antoine Le Menestrel, il crée Retouramont. Le premier spectacle naît dans un dojo où l’on pratiquait autrefois karaté et méditation zen. « On a accroché ce petit mur 4 × 3 en dalle qui était vraiment le premier élément d’une pièce qui s’appelait "Page d’écriture". Il y avait un 4 × 3 en dalle et un 4 × 3 en dévers. C’était un duo qui durait, je pense, 50 minutes. Donc c’était un spectacle. C’était vraiment un spectacle », confie Fabrice Guillot. Tout est artisanal : un échafaudage, quelques dates, une économie bricolée grâce aux compétitions, aux cours, aux premiers cachets d’intermittent. Pas de chargé·e de diffusion, pas de structure lourde. Mais déjà, un rapport très précis au temps de création : des semaines et des semaines pour régler une chorégraphie, comme on enchaîne et répète une voie jusqu’à la connaître « comme une voix (sic) que tu connais parfaitement ».
La suite, c’est une fidélité presque anormale à l’échelle d’une compagnie : « Il y en a qui sont là depuis presque le début. J’adore ce rapport à la fidélité et ça nous permet aussi, de création en création, d’avoir un répertoire extrêmement large et vivant. » Dans son discours, la notion de « répertoire » revient sans cesse : répertoire gestuel des grimpeur·ses en compétition, répertoire de figures et de situations pour les danseur·ses, répertoire d’agrès qui permettent d’habiter autrement chaque architecture. Une même obsession se décline sur plusieurs terrains.
La ville pour massif
Pendant des années, Retouramont travaille « dedans » et « dehors ». Des théâtres prestigieux (Bastille, Chaillot, scènes nationales) et des façades d’immeubles, des plateaux et des remparts. Puis vient une décision radicale : arrêter les salles et se consacrer à l’espace public. « À un moment donné, je me suis dit : il y a tellement d’intérêt à travailler dans l’espace public, justement pour questionner ce territoire qui est difficile, explique Fabrice Guillot. Du coup, j’ai fait le choix de ne plus travailler dedans, mais d’être que dans l’espace public. » Pour comprendre ce choix, il faut revenir à sa manière d’habiter la montagne. « Quand je suis en vacances sur un nouveau massif, premier jour, je fais une balade. De jour en jour, il y a quelque chose qui se tisse. Après, tu connais tout : les odeurs, les textures, la roche. » En quelques jours, le chorégraphe a le sentiment d’habiter un massif. En vingt ans, avoue-t-il, « j’ai du mal à habiter mon appartement et ma ville ». Problème de densité, de flux, de codes : la ville écrase, contraint, impose ses trajectoires.
« On a parfois des retours de gens qui disent : “Je suis allégé”. Parce que la pesanteur, on la subit, il y a quelque chose de lourd, quand même. Et du coup, la ville, quelque part, se déplie, s’ouvre »
La danse verticale devient alors un moyen de rapatrier dans la ville les ingrédients de l’escalade : exploration, appropriation, lecture fine de la matière, engagement physique. « Quand on se met à travailler avec ce projet "Réflexion de façade", où tu prends possession des fenêtres, tu vas voler d’un truc à un autre, tu tournes autour des piliers, tu as une autre vision de la ville, de l’intérieur. Tu connais la matière, la texture, la distance entre les bâtiments, puisque tu auras tiré ta tyrolienne, et du coup, ce petit bout de ville, à ce moment-là, je l’habite », affirme-t-il.
Ce n’est plus seulement une scénographie : c’est un outil de relecture du territoire. Dans les quartiers populaires comme sur les sites patrimoniaux, Retouramont arrive avec des cordes, des poulies, des « agrès » — ces structures démontables qui tiennent dans un sac de voyage et déploient 40 m de diagonale et 20 m de haut — pour inventer des volumes dans lesquels les corps peuvent se glisser, se balancer, se rencontrer. « La diagonale entre les haubans au sol fait 40 m, ça monte à 20 m, et ça crée un espace, un volume qui envahit l’espace de la représentation. Les gens sont presque dans les haubans. » Dans les quartiers de grands ensembles, la scène se joue au pied des immeubles. Des enfants viennent essayer les baudriers, se suspendre depuis leur propre façade. Certains disent : « J’avais l’impression de voler ». Le mot revient plusieurs fois dans sa bouche : légèreté. « On a parfois des retours de gens qui disent : “Je suis allégé”. Parce que la pesanteur, on la subit, il y a quelque chose de lourd, quand même. Et du coup, la ville, quelque part, se déplie, s’ouvre. »
Ce travail n’est pas qu’une « diffusion » de spectacles. C’est une présence au long cours : « Faire un travail de territoire, où pendant plusieurs années, on met un focus et on s’acharne un peu sur ce territoire et on multiplie les interlocuteurs. Une petite MJC, puis le bailleur social, puis un festival, puis une bibliothèque… » L’objectif ? « Participer à la réflexion sur la ville » avec des architectes, des urbanistes, des bailleurs, des directeurs de MJC, des programmateurs, des bibliothécaires. Jusqu’à inventer, avec l’architecte-urbaniste Stéphane Lemoine, un agrès sous forme de « moyen de transport en commun » : une grande roue de 3,50 m de diamètre qui embarque deux artistes et se promène dans l’espace public.
Dans ce paysage, la danse verticale n’est pas un gadget spectaculaire plaqué sur la ville. C’est un outil de friction douce, un prétexte pour que les habitant·es se réapproprient leur environnement : « Par un détour un peu ludique, à la fois faire pratiquer les gens, mais voir du spectacle. C’est un territoire qui se déplie. On ré-ouvre des possibles dans un lieu ».
Politique de la verticalité
Cette réappropriation ne se limite pas aux « dortoirs » de périphérie. Elle concerne aussi les lieux les plus verrouillés, les plus surveillés, les plus symboliques. Quand on lui confie les échafaudages de Notre-Dame pour le passage de la flamme olympique , la machine administrative se déchaîne : inspection du travail, sécurité, chef de chantier, pompiers, zone plomb, douches obligatoires, etc. « Il y avait une complexité administrative, sécuritaire, organisationnelle qui était hyper forte, rembobine Fabrice Guillot. Vraiment un truc qu’on n’a jamais vécu jusque-là. Même les organisateur·rices, ils doutaient qu’on y arrive » Mais ils y arrivent. Vingt artistes, suspendu·es sur les échafaudages, dansent pendant que la flamme passe.
Pour lui, l’enjeu dépasse de loin l’exploit technique. C’est la preuve que même « l’endroit le plus complexe » peut être réouvert par le geste artistique. « Ça veut dire qu’il n’y a pas de limite. Les façades, qui représentent peut-être 95 % de la ville, sont sans contrainte en fait. C’est-à-dire qu’on n’a aucune limite, si ce n’est qu’il faut arriver à convaincre un peu les gestionnaires. Alors qu’en bas, les 5 % qu’on se partage difficilement, c’est une zone de frottement », explique le chorégraphe. La formule est limpide : au sol, la ville est saturée, conflictuelle, réglementée à l’extrême. En hauteur, elle est encore, pour l’instant, un espace de liberté. La danse verticale met ce paradoxe en lumière, de manière spectaculaire mais aussi conceptuelle.
« Dans ma pratique de l’escalade depuis toujours, il y a un rapport à essayer d’habiter au plus proche »
« C’est aussi, d’une certaine façon, une forme d’acte politique, d’affirmer que la ville, c’est un espace ouvert. C’est la pratique qui crée la clairière, qui espace la pression qu’exerce la ville, ça la ré-ouvre, ça la poétise, et puis ça vient créer quelque chose qui est en rupture avec nos flux, nos préoccupations, qui se situent dans l’ordre de l’horizontalité. » La verticalité n’est pas ici un simple axe géométrique. C’est une direction mentale, un changement de registre : sortir des circuits utilitaires, se décaler de quelques mètres du sol pour faire apparaître d’autres lignes de force, d’autres histoires possibles.
Le franchissement
Dans tout son discours, un mot revient comme un leitmotiv : franchissement. Fabrice Guillot a d'ailleurs organisé, à la BnF, une rencontre sur ce thème, réunissant architectes, ingénieurs de ponts et artistes. « On est dans le rapport au franchissement. Quelles sont les disciplines qui permettent le franchissement dans l’espace public ? », apostrophe-t-il. Franchir, chez lui, n’est pas seulement passer un mur ou une paroi. C’est sortir d’un cadre, d’un usage, d’un récit. Franchir la frontière entre escalade et danse, entre sport et art, entre quartier et patrimoine, entre sol et vide, entre routine horizontale et projection verticale.
Ce n'est pas un hasard si ses interlocuteur·rices les plus enthousiastes sont autant des bailleur·esses sociales·aux que des directeur·rices de festivals, autant des urbanistes que des entraîneur·ses ou des grimpeur·ses qui ne se retrouvent plus dans le récit dominant de la performance. À ses yeux, l’escalade vit aujourd’hui une « seconde adolescence » : explosion des salles, marketing de la difficulté, culture de la blessure exhibée sur Instagram, usage quasi exclusif du modèle compétitif. Lui regarde ça de biais, sans mépris, mais avec un léger recul.
Ce qui l’intéresse, c’est l’« appétit de pratiques plurielles ». Le fait que des danseuses viennent tester l’escalade sur glace dans un atelier d’Antoine Le Menestrel, que des grimpeur·ses urbain·es inventent des topos sur les murs de Marseille ou de Paris, que des habitants de HLM découvrent un usage inédit de leur façade. La discipline, pour lui, ne doit pas se refermer sur un seul imaginaire. Elle doit rester cette « question » ouverte, ce rocher de trois mètres à Fontainebleau qui oblige à scruter, imaginer, ajuster.
« Plus la laideur, la mesquinerie, la vilenie nous empoissent, nous emprisonnent, plus ce rapport à l’art, c’est ce rapport à la beauté. Et les artistes, pour moi, véritables, c’est des gens qui nous ouvrent des espaces comme ça de beauté », poétise Fabrice Guillot. La danse verticale de Retouramont, elle, propose un dépliage radical : des corps en baudrier qui se mettent à écrire dans le vide, des façades qui cessent d’être des limites pour devenir des pages, des villes qui s’ouvrent sur leurs angles morts, des habitant·es qui disent « j’avais l’impression de voler » en regardant leur propre immeuble.
Dans sa bouche, une phrase du début résonne alors autrement : « Dans ma pratique de l’escalade depuis toujours, il y a un rapport à essayer d’habiter au plus proche ». Quarante ans après la création de Retouramont, il continue simplement à pousser cette logique jusqu’au bout : habiter au plus proche du rocher, au plus proche du mur, au plus proche du vide, au plus proche de ce que la ville pourrait être si on acceptait de la regarder autrement que depuis le trottoir.