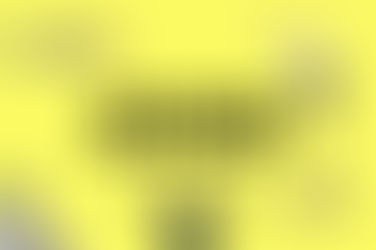Une via ferrata à 6 000 mètres : l’Everest en chantier
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 26 nov. 2025
- 11 min de lecture
Pour contourner la cascade de glace du Khumbu, l’un des passages les plus meurtriers de l’itinéraire népalais, le Népal mise sur une sorte de via ferrata. Située à plus de 6 000 mètres, l'installation est censée réduire le risque pour les travailleur·ses de la montagne et rassurer les client·es des expéditions. Mas derrière la rhétorique d'une « route plus sûre », ce n’est pas seulement une ligne technique qui se redessine : c’est toute l’industrialisation de l’Everest qui affleure, avec ses compromis, ses angles morts et ses vies très concrètes en jeu. Explications.

On pourrait la prendre pour une ligne de service technique, quelque part sur un chantier de montagne : marches métalliques vissées dans le rocher, câbles tendus, cordes qui pendent dans le vide. Sauf qu’ici, le décor n’est pas une station de ski mais le bassin du Khumbu, au-dessus de 5 800 mètres, sur la voie népalaise de l’Everest. Cette nouvelle section doit permettre de contourner la cascade de glace, ce labyrinthe mouvant où se concentre depuis des années une part importante des morts côté sud, et que le réchauffement climatique rend encore plus instable. Sur le papier, on déplace la trace pour réduire le risque, d’abord pour les Sherpas qui y passent le plus souvent. Dans la réalité, on fait quelque chose de plus profond : on installe une infrastructure de haute altitude pensée pour maintenir un modèle d’ascension de masse mis sous tension par le surtourisme, la crise climatique et la pression économique qui pèse sur le Solukhumbu. Présentée comme un progrès de sécurité, cette nouvelle voie raconte aussi autre chose si l’on accepte de la regarder comme un objet politique.
Un terrain miné
Sur une carte, la cascade de glace du Khumbu n’est qu’une langue blanche qui se casse sur les pentes de l’Everest et du Nuptse. Sur place, c’est un champ de mines vertical. Des tours de glace hautes comme des immeubles, des crevasses qui s’ouvrent là où, la veille, la trace passait encore, des ponts de neige posés sur le vide, un glacier qui coule sous les crampons des uns et les sacs des autres.
Pour rejoindre le camp 1, à un peu plus de 6 000 mètres, il faut traverser là-dedans à plusieurs reprises : une fois pour équiper, plusieurs fois pour monter le matériel, encore quelques fois pour l’acclimatation. Les client·es étranger·ères traversent la cascade quelques jours dans leur vie, encordés derrière un guide. Les Sherpas, eux, y retournent dix, quinze, vingt fois en une saison, parfois de nuit, souvent chargés comme des mules.
L’argument patrimonial – « retrouver la voie des pionniers » – sert ici de vernis symbolique à une réalité beaucoup plus contemporaine : la nécessité de sauver un modèle économique qui repose sur la répétition annuelle d’un même itinéraire, avec des flux de client·es toujours plus importants.
La catastrophe de 2014 – treize travailleurs fauchés à l’aube par un pan de glacier qui se décroche – n’a pas inventé le danger du Khumbu, elle l’a rendu visible à ceux qui ne voulaient pas le voir. Dans les statistiques compilées ces dernières années, la cascade concentre une part importante des accidents mortels côté sud. Et rappelle une vérité que la communication des expéditions escamote volontiers : la mortalité n’est pas répartie au hasard. Sur l’Everest, une part significative des morts sont des Sherpas ou des travailleurs de haute altitude, alors qu’ils ne représentent qu’une fraction des détenteur·rices de permis. Le risque, ici, est socialement structuré.
Le réchauffement climatique vient ajouter une couche d’incertitude. Les études sur les glaciers himalayens montrent un recul rapide du Khumbu, une transformation de sa structure interne, des séracs plus instables, des avalanches plus fréquentes. Quand l’aléatoire devient la norme, continuer à envoyer des équipes entières dans la même zone devient difficile à défendre, même au nom de la tradition ou du récit héroïque.
Faire revenir les fantômes de 1953
Pour justifier la nouvelle variante, le storytelling officiel convoque l’Histoire. Dans les communiqués et les articles destinés aux voyagistes, la route est présentée comme la réouverture d’un « itinéraire historique » emprunté en 1953 par Edmund Hillary et Tenzing Norgay Sherpa, via le versant du Nuptse. Une façon élégante de faire passer une opération d’ingénierie lourde pour une forme de « patrimonialisation ».
Sauf qu’à l’origine, l’idée n’est pas née dans un bureau de Katmandou mais sur le terrain, au sein d’une équipe franco-népalaise. Depuis 2022, l’alpiniste Marc Batard explore avec l’association Montagne & Humanisme – et aux côtés notamment de Kaji Sherpa – une voie alternative qui évite largement la cascade de glace, en remontant davantage vers les pentes du Nuptse. Il porte ce contournement comme une voie plus sûre pour les Sherpas et les travailleurs de haute altitude, souvent présenté comme une forme « d’héritage » à laisser : un accès moins aléatoire au camp 1, là où la loterie glaciaire devenait de plus en plus difficile à défendre.
Pour les agences, ce passage est aussi un argument commercial évident. Dans l’imaginaire collectif, la cascade de glace est devenue le symbole de l’Everest hostile.
La réalité, comme souvent, est moins nette que la brochure. L’expédition de 1953 est tout sauf un récit rectiligne : les Britanniques ont tâtonné, testé, renoncé, modifié leur trace en fonction de ce que voulait bien leur laisser la montagne. Si l’on retient aujourd’hui une ligne claire – camp de base, cascade de glace, Western Cwm, col Sud, arête sommitale –, c’est parce que la postérité a simplifié ce qui, sur le moment, relevait beaucoup plus de l’improvisation contrôlée.

La nouvelle route s’inscrit dans cet héritage revendiqué, mais elle en change profondément la nature. Là où Hillary et Tenzing exploitaient des faiblesses de terrain, l’équipe menée par Kaji Sherpa et Marc Batard fabrique un trajet : marches ancrées dans la roche, sections de câbles, un tronçon équipé façon via ferrata. L’argument patrimonial – « retrouver la voie des pionniers » – sert ici de vernis symbolique à une réalité beaucoup plus contemporaine : la nécessité de sauver un modèle économique qui repose sur la répétition annuelle d’un même itinéraire, avec des flux de client·es toujours plus importants.
Une via ferrata en zone de la mort
Dans les descriptions disponibles, la nouvelle variante ressemble moins à une trace de haute montagne qu’à une infrastructure. Plusieurs centaines de mètres de câbles, des dizaines de points d’ancrage, des marches métalliques, des tronçons où l’on progresse clipsé à une ligne de vie. Une via ferrata à plus de 6 000 mètres, posée là où, jusqu’ici, on misait surtout sur le fait que le glacier veuille bien tenir encore une saison.
« Après la catastrophe de 2014 où 14 sherpas ont perdu la vie, proche de la cascade de glace dans une avalanche, on ne peut que saluer l'aspect positif d'une nouvelle route qui permet de réduire les risques »
Emile Stantina de l'agence L’Everest Népal
Pour les travailleurs de haute altitude, l’enjeu est immédiat. Passer d’une zone où un effondrement de sérac peut raser une caravane en quelques secondes à un itinéraire plus solidement arrimé à la roche change la nature du risque : on quitte le terrain de la loterie glaciaire pour revenir à celui, plus « classique », de la chute, de l’erreur, de la météo. Quand on multiplie les rotations, ce déplacement n’est pas un détail de confort : c’est une variation très concrète dans les probabilités de survie.
Pour les agences, ce passage est aussi un argument commercial évident. Dans l’imaginaire collectif, la cascade de glace est devenue le symbole de l’Everest hostile : images d’échelles bringuebalantes au-dessus du vide, de séracs menaçants, de silhouettes qui filent dans la nuit frontale allumée. Pouvoir dire aux futurs clients : « Ce passage-là, on l’a partiellement contourné, on a une route plus sûre », c’est lisser l’une des aspérités qui rendaient l’aventure plus difficile à vendre à une clientèle prête à payer très cher pour un sommet, mais beaucoup moins pour une exposition pure au hasard.
Reste un malentendu majeur : une via ferrata à 6 000 mètres n’est pas un parcours aventure de station de ski. L’altitude, le froid, la fatigue, la complexité logistique ne disparaissent pas parce que la main trouve un câble plutôt qu’un bloc de glace. Le chantier réduit certains risques, il ne change pas la nature profonde de l’endroit : un milieu où le moindre dérapage se paye toujours très cher.
Vu de Katmandou, un soulagement
Cette grille de lecture très critique, largement produite depuis l’extérieur, ne raconte pas tout. Du côté des agences locales, la nouvelle variante n’est pas seulement un symbole : elle est d’abord un moyen de perdre moins de monde en route. Emile Stantina dirige L’Everest Népal, une jeune agence basée à Katmandou. Pour lui, le verdict des premiers concernés est clair. « Les Sherpas sont totalement favorables à ce changement de voie. Surtout pour éviter la cascade de glace », explique-t-il. En déplaçant une partie du trajet vers un itinéraire rocheux équipé, c’est le travail au quotidien qui change. « Beaucoup plus facile pour la mise en place et l'approvisionnement des camps, des conditions de travail plus favorables pour les Sherpas ou autres guides. Le plus important reste la réduction des risques afin d'assurer la sécurité des expéditions », continue Emile Stantina.
D'après lui, la nouvelle route est donc d’abord « positive ». « Après la catastrophe de 2014 où 14 sherpas ont perdu la vie proche de la cascade de glace dans une avalanche, on ne peut que saluer l'aspect positif d'une nouvelle route qui permet de réduire les risques », affirme l'entrepeneur. Sur le marketing de la « safer route », il rappelle que le récit n’a pas attendu les communiqués officiels. Le projet, porté depuis 2022 par Marc Batard et l’équipe de Kaji Sherpa, a été présenté pendant des années comme une promesse de montée en sécurité. « En fait, l'argument est utilisé depuis des années », explique-t-il, évoquant plutôt une publicité individuelle autour d’un livre, d’un film ou d’un itinéraire qu’un discours institutionnel parfaitement huilé. La formule a ensuite glissé presque naturellement dans le vocabulaire des agences et du Département du tourisme.
À la question de savoir si cette nouvelle section va attirer plus de client·es, Emile Stantina ne tourne pas autour du pot : « De mon humble avis, davantage de personnes vont venir gravir l'Everest ». En lissant symboliquement le passage de la cascade de glace, on rassure une partie de celles et ceux qui hésitaient encore à s’en remettre à la roulette glaciaire. La via ferrata n’est pas qu’un outil de sécurité. C’est aussi un moyen de vendre l’Everest, encore une fois, sans trop de fausses notes anxiogènes.
La structure du financement est, elle aussi, parlante. L’expertise est partagée – Sherpas, guides, alpinistes étrangers –, mais l’argent vient en grande partie de l’extérieur : donateur·rices privé·es, organisations de montagne, soutiens étrangers.
Pour autant, il ne se retrouve pas totalement dans le vocabulaire de « surtourisme » souvent brandi depuis l’Occident. « Tout est relatif. Je pense que si l'on compare le Népal à d'autres pays, le tourisme a un impact moindre », nuance le responsable d'agence, qui rappelle toutefois qu'« à une certaine altitude il est vrai que l'impact des camps, des touristes, des expéditions n'est pas négligeable sur l'environnement. » Camps, déchets, cordes fixes, sacs d’oxygène vides : l’empreinte de l’industrie des 8 000 n’est plus une abstraction.
Dans le Solukhumbu, le projet est donc perçu d’abord comme un soulagement, mais sans euphorie naïve. Emile Stantina parle d’une « bonne nouvelle », parce qu’« améliorer la sécurité de l'ascension, c'est un avantage indéniable pour tout le monde ». En même temps, il décrit des habitant·es « lassé·es des effets de "news" depuis des années alors que la route n'est pas opérationnelle ». La vallée a appris à se méfier des annonces spectaculaires qui ne se traduisent pas immédiatement dans le quotidien des travailleurs de haute altitude.
Financement, marketing et fiction confortable
Comme tout chantier, celui-ci a un budget et des lignes comptables. Les estimations avancent plusieurs centaines de milliers de dollars pour explorer, équiper, entretenir la nouvelle voie. Une somme considérable à l’échelle d’une vallée rurale du Népal, modeste au regard des revenus générés chaque année par les permis pour l’Everest.
Dans les communiqués du Département du tourisme comme dans les brochures de voyagistes, un qualificatif revient en boucle : « safer route », route plus sûre. La nuance est importante : personne ne parle officiellement de route sûre.
La structure du financement est, elle aussi, parlante. L’expertise est partagée – Sherpas, guides, alpinistes étrangers –, mais l’argent vient en grande partie de l’extérieur : donateur·rices privé·es, organisations de montagne, soutiens étrangers. L’État népalais apporte le cadre : validation politique, autorisation officielle, intégration de la nouvelle route dans l’itinéraire normal. L’actif – un accès « plus sûr » à un sommet mondial – est national, le risque humain est local, la trésorerie est transnationale.
On peut y voir une forme de solidarité internationale : des acteurs étrangers investissent pour réduire le danger supporté par les travailleurs népalais. On peut aussi y lire un schéma plus ambivalent : le cœur du système – des permis chers, des expéditions lucratives, des retombées touristiques massives – reste intact, tandis qu’on demande à quelques mécènes et à une poignée de professionnel·les de colmater une brèche devenue trop visible.
Dans les communiqués du Département du tourisme comme dans les brochures de voyagistes, un qualificatif revient en boucle : « safer route », route plus sûre. La nuance est importante : personne ne parle officiellement de route sûre. Mais, dans la traduction médiatique et marketing, l’adjectif perd vite ses guillemets.
Le paradoxe, c’est que cette vallée est prise en étau entre deux forces qui la dépassent : la dépendance à un flux de visiteur·ses qu’aucune commune ne contrôle vraiment, et un réchauffement climatique qui s’attaque précisément à ce qui fait la valeur marchande du lieu : glaciers, paysages, itinéraires.
Oui, faire passer l’itinéraire par des pentes rocheuses équipées plutôt que sous des séracs instables réduit le risque pour celles et ceux qui traversent cette zone. Oui, à l’échelle des probabilités, c’est sans doute la seule solution réaliste à court terme pour éviter que la cascade de glace ne continue d’être le piège à Sherpas d’une industrie déjà largement contestée. Tout cela est vrai, et il serait malhonnête de le minimiser.
Mais non, l’Everest ne devient pas « sûr » pour autant. La majorité des accidents mortels des dernières années se jouent plus haut : au-dessus de 8 000 mètres, à la descente, quand les corps sont épuisés, que l’oxygène se raréfie, que les embouteillages sur l’arête sommitale transforment chaque attente en loterie physiologique. Le cœur du danger s’est déplacé avec l’évolution du profil des client·es – plus nombreux·ses, souvent moins expérimenté·es – et avec la densification de l’itinéraire. La via ferrata du Nuptse ne répond pas à ces questions-là.
Surtout, en martelant l’idée de route « plus sûre », on alimente une fiction confortable : celle d’une montagne dont le risque pourrait être géré comme un dossier technique, à coups de procédures, de normes et de bouts de métal. Comme si l’enjeu central n’était pas aussi le volume de permis délivrés, la pression commerciale sur les expéditions, le rapport de force entre agences et travailleurs, la fragilité d’un glacier qu’on continue à traiter comme une infrastructure.
Solukhumbu sous perfusion
En arrière-plan de cette histoire de câbles et de marches, il y a une vallée qui vit sous perfusion. Le district népalais du Solukhumbu dépend, dans des proportions difficiles à imaginer depuis l’Europe, du tourisme de montagne : treks vers le camp de base, ascensions de sommets secondaires, expéditions sur l’Everest et les 8 000 voisins. Lodges, boutiques, portage, agences : toute une économie organisée autour de la saison des permis.
Les deux lectures ne s’annulent pas. La nouvelle route du Nuptse est à la fois un progrès local et un révélateur global.
La nouvelle route est présentée comme un levier de stabilisation : en réduisant les accidents dans la cascade de glace, on limite les coups de projecteur tragiques, les suspensions de saison, les polémiques sur les conditions de travail. On continue à faire tourner la machine sans que les morts s’invitent trop souvent dans le récit officiel de « l’aventure de votre vie ».
Le paradoxe, c’est que cette région est prise en étau entre deux forces qui la dépassent : la dépendance à un flux de visiteur·ses qu’aucune commune ne contrôle vraiment, et un réchauffement climatique qui s’attaque précisément à ce qui fait la valeur marchande du lieu : glaciers, paysages, itinéraires. En choisissant de répondre aux symptômes par des solutions techniques toujours plus sophistiquées, on gagne du temps. On n’affronte pas pour autant la question de fond : combien de temps un territoire peut-il rester accroché à un modèle qui repose sur une montagne en train de changer sous ses pieds ?