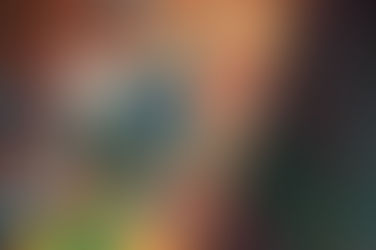Accidents en escalade : le problème ce n’est plus le matériel, c’est nous
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 20 nov. 2025
- 7 min de lecture
Escalade toujours plus populaire, matériel toujours plus fiable, protocoles de sécurité qui s’empilent… et pourtant les accidents restent là. Entre le dernier bilan d’accidentologie de la FFME et une étude nord-américaine, un même constat s’impose : dans une très large part des cas, ce n’est pas l’équipement le problème, c’est le facteur humain.

Le décor, on le connaît : une salle d’escalade de périphérie un soir de semaine, le pan de bloc saturé de grimpeur·ses qui enchaînent les runs et, un peu plus loin, les cordées serrées les unes contre les autres sous les néons, auto-enrouleurs qui montent et descendent en silence. C’est là que se produit une bonne partie des 303 accidents d’escalade recensés cette saison par la FFME, bloc et corde confondus, très majoritairement chez les majeur·es : près de 71 % des sinistres pour un public pourtant composé à moitié de mineur·es. En toile de fond, la fédération compte 0,38 sinistre pour 100 licencié·es, une proportion qui varie peu d’une saison à l’autre, malgré le matériel « plus sûr », les affiches pédagogiques et les formations.
Pourquoi, alors, la courbe refuse-t-elle de descendre ? Peut-être parce que nous continuons obstinément à interroger le mousqueton, le frein, le système d’assurage et la notice, là où, de plus en plus clairement, c’est le cerveau qu’il faudrait mettre au centre du débat. C’est du moins ce que suggèrent les travaux de la chercheuse et grimpeuse américaine Valerie Karr, qui a passé plus de vingt ans d’accidents compilés par l’American Alpine Club au crible.
Vous êtes le maillon faible
Dans les rapports d’accidents, les histoires ne commencent jamais par « j’ai décidé de baisser la garde ». Elles parlent de mousquetons, de freins d’assurage, de cordes trop courtes, parfois de rocher qui casse. Puis, entre les lignes, on finit toujours par voir apparaître la même scène : quelqu’un qui était sûr·e de savoir, quelqu’un qui n’a pas osé dire, quelqu’un qui était trop fatigué·e pour voir le détail qui clochait.
C’est ce sous-texte que Valerie Karr, grimpeuse et chercheuse en sciences sociales, a décidé de prendre au sérieux en se plongeant dans Accidents in North American Climbing (ANAC), la base de données que l'American Alpine Club alimente depuis les années 1940. Sur un corpus 2005–2024, elle applique la « théorie ancrée » : laisser les motifs sortir des récits plutôt que plaquer une grille pré-écrite. Son article, « Know the Ropes: Human Factors Behind Climbing Accidents », ne raconte pas seulement ce qui se passe, mais comment on en arrive là.
Karr convoque l’effet Dunning-Kruger : plus on est compétent dans un contexte étroit, plus on a tendance à surestimer ce qu’on sait dans un contexte voisin mais plus complexe.
Un de ses fils rouges, c’est la familiarité. À force de répéter la même manœuvre sans incident, le cerveau reclasse une action objectivement dangereuse dans la catégorie des gestes anodins, au même rayon mental que « descendre un escalier ». Dans les rapports ANAC, la scène est toujours la même : un·e grimpeur·se expérimenté·e termine une grande voie, installe un rappel « comme d’habitude », discute, ne teste pas le système, ne met pas de backup, se penche dans le vide… et découvre trop tard qu’il a oublié quelque chose. Sur le papier, on parlera de « mauvais montage du système de descente ». Karr y voit un cas d’école de normalisation du risque : avec l'habitude, on oublie que nos gestes ne sont pas anodins.
Les sciences cognitives décrivent ce glissement depuis longtemps : la répétition sans conséquence érode la vigilance, même lorsque l’environnement ne devient jamais vraiment moins dangereux. Sauf qu’en escalade, on peut avoir tendance à transformer ce biais en modèle culturel. On admire celui ou celle qui « enchaîne les manips » sans y penser, on valorise l’aisance, la décontraction, le côté « je ne me prends pas la tête ». Celui ou celle qui vérifie tout, qui redemande, qui double les systèmes, passe vite pour parano.
L’illusion de la maîtrise
Autre motif fort dans l’analyse de Karr : le passage de la salle vers la falaise. ANAC regorge de cas de grimpeur·ses très fort·es en indoor qui se mettent sérieusement en danger sur des couennes ou des grandes voies à des niveaux théoriquement comparables. Vols mal gérés, dérives d’itinéraire, points manqués, relais bricolés ou mal compris.
Sur le papier, toutes ces personnes ont le niveau. Ce qui manque, ce n’est pas la capacité physique à tenir des prises, c’est la cartographie mentale de l’environnement outdoor : rocher qui casse, points espacés, vires traîtresses, lecture de topo approximative, approches et descentes qui font partie du risque réel autant que la longueur clé.
Au bout d’un certain nombre de micro-choix, notre capacité à arbitrer correctement se délite.
Karr convoque alors l’effet Dunning-Kruger : plus on est compétent dans un contexte étroit, plus on a tendance à surestimer ce qu’on sait dans un contexte voisin mais plus complexe. Version grimpe ça donne : le corps sait faire du 7b à l’intérieur, le cerveau décide que « 7b, c’est 7b », et oublie qu’entre une voie de résine bien équipée et une dalle licheneuse avec un point tous les cinq mètres, il n’y a pas que la couleur des prises qui change.
Dans ce cadre, les compétences les plus décisives – gestion de l’engagement, choix de voie adapté, capacité à renoncer – deviennent des compétences invisibles, et sont rarement enseignées de manière explicite. On apprend à progresser, rarement à reculer.
Égos et cerveaux rincés
S’il fallait n’entourer qu’un mot dans le texte de Karr, ce serait celui-là : transitions. Les moments où l’on bascule d’un système à un autre : on grimpe puis on redescend, on est assuré·e puis vaché·e, on passe de la grimpe en tête à l’auto-enrouleur, d'un tube à un assureur à freinage assisté, etc.
Ces interstices cumulent tout ce que notre cerveau gère mal : fatigue en fin de voie ou de séance, distraction (on parle, on pense déjà à la suite), illusion d’être « sorti·e d’affaire » une fois le sommet ou le relais atteint. C’est précisément là qu’on démonte un dispositif qui fonctionne pour en remonter un autre, parfois plus complexe, avec du monde autour et pas assez de temps. Côté recommandations fédérales, cela devient : simplifier les systèmes, bannir les usines à gaz d’assurage ou de rappel, formaliser quelques règles d’or dès qu’on change de mode d’assurage.
À ces ruptures techniques s’ajoutent des lignes de fracture plus sociales. Karr parle d’ « authority gradient », ce dénivelé symbolique entre deux personnes encordées : celui ou celle qui grimpe plus fort, qui connaît le site, qui a l’expérience, qui parle plus fort. Celui ou celle qu’on n’a pas envie de contredire sur le choix de voie ou le nœud d’encordement.
Les cas qu’elle décrit pourraient se dérouler un dimanche quelconque à Buoux ou dans le Verdon. Une personne peu à l’aise en tête accepte de partir parce que son ou sa partenaire plus expérimenté·e insiste. Elle trouve que l’assurage est approximatif, mais n’ose pas le dire de peur de passer pour « ingrate » ou « reloue ». L’accident surviendra sur une chute, avec un vol beaucoup plus long que nécessaire. Ailleurs, un grimpeur très expérimenté utilise un nœud sophistiqué pour s’encorder, assure que « c’est bon », et son partenaire n’ose pas demander un huit standard. Le nœud se défait sur une chute.
On peut continuer longtemps à comparer les freins d’assurage, à discuter de la taille de la bâche sur une voie d’auto-enrouleur, à raffiner les protocoles affichés en A3 au pied des parois. C’est utile, jusqu’à un certain point.
Ajoutez à ça la fatigue mentale et le cocktail est complet. Karr s’appuie sur les travaux sur « l’épuisement du moi », et la fatigue décisionnelle : au bout d’un certain nombre de micro-choix, notre capacité à arbitrer correctement se délite. Dans les récits d’accidents, cela donne des manips ratées en fin de voie, des rappels bâclés après une longue journée, des options de descente médiocres choisies de nuit, des marches de retour sous-estimées. Le cerveau a mentalement classé la sortie en réussite, et le corps relâche alors la vigilance. C'est précisément là que le moindre détail oublié devient létal.
Transposé dans la salle du mardi soir, l’image est limpide : journées pleines, cerveaux rincés, séances comprimées avant la fermeture. C’est dans ce créneau de fin de session, quand tout le monde est en pilotage automatique, que surgissent les erreurs d’assurage avec retour au sol, les oublis d’encordement sur enrouleur, les mauvaises réceptions en bloc parce qu’on « tente un dernier run ». Le risque n’augmente pas parce que les manips deviennent plus complexes, mais parce que l’attention, elle, est déjà rangée dans le sac.
Changer de focale
Ni la FFME ni Valerie Karr n’ont de solution miracle à vendre. Ce que leurs travaux expriment, c’est d’abord un changement de focale. Cesser de penser la sécurité comme un problème d’objets – quel frein, quelle longe, quel pictogramme au pied des murs – et commencer à la voir comme une culture : des réflexes partagés, une manière de se parler, un droit implicite à dire non.
On peut continuer longtemps à comparer les freins d’assurage, à discuter de la taille de la bâche sur une voie d’auto-enrouleur, à raffiner les protocoles affichés en A3 au pied des parois. C’est utile, jusqu’à un certain point. Mais tant qu’on refusera d’intégrer quelques évidences – que l’erreur est inhérente à la pratique, que l’expérience n’immunise pas, que les rapports d’autorité et la fatigue cognitive pèsent aussi lourd que le diamètre de la corde – on restera coincé·es dans le même paradoxe statistique : un ratio de sinistres par licencié·e qui varie peu, malgré un environnement matériel de plus en plus « sécu ».
Les milieux qui ont réellement fait baisser leurs courbes d’accidents – l’aviation, le bloc opératoire, certaines industries à risque – n’ont pas fabriqué des super-humains. Ils ont organisé le doute : check-lists obligatoires, rituels partagés, formation continue, droit explicite de contester une décision, culture du retour d’expérience où l’on décortique les presque-accidents avec autant de sérieux que les drames.
On a passé des années à perfectionner la corde, les points, les freins. Le chantier qui s’ouvre est peut-être moins photogénique, mais probablement plus décisif : apprendre à grimper avec un peu plus de science de nous-mêmes.