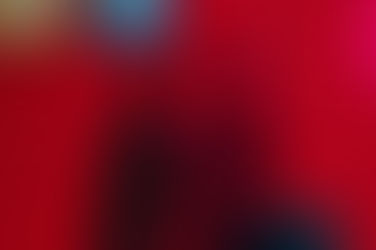« Tomber pour mieux se relever » : la résilience est-elle une injonction dangereuse ?
- Léo Dechamboux

- 2 nov. 2025
- 8 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 nov. 2025
C’est devenu un des bangers de l’époque. Mantra de nos sociétés modernes et concept sexy de la performance, la « résilience » s'est érigée en qualité première pour exceller en escalade, comme dans la vie. Pourtant, bien plus complexe qu'un slogan de développement personnel, le concept peut s’avérer pernicieux si on se l’approprie trop individuellement. Explications, à grands renforts de sciences sociales.

Cet article est le deuxième épisode d'Heavy Mental, notre nouvelle série qui décrypte les concepts psychologiques clés de l'escalade, sous le poids de la performance. Elle est rédigée par Léo Dechamboux, préparateur mental et co-auteur avec Fred Vionnet de l'ouvrage de référence Le Mental du grimpeur.
« Ce qui ne tue pas nous rend plus fort·e. » « Nos cicatrices laissent passer la lumière. » « À cœur vaillant rien d’impossible. » Le besoin de résilience est partout. D’autant plus après les épisodes liés à l’épidémie de Covid-19. S’adapter à toute situation, se relever, être fort.e dans l’adversité fait désormais partie des objectifs de tous les programmes de développement personnel et occupe une large place dans les champs d’action de la préparation mentale. Appliquée à notre milieu de l’escalade, la métaphore est facile : « Tomber sept fois, se relever huit ». Mais pourquoi la résilience est omniprésente dans nos sociétés moderne et qu’est-ce qu’elle signifie, au juste ?
Entrer en résilience
La recherche en psychologie du sport a définitivement embrassé la hype de la résilience. Si elle s'intéresse au sujet depuis longtemps, ses chercheur·ses ont considérablement accéléré leurs travaux ces dernières années. Toutes et tous décrivent la résilience comme un processus dynamique d’adaptation permettant de maintenir un équilibre psychologique malgré l’adversité. La résilience ne désigne donc pas un trait de personnalité fixe, mais une capacité en mouvement, modulée par le contexte et l’expérience. Dit autrement, c’est la capacité à surmonter une difficulté et à rebondir en retrouvant de manière indépendante un fonctionnement optimal.
Deux leviers principaux y contribuent. D’abord, il s'agit de percevoir les facteurs de stress comme des défis plutôt que des menaces. Ensuite, il faut réfléchir activement aux stratégies pour y répondre. Si un.e grimpeur·se résilient·e se blesse par exemple, i·elle sera capable de traverser cette épreuve en tant que challenge à relever, d’accepter la situation ainsi que ses conséquences, d’analyser les causes contrôlables à l’origine de cet accident (par exemple un manque d’échauffement) et d’apprendre de cette épreuve à plus long terme. Le raisonnement est le même avec chaque épreuve que vous pouvez traverser dans vos aventures verticales.
Les principaux facteurs d’abandon sont liés à l’environnement des sportif·ves : pression à la performance, manque de soutien social, conflit avec le staff technique...
Comme souvent, pour optimiser une habileté mentale, il faut se pencher vers ses antécédents. En 2000, Edward L. Deci et Richard M. Ryan, auteurs de référence autour de la motivation et du bien-être psychologique, ont souligné l’importance du soutien des besoins psychologiques fondamentaux - autonomie, compétence, appartenance - dans la construction d’une résilience durable. Vingt ans après, dans une autre étude intitulée « The power of feedback revisited », trois chercheurs - Benedikt Wisniewski, Klaus Zierer et John Hattie - réaffirment que les feedbacks sont indispensables à l’expression d’une résilience optimale. Ces derniers peuvent aider à la compréhension des erreurs — « Tu aurais pu optimiser ton placement et ta respiration au point de repos » motivationnels — « Tu vas y arriver, ce n’est qu’une épreuve à passer » — ou sociaux — « On s’est fait rouler dessus, mais c’était vraiment cool de passer cette séance ensemble ».
Seul avec du monde autour
La résilience a donc des racines personnelles liées à l’environnement direct des grimpeur·ses. En 2023, Alejandro Padilla-Crespo s’est intéressé aux différences entre les grimpeur·euses de niveau avancé et les débutant·es. Le chercheur et coach en escalade espagnol a plus précisément analysé leurs réponses psychologiques distinctes face à un facteur de stress. Il montre ainsi dans son étude que la capacité à réguler ses émotions et la confiance en soi (dont nous avons parlé dans le précédent article de la série Heavy Mental, ndlr) sont les clés individuelles d’une résilience optimale. Cela dit, il certifie également que l’expérience joue un rôle majeur dans l’expression de ces paramètres.
Plus une personne a de l’expérience dans la pratique, plus elle aura tendance à avoir confiance en ses capacités. Plus elle aura tendance à réussir et à gérer son anxiété et sa frustration. Plus elle aura la capacité de rebondir efficacement après un revers. Le contexte est donc fondamental dans la construction de la résilience. Pour définitivement le démontrer, une étude de 2024 s’est quant à elle intéressée aux facteurs de résilience et aux facteurs d’abandon chez les jeunes grimpeur·euses de haut niveau. Elle montre que les principaux facteurs d’abandon sont liés à l’environnement de ces jeunes sportif·ves : pression à la performance, manque de soutien social, conflit avec le staff technique, fatigue liée à une surcharge d’entraînement. À l’inverse, parmi les facteurs de résilience partagés, on observe le plaisir intrinsèque, un soutien parental et amical stables, une capacité à interpréter les échecs comme des situations d’apprentissage et une flexibilité mentale importante dans la reformulation des attentes et des buts. Encore une fois, c’est bel et bien le climat motivationnel instauré par l’entourage direct qui prime.
« Esprit Kaizen » : le grand plat de résilience
Vous l’aurez compris, vous n’êtes pas seul·e. Face à la frustration ou l’échec, la résilience se construit dans une dimension collective. Elle s’ancre dans un environnement social, culturel et institutionnel. Pourtant, les formules convenues de nos sociétés néo-libérales conjuguent en permanence la résilience au singulier. « Ce qui ne tue pas rend plus fort » est matraqué dans la pub, le sport, le coaching et les épisodes de DBZ. Qu’est-ce qu’il s’en dégage ? L’idée que l’individu doit se reconstruire seul et transformer chaque chute en opportunité.
En escalade, tenir bon coûte que coûte, se relever et progresser n’est donc pas qu’une vertu. Elle impose une charge cognitive à des individus en quête de croissance.
Inoxtag illustre parfaitement cette dynamique avec son film Kaïzen : travailler pour atteindre ses buts, redoubler d’efforts face aux difficultés, se relever et grandir à chaque épreuve. En servant un certain modèle économique, ces principes se sont transférés à la psychologie contemporaine. Résultat : la résilience est devenue un mantra dans le sport. En escalade, nous n’y échappons pas. De cette manière, la pugnacité et le progrès permanent deviennent le centre des préoccupations du/de la grimpeur·se et les placent au pied du mur : nous serions les seul·es responsables de nos réussites et de nos échecs. Pire, nous serions seul·es à pouvoir y faire face.
Selon cette logique, le contexte social est invisibilisé et seuls demeurent des fragilités psychologiques à corriger individuellement. Celles et ceux qui sont moins à l’aise dans cet exercice de rebond immédiat en viennent à culpabiliser. Dans un article critique intitulé « Resisting Resilience », l'auteur Mark Neocleous décrit cette « habileté mentale » comme une stratégie politique de pacification, invitant les individus à absorber les chocs d’un système sans chercher à en remettre en cause les origines structurelles. En escalade, tenir bon coûte que coûte, se relever et progresser n’est donc pas qu’une vertu. Elle impose une charge cognitive à des individus en quête de croissance. C'est le symptôme d’une époque où on ne laisse plus le temps ni l’opportunité de vivre et de comprendre ses émotions, face à l’échec et aux difficultés. Ainsi, être bon.ne grimpeur.euse signifie uniquement devoir toujours avancer.
À force de prôner le rebond permanent, on en vient à trop tirer sur la corde. Dans le sport, comme dans la vie, la surenchère mentale finit par peser sur le corps et sur les émotions. Les recherches récentes sur la « fatigue de la résilience » (The Problem with Resilience, 2025 ndlr) remettent cette injonction en question et en montrent un certain nombre de limites :
La résilience est devenue une norme morale, un devoir implicite. En manquer relève d’un manque de volonté et d’une forme de fragilité.
Cette norme devient un outil de régulation et encourage le conformisme. Elle limite la remise en question de l’autorité et célèbre la capacité à tenir plutôt qu’à s’effondrer ou revendiquer un soutien structurel. Pire, elle banalise l’adaptation à l’inacceptable, notamment au harcèlement (de la part des staffs techniques par exemple), à la surcharge d’entraînement, aux violences sexistes et sexuelles, au bizutage…
Elle invisibilise les différences structurelles des disciplines comme l’escalade, pourtant marqueuses de classe. La grimpe devient alors cette « grande famille » qui se voile la face.
Et bien évidemment, l’ensemble de ces conséquences se traduit par des manifestations cognitives et affectives telles que la honte, la culpabilité, l’isolement, ou la fatigue mentale excessive.
La « résilience féminine » est devenue une performance sociale : celle de la femme moderne, incassable, célébrée pour sa force intérieure mais sommée de taire le contexte systémique de ses luttes.
Résilience et inégalités structurelles
« C’est morpho. » Dans les salles de grimpe, la formule fuse, presque de manière anodine. Mais derrière ce réflexe, se cachent les inégalités structurelles qui traversent nos murs : corps, genre, âge, ressources. Comme souvent, les minorités en paient le prix psychologique.
En 2018, Rosalind Gill et Shani Orgad montraient déjà comment la « résilience féminine » est devenue une performance sociale : celle de la femme moderne, incassable, célébrée pour sa force intérieure mais sommée de taire le contexte systémique de ses luttes. En sport, cette rhétorique se traduit par des frontières invisibles : exceller sans paraître agressive, performer sans masculiniser son image (O’Brien, 2021). Cette « résilience cadrée », façonnée par le regard masculin, devient alors une condition d’inclusion.
Comme l’ont observé Jack Hewitt et Nollaig Mc Evilly (2022), les grimpeuses intègrent souvent cette norme pour « tenir leur place » dans un environnement genré dans lequel il faut prouver, encaisser, rebondir. Mais la résilience en escalade n’est pas qu’une affaire de genre, elle est aussi affaire de classe. L’accès à la nature, aux salles ou aux falaises dépend d’un capital culturel, économique et logistique qui détermine qui peut ou non « se forger un mental ». En 2023, Guillermo Sanz-Junoy et ses collègues montrent que les ressources psychosociales comme le soutien perçu, l’expérience, le capital culturel ou la stabilité de l’environnement influencent directement la capacité à rebondir après un échec.
On demande donc aux plus précaires et aux minorisé·es d’être plus résilient·es que les autres, de transformer les obstacles en apprentissages là où les privilégiés disposent déjà de marges de sécurité, alors même que l’accès à l’expression de la résilience est structurellement inégal. Dans nos sports comme ailleurs, la résilience reste une qualité admirée, attendue, inégalement distribuée.
La grande désescalade ou le retour de la lenteur
Et si, au lieu de chercher à rebondir toujours plus vite, on acceptait simplement de se poser ? Dans une société obsédée par la performance et la réparation immédiate, penser une résilience décroissante revient à réhabiliter la lenteur, la vulnérabilité et la sobriété psychologique. C’est admettre que l’équilibre ne se trouve pas dans le rebond permanent, mais dans la souplesse : celle qui accepte la chute, la fatigue et le doute comme des étapes du processus, pas des failles à corriger. L’escalade offre un terrain d’expérimentation rare pour ce type de résilience. Tomber, recommencer, se confronter à la paroi : autant de micro-échecs qui invitent à une forme d’attention lente.
L’état de flow, ce moment où le geste, le souffle et la concentration s’accordent, ne naît d’ailleurs pas de la lutte mais de l’accord subtil entre exigence et relâchement. La progression devient un espace d’équilibre plutôt qu’un sprint vers la réussite. De même, les travaux portant sur le feedback montrent que l’apprentissage véritable naît de boucles lentes d’essais, d’erreurs et de réflexion partagée. Le progrès ne s’impose pas : il se cultive, à plusieurs, dans un climat de confiance. Réhabiliter le repos, la récupération et la pause, c’est donc aussi redonner une place à la coopération et au collectif dans la construction de soi.
Dans la continuité des approches décroissantes il devient possible d’envisager la résilience non comme un rebond, mais comme un ralentissement. Réhabiliter la lenteur, c’est se redonner le droit à la fragilité et à la sobriété psychologique. Dans cette perspective, désescalader devient un geste politique autant que psychologique. C’est refuser l’injonction à tenir coûte que coûte, c’est revendiquer le droit à la pause, à l’écoute et à la lenteur. C’est enfin ouvrir une parenthèse pour prendre un peu de la hauteur et comprendre les origines structurelles de nos difficultés plutôt que de ne pointer que nos failles personnelles.