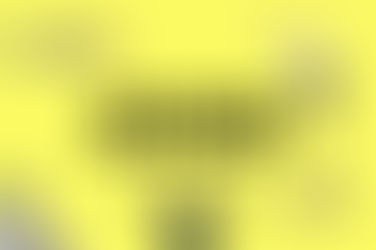« Le respect ne naît pas de la violence » : la Fédération indonésienne d’escalade brise l’omerta sur les bizutages
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 14 oct. 2025
- 6 min de lecture
À Bitung (nord de Sulawesi en Indonésie), une vidéo tournée le week-end des 27-28 septembre 2025 montre des adolescent·e·s frappé·e·s lors d’un rite d’intégration organisé par le club HIMPASUS. En moins de vingt-quatre heures, la fédération indonésienne d’escalade (FPTI) condamne publiquement ces violences et la police ouvre une enquête pour « violences sur mineur·e » au titre de la loi n° 35/2014 sur la protection de l’enfance.

Le cas de Bitung n’a rien d’un incident isolé. Dans certains clubs de randonnée, d’escalade ou de spéléologie en Indonésie, des « rites » d’intégration impliquant des gifles ou des coups sont encore justifiés au nom de la « tradition » ou de la « formation du caractère ». À Bitung, la vidéo tournée en septembre 2025 montre des jeunes agenouillé·e·s, frappé·e·s méthodiquement. La plainte part d’une mère : son fils de seize ans (AA) a d’abord expliqué ses ecchymoses par des « piqûres d’abeille », avant que les images ne confirment les violences. La fédération indonésienne d’escalade (FPTI) tranche alors publiquement : « Le respect ne naît pas de la violence ».
L’intime mécanique d’un bizutage
Le dernier weekend de septembre 2025, les collines du Gunung Dua Saudara, au-dessus de Bitung, ont été le théâtre des rites d’initiation. Là, au terme de plusieurs jours d’orientation, les nouvelles et nouveaux membres du Himpunan Penjelajah Alam Terbuka Spizaetus — un club local, ces « amoureux·ses de la nature » — ont vécu ce que leurs aîné·e·s appellent un pengukuhan, un « adoubement ».
Sur les vidéos qui ont circulé : on voit une clairière, des adolescent·e·s torse nu, agenouillé·e·s, tête baissée. Leurs mains sont jointes sur leurs cuisses. Autour d’eux, un cercle d’« ancien·ne·s » distribue des gifles méthodiques. Sur un autre plan, une responsable glisse une écharpe violette — symbolique du club — autour du cou d’un jeune avant de le frapper au visage, puis de lui porter un coup de pied. Une mise en scène où la hiérarchie se rejoue, geste après geste, dans une chorégraphie de brutalité. Selon les premiers constats, au moins six participant·e·s auraient été agressé·e·s ce jour-là, dont une jeune femme.
La police de Bitung (Polres Bitung) a été saisie après la plainte d’une famille : celle d’un adolescent de seize ans, identifié par ses initiales AA, blessé lors du rite. Les enquêteur·rice·s ont entendu huit personnes — responsables du camp et témoins directs. Les médias locaux parlent d’abord de six auditions, avant de confirmer un élargissement à huit. Les faits sont désormais examinés sous le chef de « violence sur mineur », en application de la loi indonésienne n° 35/2014 sur la protection de l’enfance.
« Le respect ne naît pas de la violence »
Dès que les images ont commencé à circuler, la Fédération indonésienne d’escalade (FPTI) a choisi de sortir du silence. Son champ officiel — celui du panjat tebing, l’escalade sportive — ne couvre pas les clubs communautaires de plein air, mais son autorité morale dépasse largement les murs des compétitions.
Un milieu où l’autonomie, la fraternité et l’endurance se font dogme, parfois jusqu’à la caricature.
Dans un communiqué relayé par la presse nationale, sa présidente Yenny Wahid a tranché net : « Le respect ne naît pas de la violence ». Puis elle a ajouté que la dureté, lorsqu’elle s’impose, cesse d’éduquer : elle entame. En une phrase, elle a désamorcé tout un discours sur la « formation du caractère » par l’humiliation.

Cette prise de position, sobre et frontale, marque un tournant : une fédé sportive qui s’empare d’un fait social, non pour protéger son image, mais pour rappeler une éthique. Dans le paysage outdoor indonésien, c’est une rupture symbolique — une manière de dire que la montagne n’a pas besoin de violence pour transmettre la force.
La défense par la « tradition » : ce que dit — et ne dit pas — le club
Face au scandale, HIMPASUS, ou Himpunan Penjelajah Alam Terbuka Spizaetus — littéralement « Association des explorateurs·rices de la nature en plein air Spizaetus » — a publié une mise au point largement relayée dans la presse locale. Fondé à Bitung, au nord de Sulawesi, ce club appartient à la vaste constellation des associations locales, ces « amoureux·ses de la nature » qui parcourent l’Indonésie sac au dos, entre randonnée, escalade et spéléologie. Un milieu où l’autonomie, la fraternité et l’endurance se font dogme, parfois jusqu’à la caricature.
Les travaux sur la violence non accidentelle en sport sont clairs : ces pratiques n’ont aucune vertu éducative. Elles ne forment pas le caractère, elles fracturent la confiance.
Dans son communiqué, HIMPASUS reconnaît une « faute grave », attribuée à « deux seniors », qu’il présente comme un incident isolé, non comme le symptôme d’une culture. La police de son côté décrit les violences comme ayant été commises « sous le prétexte de la tradition ». Des excuses sont formulées, la prise en charge des soins est annoncée, et l’on promet une réforme interne pour prévenir tout nouvel écart.
Mais cette défense, calibrée pour contenir l’incendie, ne résiste pas longtemps aux images. Les séquences filmées racontent autre chose : une clairière parfaitement ordonnée, un cercle d’« ancien·ne·s », un protocole immuable — position à genoux, silence imposé, écharpe violette passée autour du cou avant la gifle, puis le coup de pied. Rien d’un dérapage : un rite, avec sa dramaturgie et sa hiérarchie.
« Pencinta alam » : quand l’esprit de cordée bifurque
Dans l’archipel indonésien, ces clubs de nature forment une culture à part. On y apprend l’autonomie, la solidarité, la lecture du terrain, le sens du collectif. C’est une école de liberté, née dans les années 1970, au croisement du scoutisme, de la montagne et du militantisme écologique. Mais comme souvent, là où se forge l’esprit de cordée, peut aussi se loger la dérive : celle d’une loyauté dévoyée, où la soumission devient test, où l’humiliation s’habille en rite, où la douleur fait office d’appartenance.
L’État indonésien ne traite pas la violence éducative comme une tradition tolérable, mais comme une infraction pénale.
À Bitung, cette mécanique s’est déroulée sans un mot de trop. Le récit familial le dit à demi : AA, seize ans, aurait d’abord expliqué à sa mère que ses ecchymoses venaient d’une piqûre d’abeille, avant que la vérité n’émerge. Cette invention — minime en apparence — dit tout de la loi du silence qui s’impose dans ces cercles : protéger le groupe avant soi, même au prix de la vérité. C’est la face sombre de l’« esprit d’équipe » quand il se transforme en système d’emprise.

Les travaux sur la violence non accidentelle en sport sont clairs : ces pratiques n’ont aucune vertu éducative. Elles ne forment pas le caractère, elles fracturent la confiance. Elles altèrent la santé mentale, creusent le terrain des traumatismes et préparent, à bas bruit, d’autres formes d’abus — psychologiques, voire sexuels. Ce ne sont pas des gestes isolés : c’est une culture qui s’entretient, sous couvert de tradition.
Le droit indonésien : « protéger l’enfant » n’est pas un slogan
Derrière l’émotion, il y a le droit. Et en Indonésie, celui-ci ne laisse pas place à l’ambiguïté.
L’enquête ouverte s’appuie sur l’article 76C de la Loi n° 35 de 2014 relative à la protection de l’enfance : « Toute personne est tenue de ne pas commettre, laisser commettre, ordonner ou participer à des actes de violence contre un·e enfant ».
Son article 80 précise les sanctions : jusqu’à trois ans et six mois d’emprisonnement, assortis d’une amende, et davantage encore lorsque les violences provoquent des blessures graves.
En d’autres termes, l’État indonésien ne traite pas la violence éducative comme une tradition tolérable, mais comme une infraction pénale.
Et c’est précisément ce glissement — de la morale à la loi, du « c’est comme ça » au « c’est interdit » — qui redéfinit aujourd’hui les limites de la culture outdoor. Sortir la brutalité des « mœurs associatives » pour la nommer juridiquement, surtout lorsqu’elle touche des mineur·e·s, ce n’est pas une évolution symbolique : c’est la lettre de la loi, et désormais, la boussole d’une société qui commence à regarder ses rites en face.
Que peuvent (vraiment) les fédés ?
Prendre position, c’est bien. Prendre des mesures, c’est mieux. En Indonésie, la FPTI n’a pas seulement eu le courage de dire non : elle a désormais la responsabilité de traduire ce non en dispositif. Car les outils existent, ailleurs, et il suffit parfois de les adapter plutôt que de les inventer.
Depuis 2016, le Consensus du Comité international olympique — actualisé en 2024 — définit un cadre clair pour la prévention, la détection et la réponse aux violences interpersonnelles en contexte sportif. L’IFSC, la fédération internationale d’escalade, s’y conforme déjà : elle a mis en place une politique de sauvegarde, un canal de signalement confidentiel, et un protocole d’enquête à plusieurs niveaux. Ces standards, pensés pour les compétitions internationales, sont parfaitement transposables au terrain associatif : traduire les documents, former des référent·e·s, instaurer une procédure claire de remontée des incidents.
Pour la FPTI, l’enjeu dépasse la discipline. Il s’agit de diffuser une culture du respect jusque dans les clubs qui n’appartiennent pas à sa sphère directe : les pencinta alam communautaires, les MAPALA universitaires, les SISPALA lycéens. Former les encadrant·e·s, certifier les clubs, labelliser les pratiques saines : autrement dit, faire de la prévention une infrastructure solide.