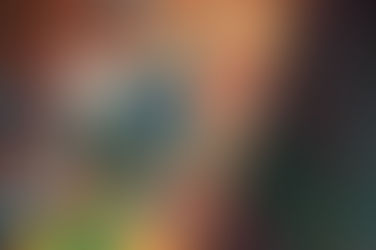Para-escalade : extension du domaine de la lutte des cases
- Hugues Lhopital

- 9 nov. 2025
- 6 min de lecture
Si la catégorisation paralympique peut produire de l'exclusion, faut-il pour autant tout rejeter ? Non, bien entendu. Pourtant, si la para-escalade de compétition est un vecteur puissant d’incitation, elle n'est que la face visible d'une discipline bien plus riche. En salles, sur les falaises, dans les clubs, d’autres escalades se pratiquent. Alors, comment construire un espace commun des escalades ?

Dans une première partie, Hugues Lhopital décryptait à quel point la classification paralympique, même en voulant produire de l’équité, pouvait générer de l’exclusion.
Séoul, septembre 2025. Championnats du monde de para-escalade. Pavitra Vandenhoven, grimpeuse belge d'origine indienne, double championne du monde en AL11 (pour Lower Extremity Amputee, ndlr), est conduite à concourir cette fois avec les hommes. Lors de la deuxième voie de qualification, elle termine 2ème ! Devant elle : Angelino Zeller, l'Autrichien quadruple champion du monde qui va décrocher l'or, et derrière elle : tous les autres concurrents masculins de la catégorie. Au final, elle terminera quatrième du classement général mixte.
Ce moment, en apparence anecdotique, raconte quelque chose d'important sur ce que permet la para-escalade lorsqu’on déplace le regard porté sur les rigidités de la classification. Ici, les catégories par déficience priment sur le genre. Hommes et femmes grimpent les mêmes voies, alternativement. Le classement reste ensuite genré, mais le fait que Pavitra ait pu performer à ce niveau, sur une voie mixte, face à des hommes, dit quelque chose sur la possibilité d'une autre approche.
Quand l'adaptation devient subversive
Le travail exceptionnel accompli par les ouvreuses et ouvreurs engagés dans l'aventure de la para-escalade en témoigne. Ces professionnel·les de plus en plus performant·e·s sont capables d'ouvrir des itinéraires de compétition permettant à plusieurs catégories de s'exprimer, même dans des voies partagées. Cette créativité interroge nos représentations binaires de la performance. Elle nous force à reconnaître que « la performance » n'est pas une chose unique et mesurable, mais une multiplicité de façons de résoudre un problème moteur. Pavitra grimpe différemment d'Angelino, qui grimpe différemment d'une personne déficiente visuelle. Mais tou·tes peuvent grimper sur la même voie, et tou·tes peuvent y exceller. Reconnaître simplement la créativité gestuelle de ces athlètes, et leur travail d'adaptation aux contraintes dictées par les voies, ouvre un nouveau regard sur le handicap.
Mais attention au piège : renvoyer les para-grimpeuses et grimpeurs à l'attribut de « super-héros » qui auraient « dépassé leur handicap » en accomplissant des performances exceptionnelles revient à faire perdurer le stigmate et à les enfermer dans une identité « handicapée ». C'est une forme insidieuse de discrimination bienveillante. Tant qu'on continue à voir le handicap comme quelque chose à « dépasser », on perpétue l'idée que c'est un problème, une réduction, une insuffisance. Alors que ces singularités peuvent être reconnues simplement comme des variations parmi d'autres dans l'infinie diversité des corps humains.
Les escalades invisibles
La para-escalade de compétition, dans sa version institutionnelle (régie par des règles et des modalités fixées par les fédérations nationales et internationales, ndlr) ne constitue évidemment pas la seule modalité de pratique. Des personnes grimpent en autonomie, avec des proches, en salle, en club ou en milieu naturel, sans obligation de se faire reconnaître comme étant en situation de handicap et sans avoir besoin de se référer à une catégorie particulière. Beaucoup vivent avec des situations de handicap invisibles, peu ou pas médiatisables. D'autres grimpent également dans le cadre d'activités thérapeutiques ou rééducatives, accompagnées par des professionnels de l'activité physique adaptée qui utilisent l'escalade comme un support de réhabilitation. Ici, pas de catégories, mais seulement (et surtout) de l'accessibilité par de la présence humaine ainsi que des adaptations du support et des modalités d'escalade en fonction des attentes et des besoins de chaque personne.
« Cette représentation de mondes distincts, de deux escalades qui ne se rencontreraient jamais, peut devenir oppressante si elle entérine l'idée qu'il y a d’un côté une « vraie » escalade – celle des valides – et une « autre » – celle des personnes en situation de handicap. Mais c'est faux »
Hugues Lhopital
C'est dans ces espaces que se joue quelque chose de plus radical que dans les compétitions officielles. Parce que là, il n'y a pas de classification médicale préalable. Il n'y a pas de classification pour savoir qui est « assez handicapé » ou pas. Reste des questions simples et concrètes : Comment cette personne peut-elle grimper aujourd'hui ? Quelles adaptations lui proposer ? Quel est son objectif personnel ?
L'escalade, dans ces contextes, retrouve sa véritable nature : un espace ouvert d'adaptation et d'expression. Le rocher ne demande pas notre catégorie. Il interroge juste les ressources que nous pouvons mettre en œuvre, et développer, pour parvenir à attraper une prise et à se mouvoir dans une voie. Et chacun.e y trouve ses propres défis, ses propres solutions et réussites.
Le vocable « para-escalade » a été choisi pour s'aligner sur les autres parasports, en référence aux Jeux paralympiques. L'utilisation de ce préfixe évoque l'idée d'une voie alternative, qui existerait « à côté » de la voie classique. Mais la définition géométrique des voies parallèles nous renvoie à l'image de deux droites qui ne se rejoignent jamais et n'ont donc aucun point commun. Cette représentation de mondes distincts, de deux escalades qui ne se rencontreraient jamais, peut devenir oppressante si elle entérine l'idée qu'il y a d’un côté une « vraie » escalade – celle des valides – et une « autre » escalade – celle des personnes en situation de handicap.
Deux mondes parallèles, fermés l'un à l'autre, qui ne partagent rien. Mais c'est faux. Et c'est justement ce que les salles, les clubs, les falaises naturelles nous rappellent : ces escalades ne sont que les différentes facettes d’un même tout. Une même escalade, avec d'infinies variations, d'infinies façons de la pratiquer, d'infinies adaptations possibles.
« Voir un enfant admirer, les yeux brillants, des para-grimpeuses et grimpeurs présentant des déficiences proches des siennes, légitime alors tout l'engagement et l'énergie mise au service de la compétition en para-escalade »
Vers un espace commun
Les catégories, comme les règles du jeu en escalade, restent mouvantes. Ce sont des constructions sociales, communément admises dans un espace-temps donné. La bi-catégorisation de l'humanité entre deux « sexes », particulièrement prégnante dans le domaine sportif, est ainsi interrogée de façon de plus en plus vive par la reconnaissance scientifique de l'existence de personnes ne correspondant pas aux critères de tri et se situant alors entre deux groupes ou dans les deux en même temps. La remise en cause de cette séparation, érigée en norme, vient questionner de façon radicale un système hiérarchisé de comparaison des performances. En présupposant qu'il y aurait avantage à être dans un groupe jugé plus performant qu'un autre, on relègue de fait l'autre groupe à des performances moindres, forcément plus désavantageuses.

Tenir compte de la réalité des conséquences de certaines déficiences sur la grimpe, sans chercher à invisibiliser la singularité des personnes, doit nous conduire à essayer de sortir de la comparaison stérile des performances entre « valides » et « non-valides » – à l'image des comparaisons hommes-femmes. Que peut-on objectivement dire de la cotation d'une voie réalisée avec ou sans la vue, avec une ou deux jambes ? Rien de définitif. Rien qui permette une hiérarchie claire et surtout nécessaire.
La para-escalade de compétition institutionnelle n'est qu'une modalité de pratique parmi d'autres. Elle a son intérêt : elle crée de la visibilité, elle inspire des paragrimpeuses et grimpeurs qui se voient représentés dans le sport de haut niveau, elle pousse l'innovation en matière d'ouverture de voies et d'entraînement. C'est toujours une belle réussite lorsqu'une personne concernée, voyant des champions et championnes performer, se sent alors légitime pour accéder elle aussi à la performance. Voir un enfant admirer, les yeux brillants, des para-grimpeuses et grimpeurs présentant des déficiences proches des siennes, et entendre ses parents dire : « Merci, on a enfin trouvé un sport qui lui correspond », légitime tout l’engagement et l’énergie déployés au service de la compétition en para-escalade. Mais celle-ci ne doit alors pas écraser les autres formes de pratique. Elle ne doit pas devenir la seule légitimité de l'escalade pour les personnes en situation de handicap. Parce que là où la compétition exclut – par la catégorisation, par la médicalisation, par la sélection – l'escalade « ordinaire » inclut simplement.
Dépasser les catégories nous oblige donc à dépasser ces représentations entre des mondes différents, embarqués sur deux lignes vouées à ne jamais se croiser ni se rencontrer. Construisons plutôt un espace commun des escalades, ouvert et riche de ses hétérogénéités et de sa plasticité, comme un témoignage en mouvement de l'infinie diversité de l'humain. Un espace où coexistent la compétition et le loisir, la performance et l'adaptation, la classification et la liberté. Un espace où chacun peut trouver sa place — non pas parce que sa place a été assignée à une case, mais parce qu'on a créé un espace assez grand, assez flexible, assez accueillant pour que tout le monde puisse y exister.
Après tout, face à la roche, nous sommes tou.tes des humain·es inadapté·e·s qui cherchons nos prises.