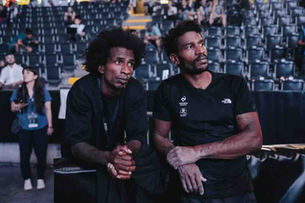Ebony Peaks : quand gravir une montagne devient un acte de résistance
- Adrien Bataille

- 19 nov. 2024
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 27 nov. 2024
À qui appartiennent les montagnes ? Posée comme ça, la question semble absurde. Les sommets n’appartiennent à personne, pas vrai ? Pourtant, à observer qui foule les glaciers, qui poste ces photos victorieuses au sommet d’un 4 000 mètres, une autre réalité s’impose : la montagne est un espace codifié. Les grimpeurs blancs, masculins et issus de milieux favorisés dominent l’imaginaire collectif. Le reste ? Invisibilisé.
C’est là que la vidéo "Ebony Peaks | Challenging the Stereotype" frappe fort. Signée adidas TERREX, elle suit Maria, Hannah et Helen, trois femmes noires, dans leur tentative de gravir le Bishorn, un sommet alpin de 4 153 mètres. Initiée par Black Canary, un collectif berlinois, cette aventure est une réappropriation. Pour Tsellot Melesse, fondatrice de Black Canary, « Gravir une montagne, ce n’est pas seulement atteindre un sommet. C’est montrer que cet espace nous appartient aussi. »

La montagne comme territoire élitiste
Historiquement, l’alpinisme est une activité élitiste. Né dans les salons bourgeois du XIXe siècle, il s’inscrit dans une quête de domination – des sommets, mais aussi des cultures. Les expéditions coloniales pour atteindre l’Himalaya en sont l’illustration. En Europe, cette tradition se perpétue : équipements coûteux, culture sportive transmise au sein de familles favorisées… La montagne est restée un privilège.
« Là où j’ai grandi, personne ne faisait de yoga ou de randonnée. Ce n’était pas accessible, » raconte Tsellot. Pour elle, comme pour beaucoup d’autres, les sports de plein air évoquent un monde étranger, réservé à une élite qui, à force de ne pas être contredite, a fini par s’imaginer seule légitime dans ces espaces.
« Ce que j’aime dans la nature, c’est qu’elle ne fait pas de distinction. Alors pourquoi est-ce que nous en faisons ? »
Le collectif Black Canary est né de cette fracture. À travers ses randonnées et expéditions, il propose une alternative : un groupe où la couleur de peau ou le genre ne sont plus des barrières. Pour Tsellot, l’objectif est clair : « Ce que j’aime dans la nature, c’est qu’elle ne fait pas de distinction. Alors pourquoi est-ce que nous en faisons ? »

Gravir ses peurs, gravir ses montagnes
L’expérience vécue par Maria, Hannah et Helen lors de l’ascension du Bishorn reflète cette ambition. « Je suis Maria. Je n’ai jamais gravi une montagne. » Cette phrase, simple et directe, résume à elle seule l’enjeu de cette aventure : transformer une première fois en acte politique.
Pour Helen, cette confrontation avec la montagne est aussi une lutte intérieure. « Extérieurement, je marche sur du plat, mais intérieurement, je gravis constamment des montagnes. » Ces "montagnes invisibles", ce sont les stéréotypes, la peur de ne pas être à sa place, et ce sentiment, partagé par beaucoup, d’être toujours en train de devoir prouver quelque chose.
Pour Maria, la peur est plus immédiate : « J’ai peur. Ça ne veut pas dire que je vais échouer, mais c’est important de le dire. » En alpinisme, un monde souvent marqué par l’injonction à la performance, cette sincérité est presque subversive.
Quand l’épreuve devient collective
Sur le terrain, les obstacles s’enchaînent. Le Bishorn, bien que classé parmi les "sommets accessibles", exige crampons, piolets et cordes. Les participantes, accompagnées par Suzanne, première femme guide de haute montagne en Suisse, découvrent un environnement rude, indifférent à leur fatigue ou à leurs doutes.

Après quelques heures de marche, Helen verbalise ce que beaucoup n’osent pas dire : « C’est incroyable ce qu’on fait, et ça me suffit. Je n’ai pas besoin d’atteindre les derniers 200 mètres pour me sentir accomplie. » Une réflexion reprise par Maria : « Dire : ‘Je ne peux pas continuer’ et l’accepter, c’est bien plus fort que d’atteindre le sommet. »
Ces moments de vulnérabilité partagée redéfinissent les codes du dépassement. La performance brute – atteindre ou non le sommet – s’efface devant l’expérience collective, marquée par la solidarité et l’écoute.
Le sommet comme métaphore
À travers la vidéo Ebony Peaks, une autre vision de la montagne émerge. Les glaciers ne sont plus des espaces de domination, mais des terrains d’émancipation. Cette approche casse les codes d’un alpinisme élitiste, tourné vers l’exploit individuel, pour valoriser la diversité et l’inclusion.
Ce message est amplifié par le collectif Black Canary, qui cherche à inspirer d’autres parcours. « Si elles y arrivent, alors moi aussi, » résume une participante dans le film. Derrière cette phrase, une ambition : ouvrir la montagne à celles et ceux qui ne s’y voient pas représentés.
Une conclusion ouverte : revendiquer sa place
L’ascension du Bishorn ne se termine pas par une photo classique au sommet. Et c’est justement ce qui la rend marquante. Pour Helen, cette aventure a été libératrice : « Nous voulions vibrer, profiter, et ne pas nous sentir obligées d’atteindre absolument le sommet. C’était libérant. »
Maria, elle, y voit une promesse d’avenir : « Je reviendrai. Et cette fois, je ferai l’ascension complète. » Car au fond, cette aventure dépasse la simple notion de performance sportive. Elle raconte une histoire de courage, de solidarité et de réappropriation. La montagne devient un espace où se redéfinir, un lieu où tout le monde a sa place.
Ebony Peaks, disponible sur YouTube, est un manifeste pour un alpinisme à hauteur d’humanité. « Gravir une montagne, c’est bien plus qu’un sommet, » conclut Tsellot. « C’est revendiquer sa place. »