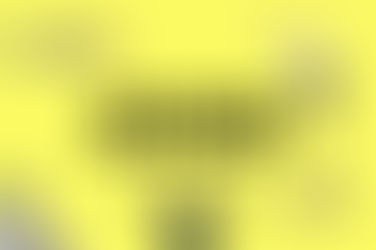Coupé du monde, le Népal explose
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 9 sept. 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 15 sept. 2025
Il a suffi d’un décret pour rallumer le volcan. Le 4 septembre, Katmandou a coupé vingt-six plateformes numériques, pensant réguler ses flux. Quatre jours plus tard : dix-neuf morts, un Premier ministre en fuite, des ministres exfiltrés en hélico, un couvre-feu dans la capitale. La coupure des réseaux sociaux n’a pas ouvert une parenthèse : elle a révélé la faille d’un pays saturé par la corruption, pris en otage par ses voisins, et peuplée d'une jeunesse en ébullition.

Dans notre article initial, Himalaya hors‑ligne : le Népal débranche les réseaux sociaux, nous avions raconté comment un décret avait soudain privé le pays de vingt-six plateformes, désorganisant la communication quotidienne et fragilisant la logistique des expéditions. Mais depuis, des échanges avec des acteurs locaux nous ont montré que nous étions passés à côté de l’essentiel : cette coupure n’est pas seulement un blackout numérique, mais le déclencheur d’une crise politique et sociale d’une ampleur inédite. Derrière l’écran noir, c’est tout un pays qui a basculé. Et parce que Vertige Media refuse d’en rester à la surface, nous nous devions d’y revenir.
Quand Katmandou a tiré la prise
Le 28 août, le gouvernement avait lancé un ultimatum : sept jours pour que les plateformes numériques ouvrent un bureau au Népal, nomment un représentant local et se plient aux « mécanismes de conformité ». Le 4 septembre, faute de réponse, le couperet est tombé pour une majorité d'entre elles : WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, X, LinkedIn, Signal, Discord… En une nuit, l’écran d’accueil des smartphones népalais s’est vidé de sa substance.
Certaines exceptions subsistaient pourtant. TikTok ou encore Viber ont continué de fonctionner, non pas par faveur politique, mais parce qu’elles s’étaient pliées à l’ensemble des exigences du gouvernement. La ligne rouge était claire : obéir, ou disparaître. La Cour suprême avait certes reconnu l’obligation d’enregistrement, mais elle n'a jamais ordonné la coupure. C’est le gouvernement qui a choisi d’aller plus loin, comme si le droit servait de prétexte à une démonstration d’autorité. Une décision administrative en apparence, mais aux conséquences abyssales : des millions de personnes privées de réseau, et des centaines d’expéditions brutalement désorganisées.
L'effet boule de neige
Le blackout n’a pas créé la colère, il l’a catalysée. Car le vase était déjà plein :
Corruption et népotisme : le Népal figure depuis des années parmi les pays les plus corrompus d’Asie du Sud. Les scandales de détournement, les nominations de complaisance et la concentration du pouvoir entre quelques familles rythment la vie politique. Pour une jeunesse confrontée au chômage, ce théâtre est d’autant plus insupportable qu’elle y assiste en direct, nourrie quotidiennement par les réseaux sociaux qui exposent sans filtre la gabegie et l’impunité des élites.
Racket géopolitique : le pays est pris en étau entre ses deux voisins géants. Pékin finance routes, barrages et infrastructures dans le cadre des « Nouvelles routes de la soie », au prix d’un endettement croissant. L’Inde, de son côté, contrôle les importations de carburant et n’hésite pas à imposer des blocus (non officiellement reconnu par l’Inde) : en 2015, un ralentissement orchestré de ses flux avait paralysé le pays pendant des mois. Résultat : une souveraineté en trompe-l’œil, constamment négociée sous contrainte.
Absence de perspectives : chaque année, environ 400 000 jeunes quittent le pays pour travailler au Qatar, aux Émirats ou en Corée. Les transferts d’argent envoyés par cette diaspora représentent près d’un quart du PIB — un chiffre record mondial, signe d’une économie incapable de retenir ses forces vives. Ceux qui restent se sentent prisonniers d’un système bloqué, sans ascenseur social, sans horizon.
Dans ce contexte, priver la jeunesse de ses réseaux, c’était retirer le dernier espace de respiration. L’avalanche n’attendait qu’une secousse : elle est venue d’un écran noir.
La rue contre le ciel
La contestation a explosé. Dix-neuf morts selon le bilan officiel, des centaines de blessés. À Katmandou, mais aussi à Itahari et dans d’autres villes, des cortèges massifs ont défié l’interdiction, slogans scandés à pleins poumons, drapeaux brandis au milieu des flammes.
La répression a été brutale : gaz lacrymogènes, canons à eau, tirs à balles réelles. Des maisons de dirigeants incendiées. Le Premier ministre KP Sharma Oli a fini par démissionner. Plusieurs ministres ont suivi. L’armée a dû évacuer par hélicoptère les responsables retranchés dans leurs résidences de Bhaisepati, symbole d’un pouvoir qui tente de s’échapper par les airs. Sans hashtags, sans tweets, sans lives, la jeunesse a provoqué une protestation pure, sans filtre.
Le tourisme en apnée
« Après deux jours de manifestations menées par la génération Z, la situation au Népal reste effectivement instable suite à la démission du gouvernement. En tant que professionnels du secteur touristique, nous avons la responsabilité de fournir des informations fiables et actualisées en temps réel. Garantir la sécurité de tous les voyageurs demeure notre priorité. Un couvre-feu général a été instauré à Katmandou, toutefois les taxis, ambulances et autres services essentiels sont autorisés à circuler », nous explique Emile Stantina, directeur de L'Everest Népal, une jeune agence locale.
Le tourisme est une colonne vertébrale fragile mais vitale : près de 8% du PIB, des centaines de milliers d’emplois, et une vitrine internationale. Chaque saison, des milliers d’alpinistes et de trekkeurs passent par Katmandou avant de rejoindre le Khumbu, l’Annapurna ou le Langtang. Quand la capitale s’arrête, c’est toute la chaîne qui vacille : guides sans clients, porteurs sans missions, expéditions suspendues. L'avenir de la pratique au Népal ne se joue pas seulement au camp de base à 5 364 mètres, il se dessine en ce moment dans le quartier de Thamel, poumon touristique de la capitale et théâtre des heurts. Quand Katmandou suffoque, l’Himalaya retient son souffle.
Le Népal restera le pays des 8 000, mais sera désormais celui d'un autre relief : une jeunesse à bout et désoeuvrée qui refuse d’être coupée du monde. En septembre 2025, ce n’est pas la montagne qui a donné le vertige, mais toute une société, révélant que la corde était déjà trop tendue.