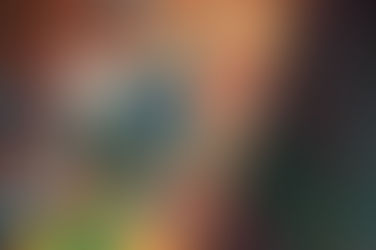Boards connectées : l’affaire Kilter–Aurora, autopsie d'une dépendance
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 6 nov. 2025
- 12 min de lecture
Dans la plupart des salles, la magie opère : on choisit un bloc sur l’appli, les prises s’allument, on grimpe. Jusqu’au jour où ça s'éteint. L’arrière-plan de l’affaire Kilter–Aurora suit un fil dont on a débranché la prise : le fabricant de la planche d’un côté, l’éditeur de la plateforme de l’autre. Et au milieu : l'écosystème de l'escalade indoor qui dépend de leur entente. Les deux entreprises ont engagé des actions en justice. Nous avons enquêté pour faire la lumière sur la manière dont les faits se sont déroulés, ce que chacun avance et ce que cela implique pour les salles et les grimpeur·ses.

Elles ont envahi les salles comme une évidence : un plan inclinable, des centaines de prises, une application qui allume, mémorise, synchronise, et transforme l’entraînement en langage commun. Une Kilter Board, c’est la promesse d'un saut dans la modernité. Dans la réalité, c'est un pan inclinable aux prises rétro-éclairées par LED, piloté par une application. Pour fonctionner, il faut l’ensemble : appli + kit LED (contrôleur + rubans). Arrivées à la fin des années 2010, ces boards connectées se sont imposées comme un standard d’entraînement : de l’ordre de 8 000 à 30 000 € selon la taille et la configuration (hors cadre, tapis et pose), en échange d’un flux de contenus « prêts à jouer » et d’une base mondiale qui relie les grimpeur·ses d’un mur à l’autre.
Derrière la magie apparente, un point faible : le lien d'attachement vital entre la planche (le hardware) et « le cerveau » (l’appli + LED). Quand l'union vacille, tout le système peut s'écrouler. Et depuis des mois, Kilter (fabricant américain à l’origine de la Kilter Board) et Aurora (entreprise canadienne qui opère l’application et fournit les kits LED pour plusieurs acteurs) s’opposent en justice. Ce qui se réglait autrefois par mails et coups de fil se plaide désormais à la barre, aux États-Unis comme au Canada. Et au milieu, les salles d'escalade tentent de suivre. Avec tous les signaux d'alerte qui clignotent.
Été 2025, l'affaire commence à sortir. Le 22 juillet, Kilter porte réclamation devant le tribunal fédéral du District du Colorado : la société affirme avoir co-conçu l’app Kilter Board, dit avoir versé plus de 4,8 millions de dollars dans le cadre de cette relation commerciale et reproche à Aurora des restrictions : accès aux données clients, conditions de fourniture des kits LED. Kilter réclame un procès avec jury et plus d’un million de dollars de dommages-intérêts. Le 27 août, en Colombie-Britannique, Aurora soutient en retour que Kilter a commercialisé des kits non-Aurora et les a connectés à l’application Aurora en contradiction avec un accord intérimaire de 2024, tout en développant une app « modélisée » sur la sienne. Aurora demande des injonctions et des dommages-intérêts.
La planche et le cerveau
À l’origine, un pan n’est qu’un plan inclinable et une imagination collective : on grimpe, on tombe, on recommence. L’arrivée de l’application déplace le centre de gravité : elle allume les prises, archive les essais, synchronise les murs... La planche cesse d’être un objet isolé pour devenir un nœud de réseau. On rejoue des classiques venus d’ailleurs, on compare des tentatives entre salles, on suit des ouvreur·ses favori·tes, on marque des « projets », on revient, on valide. L’entraînement n’est plus seulement une suite de blocs, c’est une chronologie de données : temps passé, réussite/échec, tentatives, ressentis, parfois même des vidéos qui documentent la progression.
« Avoir une board d’entraînement qui repose sur une application et ne pas avoir le contrôle de cette application, c’est comme conduire une voiture à deux : l’un tient le volant et l’autre appuie sur les pédales »
Alex Ruiz, co-fondateur & directeur des opérations de Shiny Wall
Ce basculement entraîne une autre révolution, discrète mais décisive : la standardisation des contenus. Un même problème existe sur des dizaines de boards, avec la même cartographie lumineuse. Un bug d’alignement ou une mise à jour d’algorithme peut donc impacter, en une seconde, des milliers de sessions. L’app devient alors éditeur, arbitre et mémoire : elle sélectionne ce qui est visible, ordonne ce qui est recommandable, nettoie ce qui est obsolète. Derrière, il y a de la modération, du classement, des règles d’interopérabilité. Bref, toute une gouvernance. Et avec elle, des coûts de sortie : plus l'historique est riche et les communautés actives, plus il est difficile de changer de cerveau sans perdre une partie du « capital d’entraînement ».
Dans un univers indoor où tout se renchérit — loyers, énergie, masse salariale — la promesse est irrésistible : un outil lisible pour le public, dense en contenus, économe en ouvertures à gérer au quotidien, capable d’animer un mur en trois clics. Au point que « Kilter » est devenu, par abus de langage, un nom générique. Mais le miracle a une condition technique souvent sous-estimée : la continuité logicielle. Tant que la board et l’app se comprennent, tout roule. Dès que l’application ne reconnaît plus ce à quoi elle parle — contrôleur, rubans, protocole — l’édifice vacille : classements figés, blocs inaccessibles, prises qui s’allument à contretemps, support qui renvoie au contrat. Dans un monde de pans « intelligents », l’intelligence n’est rien sans la stabilité du lien.
Un mur, deux philosophies
Techniquement, une Kilter Board — comme toute board du marché — a besoin d’une application et d’un kit LED (contrôleur + rubans). À partir de là, deux lignes stratégiques se dessinent, et elles ne racontent pas la même histoire du risque.
« Nous avons mis à jour nos conditions d’utilisation le 27 février 2023, en réponse à l’évolution de notre relation avec Kilter »
Peter Michaux, fondateur d’Aurora
La première consiste à s’appuyer sur une plateforme tierce qui mutualise le cerveau pour plusieurs fabricants. C’est l’option historique de Kilter, comme celle de Tension, un autre acteur qui collabore également avec Aurora. Will Anglin, président de Tension (à Denver dans le Colorado), nous résume le calcul industriel : « La stabilité et les fonctionnalités de l’application Aurora et du kit LED restent, à mon avis, inégalées. Développer et maintenir les logiciels et le matériel nécessaires pour que les utilisateur·rices puissent interagir facilement avec des boards standardisées n’est pas une mince affaire ». Le bénéfice est clair : on délègue le plus fragile — le logiciel — à ceux dont c’est le métier, à condition d’entretenir la relation : « Il est nécessaire que les fabricants de cadres muraux et les développeurs d’applications entretiennent des relations solides et mutuellement bénéfiques. » Traduction : l’interopérabilité n’existe que si le contrat tient.
La seconde philosophie est de maîtriser l’application en interne pour garder l’entièreté de l’expérience. C’est la route choisie à Barcelone par Shiny Wall, une marque qui conçoit des pans d’entraînement connectés et édite sa propre application. Alex Ruiz, co-fondateur & directeur des opérations, assume le surcoût initial : « Bien sûr, travailler sur l’application nous prend du temps et nous rencontrons quelques problèmes pour trouver la meilleure façon de faire les choses, mais cela n’est rien comparé aux avantages. » L’image est parlante : « Avoir une board d’entraînement qui repose sur une application et ne pas avoir le contrôle de cette application, c’est comme conduire une voiture à deux : l’un tient le volant et l’autre appuie sur les pédales. » Ici, le risque se déplace : moins d’aléas contractuels, plus d’efforts en recherche et développement.
Dans l’affaire qui nous occupe, Kilter a choisi l’objet, Aurora la plateforme. Deux choix rationnels, deux dépendances différentes — et un frottement inévitable dès que les règles d’usage se resserrent.
L'enchaînement procédural
Sur le plan documenté, le premier jalon opposable est la mise à jour des conditions d’utilisation (Terms of Use) d’Aurora, datée du 27 février 2023. Selon Peter Michaux, fondateur d’Aurora, cette mise à jour répond à des échanges avec Kilter devenus conflictuels et confus dès août 2022. Autrement dit, la formalisation de ces règles s’inscrit dans un contexte déjà tendu, et ne constitue pas le point de départ de la discorde.
Deux éléments centraux sont formalisés : une clause d’usage autorisé réservant l’application au matériel fabriqué par Aurora (il s’agit d’une limitation contractuelle d’usage, non d’une impossibilité technique, ndlr) et l’interdiction d’ingénierie inverse. Peter Michaux nous le résume ainsi : « Nous avons mis à jour nos conditions d’utilisation le 27 février 2023, en réponse à l’évolution de notre relation avec Kilter ».
Dans la foulée d’une relation qui s’était déjà tendue, Kilter et Aurora signent en avril 2024 un accord d’achat intérimaire. Ce document contraignant, en vigueur jusqu’à ce qu’un autre accord le remplace, a permis de reprendre les relations commerciales sur des bases formalisées et écrites, tout en travaillant à la résolution de leurs différends. Il fixe : (i) les conditions d’achat des kits LED d’Aurora, (ii) les conditions d’utilisation de l’app — incluant une clause d’usage autorisé stipulant que l'application est permise uniquement avec du matériel fabriqué par Aurora (limitation contractuelle) et l’interdiction d’ingénierie inverse, (iii) une politique de confidentialité. Comme nous le précise Peter Michaux : « Ces conditions incluaient celles sous lesquelles nous avions toujours travaillé, même si elles n’avaient pas toutes été formalisées dans un seul document auparavant ».
Le 22 juillet 2025, Kilter saisit le tribunal fédéral et déroule sa version. La société affirme avoir co-conçu l’application Kilter Board avec Aurora et avoir investi plus de 4,8 millions de dollars dans cette relation commerciale. Elle reproche à Aurora d’avoir « relooké » l’app pour des acteurs concurrents, d’avoir restreint l’accès à des données clients partagées et d’avoir conditionné la fourniture de kits LED à de nouvelles conditions. Selon la plainte que nous avons consultée, Kilter reproche à Aurora d’avoir rompu le contrat et de ne pas avoir joué franc jeu. À défaut, Kilter évoque des promesses non tenues et un avantage indû. Le texte mentionne aussi un raccourcissement unilatéral de garantie, des défaillances sur une série de kits livrés en 2024, ainsi que des propos nuisibles rapportés chez des clients. S’ajoutent des accusations de pratiques commerciales trompeuses et d’ingérence dans ses relations d’affaires. Kilter demande un procès avec jury et plus d’un million de dollars de dommages-intérêts.
« Malgré des années d'efforts de bonne foi pour trouver une solution, l'obstruction continue d'Aurora et la perturbation intentionnelle de l'expérience client n'ont laissé à Kilter d'autre choix que d'aller de l'avant de manière indépendante. Nous lançons une nouvelle application et un nouveau système de kit d'éclairage afin de rétablir la fiabilité, l'innovation et le soutien total à la communauté des grimpeur·ses »
Kilter
Côté canadien, Aurora dépose son assignation le 27 août 2025 et expose ses griefs. Selon ce document, que nous avons également pu consulter, Aurora soutient que Kilter aurait mis sur le marché des kits LED non-Aurora en les présentant comme des produits Aurora, puis aurait connecté ce matériel « non autorisé » à l’application Aurora, en contradiction — selon Aurora — avec l’accord intérimaire de 2024 (conditions d’achat, d’utilisation, confidentialité, droit applicable). Aurora soutient également que Kilter développerait et testerait une application concurrente « modélisée » sur la sienne, en violation des clauses d’ingénierie inverse et de dérivés. La société demande au tribunal à la fois des injonctions, pour encadrer l’usage de l’application et du système LED le temps que l’affaire soit jugée, ainsi que des dommages-intérêts.
À la date de publication de cet article, aucune décision sur le fond n’a été rendue. Aucune des versions n’a, juridiquement, valeur d’établissement des faits. Nous nous en tenons donc aux documents et aux positions officielles communiquées.
La ligne de Kilter
Dans le vacarme technique, Kilter choisit la bannière du service. Les réponses que la société nous adresse en réponse à nos questions s’ouvre comme une promesse… tout en pointant du doigt l’obstacle : « Kilter fournit des produits et un service client de la plus haute qualité à la communauté des grimpeur·ses. Malheureusement, la décision d'Aurora de retenir les kits d'éclairage et de restreindre l'accès aux données clients partagées entrave la capacité de Kilter à assister ses utilisateur·rices. Nous espérons que ce litige pourra être résolu à l'amiable et sans qu'Aurora ne supprime les informations de nos clients ».
« Les problèmes sont apparus juste après l’installation du mur. Lorsque nous avons contacté Aurora pour nous référencer, ils ont détecté que le contrôleur LED installé n’était pas le leur et que Kilter semblait copier leur matériel »
Alan Menéndez, gérant de One Move (Espagne)
Le ton est posé : qualité, continuité, et un grief central — l’accès aux briques qui font tourner la machine. Puis Kilter pousse la porte suivante : si la relation se grippe, l’entreprise revendique le droit d’avancer seule : « Malgré des années d'efforts de bonne foi pour trouver une solution, l'obstruction continue d'Aurora et la perturbation intentionnelle de l'expérience client n'ont laissé à Kilter d'autre choix que d'aller de l'avant de manière indépendante. Nous lançons une nouvelle application et un nouveau système de kit d'éclairage afin de rétablir la fiabilité, l'innovation et le soutien total à la communauté des grimpeur·ses ».
On entend ici le déplacement stratégique : sortir du tête-à-tête, reconstituer un « cerveau » à part entière et promettre de la stabilité. Reste à situer l’histoire commune : Kilter revendique sa place dans la genèse du logiciel qui a fait école : « Kilter et Aurora ont développé conjointement l'application Kilter Board. Kilter a également fourni la majeure partie du financement. Nous restons fiers de nos innovations et de notre communauté, et nous continuerons à donner la priorité à la transparence, à la fiabilité et à l'expérience d'escalade que nos clients méritent ».
Le message est clair : antériorité, mise de fonds, et cette dialectique très américaine de la transparence et de la fiabilité comme preuves d’amour aux utilisateur·rices. Enfin, un clin d’œil de calendrier — manière de dire que le chantier n’est pas une menace, mais une feuille de route : « Nous sommes impatients de vous en dire plus sur la nouvelle application Kilter et le kit d'éclairage, conçus pour les grimpeur·ses, par des grimpeur·ses, dans les semaines à venir ».
Prises ensemble, ces réponses dessinent un récit d’autonomie revendiquée : Kilter se présente à la fois comme gardien du standard vécu par les salles et comme architecte d’un futur. Ce sont leurs mots, leur tempo, leur promesse. Le reste — la compatibilité réelle, les migrations sans perte, la tenue du service — se jugera à l’épreuve des séances, là où une phrase marketing ne pèse jamais bien lourd face à une LED qui refuse de s’allumer.
La vérité du terrain
Reste à descendre du contrat à la prise qui s’allume — ou pas. À Gijón (Espagne), Alan Menéndez, gérant de One Move, décrit la séance qui déraille : « Les problèmes sont apparus juste après l’installation du mur. Lorsque nous avons contacté Aurora pour nous référencer, ils ont détecté que le contrôleur LED installé n’était pas le leur et que Kilter semblait copier leur matériel. À partir de là, les incidents ont commencé : l’application ne fonctionnait pas correctement (la connexion entre les utilisateur·rices et les appareils échouait, ndlr) et le système LED présentait des comportements étranges — des lumières qui ne correspondaient pas ou avec des couleurs incorrectes s’allumaient ».
Ce témoignage rapporte la lecture d’Aurora (« contrôleur non Aurora »). Cependant, nous n’avons pas pu la vérifier de manière indépendante. Kilter, de son côté, évoque des bugs sur une série de kits livrés en 2024 dans sa plainte et sa déclaration publique. Autrement dit, deux explications coexistent, et l’affaire se jouera ailleurs que dans une salle espagnole. Ici, l’essentiel est tangible : sessions hachées, couleurs incohérentes, tentatives non enregistrées, classements figés — et un staff qui bascule en mode dépannage pendant que la file s’allonge.
Ce que cette scène met en lumière, ce n’est pas « qui a raison », mais où se situe la fragilité : au point de jonction entre appli, contrôleur et rubans. Dès qu’un maillon « peut être » considéré comme non reconnu ou non autorisé, l’incident n’est plus un simple aléa technique : c’est une rupture de continuité vécue par l’usager, avec un coût immédiat pour la salle (temps, réputation, remboursements). À très court terme, les questions ne sont pas juridiques, elles sont pratiques :
Qui pilote le ticket quand ça décroche (appli, contrôleur, board) et dans quel délai ?
Quelles versions (firmware/app) sont exigées pour que tout se parle aujourd’hui ?
Que deviennent les données de séance (historique, projets, classements) en cas de panne prolongée ou de changement de « cerveau » ?
C’est après ce constat de terrain que le droit reprend la main, non pour arbitrer une LED capricieuse, mais pour dire ce qui a le droit de parler à quoi — et à quelles conditions.
Après le contrat, la réalité
Pour démêler ce qui relève de la technique et ce qui tient au contrat, nous avons soumis le sujet à Maître Rahou, avocate en Propriété Intellectuelle (IP) et en Technologies de l'Information (IT). Son regard, précautionneux — et c’est le principe de prudence ici — ne préjuge pas de l’issue, mais remet des jalons là où l’intuition s’égare souvent. D’abord, dit-elle en substance, le « cerveau » d’une board n’est pas une idée mais une forme : tant que rien n’a été cédé noir sur blanc, la propriété intellectuelle du logiciel original appartient à celui qui l’a écrit. À l’inverse, l’idée — allumer des prises, synchroniser des tentatives, classer des blocs — ne se protège pas. Toute la ligne de crête est là : copier un actif protégé (du code, une architecture originale) tombe sous la contrefaçon ; redévelopper une solution visant la même finalité sans reprendre l’actif d’autrui peut rester licite. Encore faut-il le prouver : distinguer une ressemblance fonctionnelle de la reprise d’un code n’est pas un débat d’opinion, c’est une affaire d’éléments techniques.
Vient ensuite ce que le terrain appelle parfois « compatibilité », et que les juristes nomment contrat. Les clauses de « connexions autorisées » et d’interdiction d’ingénierie inverse ne sont pas des notes de bas de page : elles fixent ce qui a le droit de parler à quoi — application, contrôleur, rubans — et à quelles conditions. Dans notre affaire, la mise à jour des conditions d’utilisation d’Aurora le 27 février 2023, puis l’accord d’achat intérimaire d’avril 2024, ont précisément pour effet de formaliser ce cadre. Si une partie branche du matériel que l’autre n’autorise pas, la question n’est plus seulement technique : elle devient contractuelle, et peut fonder des demandes d’injonctions ou de dommages-intérêts si le juge suit cette lecture.
Que regardera un tribunal ? « Le texte, la chronologie et la preuve », résume Maître Rahou. Le texte : quelles clauses exactes, dans quel ordre, avec quel droit applicable ? La chronologie : qui a fait quoi, quand, au regard des dates charnières (conditions 2023, accord 2024) ? La preuve : similitude de code ou simple convergence fonctionnelle ? À cela s’ajoutent les effets allégués — accès aux données, compatibilités, support — et la proportionnalité des remèdes sollicités. Le reste — rumeurs, impressions de terrain — pèse peu face à un micrologiciel documenté.
Au fond, la querelle Kilter–Aurora tient dans une équation simple et cruelle : plus le logiciel organise l’expérience, plus il gouverne l’objet. La justice dira où passe la frontière entre une interopérabilité organisée par contrat et une reproduction interdite. En attendant, rappelle l’avocate, la meilleure protection des acteurs tient dans la documentation : ce qui est branché, ce qui est modifié, sous quel titre — et à quelle date. Le droit n’éteint pas les LED. Il dit seulement qui a le doigt sur l’interrupteur.