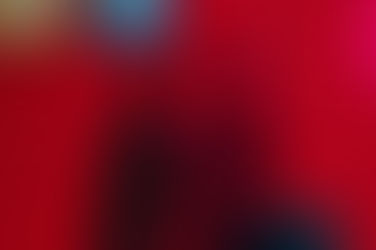Lauriane Miara : « Je nous souhaite qu’une seule chose : vivre en paix »
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 18 nov. 2025
- 10 min de lecture
À Annecy, après la projection de L'Art Vivant, le public reste suspendu aux images de Laponie et aux mots de celle qui les a peintes. Entre aquarelles délicates et trous noirs intérieurs, entre cabanes finlandaises et vallées alpines bétonnées, il fallait donc aller voir cette artiste qui dessine ce qu'elle ne parvient pas à toucher. Douceur, dureté, refuge : bienvenue dans le monde de Lauriane Miara.

La séance vient de se terminer à Annecy. Dans la salle, on discute encore du film, de ces plans de Laponie, de cette voix calme qui raconte les glaciers qui reculent. Lauriane Miara, elle, s’enfonce un peu plus au fond de son fauteuil, comme pour se soustraire encore quelques secondes aux regards. Elle prévient dans un demi-sourire : « Je m’installe au fond du fauteuil. Ce n’est pas pour avoir une attitude hautaine. C’est pour me détendre le dos ». Le détail a l’air anodin, mais il dit déjà beaucoup. Ce réflexe de désamorcer, de justifier le moindre geste, de ne pas laisser croire qu’elle « prend la pose ».
La graphiste et illustratrice française fait partie de ces personnes qui, une fois qu’on les a croisées, continuent à habiter le paysage intérieur. On ne saura pas vraiment qualifier l'empreinte qu'elle laissera sur son fauteuil ce soir-là, mais on prendra bien confiance de la trace qu'elle a laissée au public d'Annecy après la projection de son documentaire, L'Art Vivant, à l'occasion de la dernière édition du festival Femmes en Montagne. Sur l'écran, Lauriane Miara parle de trous noirs, de déracinement, de canicules alpines et d'hypnoses capitalistes pour peindre son portrait, celui d'une artiste fascinée par les grands espaces sauvages de montagne. Entre les laavus - abris forestiers de Laponie et les câbles de Bourg-Saint-Maurice où elle habite, la protagoniste du documentaire témoigne d'une oeuvre fragile et questionne la place de ses semblables dans ces territoires. Avec une certaine justesse, puisque le jury du festival lui a décerné le Prix Environnement. Légère ironie que de commencer notre conversation avec la lauréate qui nous partage d'emblée son aversion pour les écrans. L'Art Vivant sera bientôt diffusé à la Radio télévision suisse (RTS), une des premières chaînes télévisées du pays. Ces écrans, elle les fuit par écoeurement physique et pourtant, il va bien falloir composer avec. Alors, Lauriane Miara invoque ce qui compose souvent la réalisation de ses aquarelles : la paix. Et le calme qui y surgit. « On me parle souvent de douceur, confie-t-elle. On me dit "c'est la douceur de Lauriane", je le lis parfois aussi. Pour moi, c’est très étrange, parce que je ne me sens pas du tout comme quelqu’un de doux. J’ai plutôt l’impression d’être quelqu’un de dur. »
La lutte invisible
Lorsqu’elle parle de ce qu’elle vit, l'artiste ne se cache pas derrière les périphrases. Quand elle parle de trou noir, elle en parle au sens littéral du terme. « Il y a un moment, dans ma vie, où je suis tombée dans un trou, raconte-t-elle.Vraiment, c’est un trou noir. Je n’ai pas de meilleure image que ça. Après, il a fallu remonter. Maintenant, ça va mieux, mais je dois toujours être dans une lutte un peu quotidienne pour ne pas me laisser absorber par ce même trou noir. C’est un peu comme si je marchais sur un sol troué. » Les mots sont précis, le sens est à l'avenant. Plusieurs fois dans l'échange, Lauriane Miara laissera la place aux épreuves sans forcément les nommer. Pour elle, avancer consiste à repérer, anticiper, ajuster. Non pas pour « optimiser » son quotidien, mais pour rester debout. « Je dois faire attention à comment je dors, à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je consomme, à mon rythme de vie, à la façon dont je travaille aussi, continue-t-elle. Il faut que je fasse attention à beaucoup de choses pour ne pas retomber. »
« Le voyage en train, je ne le perçois pas comme un arrachement, mais vraiment comme un fil qui est déroulé. Je trouve ça très doux. Je pars de chez moi à pied, je vais à la gare, une gare familière, et petit à petit, le fil du voyage se déroule »
Dans cette quête de soi, l'illustratrice explique placer le centre de gravité du côté des autres, loin de son propre confort. « Dans ma vie, les angoisses prennent énormément de place. C’est très envahissant. Et je n’ai pas du tout envie de transmettre mes angoisses, par respect », souffle-t-elle. Ces dernières années, la verbalisation sur la santé mentale est partout. Comme un impératif moral. Chez Lauriane Miara, il s'agit plutôt d'une éthique de la non-contagion.

C’est là que son travail prend une épaisseur particulière. Vu de loin, les aquarelles de Lauriane Miara ressemblent à ce qu’on projette sur elle : douceur, lignes simples, palettes délicates, cabanes perdues, banquises miniatures, forêts silencieuses. On pourrait y voir une énième déclinaison de la slow life mise en image. Néanmoins, quand c'est elle qui en parle, l'artiste déplace complètement le centre du tableau. « Au départ, le dessin, c’est à la fois un refuge, certainement, parce que je cherche à dessiner des choses qui représentent un apaisement auquel je n’ai pas accès, explique-t-elle. C'est donc presque un fantasme que je dessine. Quand je peins, je peux être dans cet apaisement-là. Je peux le toucher du doigt, en tout cas. »
Du vert et pas de murs
Le documentaire montre Lauriane Miara dans une cabane, en Laponie, une bougie allumée, puis sous un laavu, cet abri ouvert qui laisse passer les bruits de la nuit. Pour beaucoup d’entre nous, dormir dans tel endroit, en hiver, au milieu de la forêt, renvoie à une certaine définition de la vulnérabilité. Chez elle, c’est exactement l’inverse. « Là-bas, je dors bien, affirme-t-elle. J’ai des gros problèmes de sommeil, j’en ai eu et j’en ai toujours, mais dans ces environnements-là, non, je dors bien. Je ne sais pas trop l’expliquer. Peut-être le fait de sentir le froid, de voir les étoiles. Je trouve ça plus rassurant que d’être chez moi, dans une petite ville, dans ma petite chambre, dans mon truc fermé, fermé, fermé. Quand je dors en montagne ou en forêt, c’est plus marqué : j’ai l’impression d’être à l’abri. On ne va pas me trouver. Il ne peut rien se passer, il ne peut rien m’arriver. C’est hyper apaisant. »
« Je vois de plus en plus les câbles de remontées mécaniques, les lignes à haute tension, tous les aménagements. Ça prend de plus en plus de place, parce que c’est une vallée où il y aura un enneigement potentiellement plus longtemps qu’ailleurs. C’est cauchemardesque »
Tout est renversé : la chambre fermée devient angoissante, la nuit dehors devient protectrice. La cabane, dit-elle, est « très hermétique », elle « crée une barrière entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans ». Le laavu, lui, la remet dans la continuité du monde vivant : on entend, on sent, on n’est plus séparé. La même logique s’observe dans sa manière de voyager. Dans le film, lorsqu’elle lâche que « quatre jours de train, ça passe assez vite », la salle rit. Il y a une forme de connivence : on a intégré que le temps de transport devait être compressé, qu’il fallait « arriver vite ». Elle, elle défend exactement l’inverse. « Le voyage en train, je ne le perçois pas comme un arrachement, mais vraiment comme un fil qui est déroulé. Je trouve ça très doux. Je pars de chez moi à pied, je vais à la gare, une gare familière, et petit à petit, le fil du voyage se déroule. »
L’avion, à l’inverse, est vécu comme une violence compacte : « Tu es parachuté dans un environnement complètement inconnu, dans un temps beaucoup trop court et pas du tout naturel. Ce ne sont pas les mêmes températures, pas les mêmes sons, pas les mêmes odeurs. Tout à coup, c’est brutal ». Derrière le débat « train contre avion », on touche à quelque chose de plus profond : la possibilité de faire coïncider ce que le corps perçoit et ce que le paysage raconte. Le train laisse la tête rattraper le mouvement. L’avion, lui, enchaîne les scènes comme une story Instagram.
Au bout de la ligne, il y a la taïga, l'immense « montagne forestière » du Grand Nord . Et surtout, il y a le retour, qu’elle décrit comme un arrachement, bien plus dur que le départ. « Quand on a fait le documentaire à la fin de notre itinérance en ski pulka, je n’arrivais plus à parler. J’étais en larmes. Je n'arrivais plus à parler parce qu’on allait partir. En réalité, je voulais vraiment repartir dans la taïga. Je me sentais assez mal », confie-t-elle.
Aujourd’hui, Lauriane Miara vit à Bourg-Saint-Maurice. Le point de chute est né d’une histoire d’amour, elle y a découvert un territoire qui, pendant un temps, lui convenait. « Pas la ville en elle-même, mais les montagnes autour, reprend-t-elle. Il y a des espaces sauvages suffisamment grands pour pouvoir y vivre quelques années, en tout cas. » Mais là aussi, le sauvage recule. Et elle l'observe, tous les jours : « Je vois de plus en plus les câbles de remontées mécaniques, les lignes à haute tension, tous les aménagements. Ça prend de plus en plus de place, parce que c’est une vallée où il y aura un enneigement potentiellement plus longtemps qu’ailleurs. C’est cauchemardesque. Même si c’est sauvage, c’est comme si ce n’était plus assez sauvage pour moi. » Loin de la coquetterie, l'artiste le pose comme un constat. Celui d’une personne dont la santé psychique dépend, très concrètement, de la possibilité de se frotter à des espaces qui ne sont pas entièrement organisés par les humains.
« Les glaciers reculent dans les Alpes, c’est fini, ils vont disparaître, c’est plié, on le sait. Mais derrière un glacier, il n’y a pas rien. Il y a des nouveaux écosystèmes qui se développent. Et ces espaces-là, il faut les protéger tout de suite des infrastructures, de l’élevage, etc. »
Son premier déracinement, elle l’a vécu plus tôt, en quittant le milieu rural du nord-est où elle a grandi. L'artiste n’en fait pas un roman familial dramatique, mais elle ne le minimise pas non plus : « Pour le coup, c’est un déracinement. Ce n’est pas un déchirement, c’est juste un déracinement. Je me suis implantée ailleurs. Parce que je n’étais pas bien. Il y avait des choses dont il fallait que je m’éloigne pour pouvoir exister, tout simplement. Exister ou juste grandir, me développer. Ce qui n’aurait pas été possible à l’endroit d’où je viens. » Dans le film, elle évoque les difficultés par lesquelles elle est passée. Elle sait que cela pourrait heurter ses proches. « Mes parents ne sont pas très curieux de ce que je fais. Ils ne comprennent pas trop. Ce que j’évoque brièvement dans le film, ça reste un énorme tabou avec eux. » Il y a, là aussi, un choix de protection mutuelle : ne pas tout dire, ne pas tout montrer, accepter qu’une partie de l’histoire reste sous la surface. Le déracinement n’est pas un règlement de comptes, c’est une condition de survie.
Après les glaciers
Ce rapport au sauvage ne reste pas dans le registre du ressenti. Il structure aussi son travail actuel avec le glaciologue Jean-Baptiste Bosson et le collectif Marge Sauvage, autour des écosystèmes post-glaciaires. « Les glaciers reculent dans les Alpes, c’est fini, ils vont disparaître, c’est plié, on le sait, assène-t-elle. Mais derrière un glacier, il n’y a pas rien. Il y a de nouveaux écosystèmes qui se développent. Et ces espaces-là, il faut les protéger tout de suite des infrastructures. » Des scientifiques définissent des zones, observent quelles espèces arrivent en premier, reviennent chaque année. Lauriane Miara, quant à elle, prend cette matière brute et en fait une bande dessinée, à paraître chez Actes Sud.
« Il faut repenser notre rapport au temps, à la famille, à la manière de vivre nos amitiés, nos amours. Parce que ça, je pense que ce sont des choses qui nous sont volées par un mal qu’on ne nomme pas beaucoup. Mais je crois que ça s’appelle le capitalisme. Et il ne faut pas se laisser faire »
Elle enchaîne : « On veut parler de ce qu’on fait des milieux sauvages dans les Alpes. Quels sont-ils ? Comment les qualifier ? Qu’est-ce qu’on en fait ? Est-ce qu’il faut en faire quelque chose ? Est-ce que ça appartient aux hommes ? Est-ce qu’on se considère, nous, comme faisant partie du vivant, et à ce moment-là on peut autoriser les humains à habiter ces espaces-là ? Ou est-ce qu’on considère qu’on est une espèce à part ? » On retrouve là, mais explicitées, les questions que ses aquarelles posaient déjà silencieusement : est-ce que la montagne est un décor pour nos loisirs ou un sujet à part entière ? Est-ce qu’on se comporte comme une espèce parmi d’autres ou comme un propriétaire pressé de tout amortir avant la fonte définitive ?
Le bonheur, c'est les autres
On pourrait croire qu’avec ce rapport au temps long, aux trains qui déroulent, aux glaciers qui disparaissent, Lauriane Miara vit en marge des flux numériques. C’est plus compliqué que ça. L'artiste a un téléphone, des réseaux, comme tout le monde. Elle s’en sert pour travailler, communiquer. Mais elle a développé une forme de méfiance active. « C’est moi qui décide quand je prends le téléphone et que je vais chercher les infos. Je l’utilise, puis je coupe pendant longtemps, puis je réutilise quand il faut, puis je recoupe pendant longtemps. »
Elle raconte ces périodes où elle se surprend à y passer « beaucoup trop de temps ». Son corps, là encore, réagit physiquement : « Je ressens l’écœurement très rapidement. C’est physique, je ressens vraiment de la nausée. Et là, je sais qu’il faut que je m’en éloigne. » N'y voyez pas un discours de décroissance numérique, il s'agit d'un diagnostic politique. « Il faut repenser notre rapport au temps, à la famille, à la manière de vivre nos amitiés, nos amours, continue-t-elle. Parce que ça, je pense que ce sont des choses qui nous sont volées par un mal qu’on ne nomme pas beaucoup. Mais je crois que ça s’appelle le capitalisme. Et il ne faut pas se laisser faire. » La montagne, le dessin, la déconnexion, tout ça n’est pas chez Lauriane Miara une esthétique de niche : c’est une tentative de ne pas se laisser dissoudre.
« On ne peut pas me souhaiter grand-chose, parce que j’ai tout. Mon souhait, il est plutôt collectif. Je nous souhaite qu’une seule chose : vivre en paix »
Face à ce qu’elle appelle « l’hypnose » des écrans, elle revendique un droit très simple, qui ressemble presque à une provocation en 2025 : le droit de rêvasser. Elle le décrit très concrètement : s’imposer des moments où elle ne fait rien, écoute de la musique, laisse la tête partir « un peu comme dans un rêve ». Elle parle de l’ennui de l’enfance comme d’un espace de création « immense » et constate, avec une tristesse calme : « J’ai l’impression que c’est fini. Maintenant, les enfants ne s’ennuient plus. Et ça, c’est dramatique. »
Encore une fois, l'artiste le sait : ce monde qui ne tourne pas très rond autour d'elle ne touche pas directement sa condition. Car le bonheur, c'est les autres. « On ne peut pas me souhaiter grand-chose, parce que j’ai tout, explique-t-elle. Mon souhait, il est plutôt collectif. Je nous souhaite qu’une seule chose : vivre en paix. » Puis, alors qu'on allait tout éteindre, Lauriane Miara reformule comme pour marquer le coup. « Ma vie, si elle est comme ça jusqu’à la fin, ça me va. Maintenant, oui. »