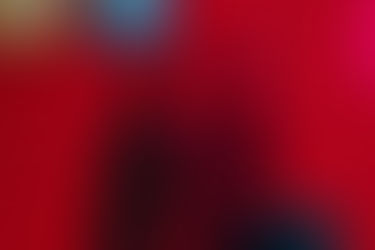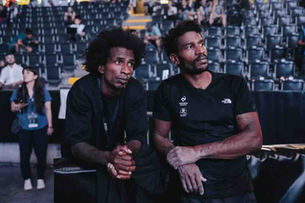Népal : 97 sommets gratuits pour détourner la foule de l’Everest
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 13 août 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 21 août 2025
Au Népal, on rêve de désengorger l’Everest sans couper le robinet à dollars. Alors, le gouvernement a sorti une carte postale XXL : 97 sommets à gravir sans payer le précieux permis, nichés dans deux provinces aussi belles que délaissées. Un geste à la fois stratégique, symbolique… et un brin désespéré. Parce qu’avant d’enfiler ses crampons sur l’Api ou le Saipal, il faudra d’abord franchir d’autres obstacles : des pistes qui ne mènent nulle part, des villages hors du temps, et la réalité brute de l’Himalaya lointain.

L’Everest, c’est devenu un peu comme le stand à churros d’une fête foraine : on fait la queue, on râle, on paye cher, et on repart avec un souvenir collant. Sauf qu’ici, le churros est à 8 849 m et qu’un ticket en haute saison vaudra bientôt 15 000 $. À force de voir s’allonger les files de doudounes multicolores sur l’arête sommitale, le Népal a décidé de jouer une autre partition. Objectif : envoyer les grimpeurs butiner ailleurs, loin de la grande roue médiatique du Khumbu. Et pour ça, la carotte est claire : supprimer les frais de permis sur 97 sommets reculés, de 5 870 m à 7 132 m, pendant deux ans.
L’idée a de quoi séduire… sur le papier glacé des brochures touristiques. Dans la réalité, elle s’attaque à un autre Everest, moins photogénique : celui des routes qui s’interrompent au milieu de nulle part, des vallées coupées du monde, des services réduits à la portion congrue. Karnali et Sudurpaschim, les deux provinces ciblées, n’ont jamais été sur la route des treks stars. Et ce n’est pas par manque de charme : c’est juste que le charme est planqué derrière plusieurs jours de marche, des liaisons aériennes erratiques et une hospitalité souvent improvisée.
Un cadeau empoisonné ou un appel d’air ?
La gratuité, c’est un mot qui a le chic pour faire briller les yeux, surtout dans un univers où le moindre permis peut coûter l’équivalent d’un bon vélo carbone. Sauf que là, il faut relativiser : ces 97 sommets rapportaient à peine 10 000 $ de redevance sur trois ans.
C’est donc surtout un geste politique, presque une invitation à redécouvrir l’Himalaya au-delà des clichés. Sur le papier, certains noms font saliver : Saipal (7 030 m), Api (7 132 m) et son versant Ouest (7 076 m), sans oublier des dizaines de pics aux silhouettes jamais imprimées sur des t-shirts. Mais la carotte a un bâton : ces sommets sont nichés dans des coins où rejoindre le camp de base peut déjà ressembler à une expédition.
L’arrière-cour oubliée de l’Himalaya
Karnali et Sudurpaschim, c’est le Népal hors catalogue. Pas de ruban d’hôtels alignés comme à Namche Bazaar, pas de boulangerie autrichienne avec wifi haut débit. Ici, on vit à l’économie d’énergie humaine : cultures en terrasse, échanges locaux, routes qui s’arrêtent net devant un pont suspendu rongé par les moussons. Et quand l’hiver tombe, c’est parfois la saison des isolements forcés, avec les cols impraticables et les rivières qui gèlent partiellement.
Pour les voyageurs, c’est une promesse d’authenticité brute : vallées taillées comme des canyons, crêtes qui se colorent de rouge au lever du jour, villages où le simple passage d’une équipe étrangère devient un événement. Mais derrière cette beauté, il y a la dureté : pauvreté structurelle, manque chronique de soins, et désormais, imprévisibilité climatique. Les glaciers reculent, les cycles agricoles se dérèglent. Pour les habitants, l’arrivée d'alpinistes ne serait pas juste une animation : ce serait une chance de diversifier des revenus qui aujourd’hui ne dépassent pas les limites de la subsistance.
La grande illusion de la préparation à l’Everest
La nouveauté, c’est ce possible prérequis gouvernemental : avant de tenter l’Everest, il faudra avoir coché un sommet népalais de plus de 7 000 m. L’argument est simple : filtrer les profils les moins expérimentés, réduire les embouteillages et les risques. Sur le papier, c’est cohérent — les 7 000, c’est de l’engagement sérieux, de l’altitude exigeante, un apprentissage grandeur nature.
Mais dans la pratique, l’équation n’est pas si simple. Les agences haut de gamme vendent l’Everest comme un produit clé en main, où la seule vraie variable est ton compte en banque. Les mêmes clients accepteront-ils de s’offrir un détour logistique par Karnali ou Sudurpaschim ? Peu probable. Sans infrastructure ni logistique fluide, ces “sommets-tests” risquent de devenir des formalités à contourner plutôt qu’un rite de passage accepté. L’histoire récente de l’Himalaya montre que la motivation pure ne résiste pas longtemps aux contraintes d’accès et de confort.
Quand la gratuité ne suffit pas
Les voix lucides au Népal ne s’y trompent pas : sans réseau d’hébergement, guides formés et itinéraires bien identifiés, la mesure ne sera qu’un geste symbolique. Les précédentes expériences le prouvent : en 2008, puis lors de l’opération “Visit Nepal 2020” (avortée par la pandémie), la gratuité de certains sommets n’avait pas entraîné de ruée. Entre 2023 et 2025, seulement 21 expéditions se sont rendues sur ces 97 sommets. Pas par manque d’intérêt, mais parce que tout le reste — transport, portage, équipement, sécurité — reste hors de prix ou trop incertain.
Rajendra Lama, du Nepal Tourism Board, l’a dit crûment : il faut de la coordination public-privé et une vraie campagne de promotion. En clair, un marketing solide pour vendre ces destinations, mais aussi un travail de fond pour que le visiteur n’ait pas l’impression de partir en mission humanitaire dès qu’il veut boire un thé chaud.
Derrière les chiffres, la vraie bataille
En 2024, les permis d’ascension ont rapporté 5,92 millions de dollars au Népal, dont plus de 4,5 millions pour l’Everest. Cette dépendance économique au “toit du monde” est à double tranchant : tant que la demande est forte, la manne continue. Mais la saturation, les images de queues au sommet et la montée des critiques environnementales menacent à terme l’image — et donc le business. La Cour suprême, en 2024, a déjà demandé à plafonner le nombre de permis en fonction de la capacité de charge des montagnes.
Ces 97 sommets gratuits, ce n’est pas juste une mesure d’aménagement touristique : c’est une tentative de réécriture du récit himalayen. Dire au monde que le Népal, ce n’est pas seulement l’Everest et le Khumbu, mais aussi des massifs entiers où l’aventure est encore intacte. La question, c’est de savoir si cette promesse restera dans les communiqués, ou si elle prendra chair dans les crampons et les sacs à dos de ceux qui oseront sortir du cadre.