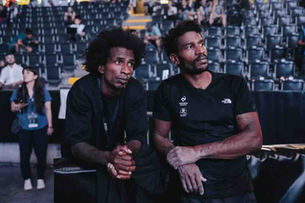Des grimpeurs montent au créneau pour sauver les chauves-souris
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 17 juil. 2025
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 juil. 2025
Pendant que le monde regarde ailleurs, un discret champignon colonise les museaux des chauves-souris nord-américaines, condamnant ces petits mammifères à une mort lente et implacable. Alors que ce « syndrome du nez blanc » vient d'atteindre les mythiques parois du parc national des Rocky Mountains, des grimpeurs prennent de la hauteur et tendent la main aux scientifiques pour tenter d’enrayer le massacre. Récit d’une improbable alliance verticale.

Ils passent leurs journées à tutoyer les sommets, accrochés à des fissures inaccessibles aux simples mortels. Et voilà que ces passionné.e·s du vide découvrent, au détour d’un surplomb, d’étranges colocataires : des chauves-souris menacées par un mal silencieux, le syndrome du nez blanc. Ce parasite mortel, arrivé récemment dans le Colorado, est devenu le cauchemar des biologistes. Alors, devant l’urgence, les grimpeurs du programme Climbers for Bat Conservation se muent en précieux lanceurs d’alerte, transformant leurs escalades en opérations scientifiques pour tenter de sauver ces mammifères essentiels à l’équilibre des écosystèmes.
« Chauve qui peut » dans les Rocheuses
Le syndrome du nez blanc doit son nom à la moisissure blanchâtre qui pousse sur le museau et les ailes des chauves-souris infectées. Causé par le champignon Pseudogymnoascus destructans (surnommé Pd), il prolifère dans les endroits froids et humides prisés par les chauves-souris pour hiberner – notamment les grottes profondes, les fissures et autres refuges rocheux souterrains. Le parasite agit comme un véritable vampire énergétique : il réveille ses victimes en plein hiver, les déshydrate et les pousse à chercher désespérément de la nourriture hors saison. Faute d’insectes à se mettre sous la dent en hiver, ces petites créatures finissent par mourir de faim. Depuis son émergence en 2006 dans l’État de New York, cette maladie fongique a déjà été tenue responsable de la mort de plus de six millions de chauves-souris en Amérique du Nord – un chiffre vertigineux qui menace de déséquilibrer les écosystèmes.
Rocky Mountain National Park (RMNP) abrite neuf espèces de chauves-souris connues, sur les 19 recensées dans tout le Colorado. Toutes jouent un rôle important dans leur milieu : puisqu'elles se nourrissent d’insectes comme les moustiques, contribuant à en réguler les populations. Certaines interviennent même dans la pollinisation de plantes locales, preuve que ces mammifères volants ne sont pas de simples créatures nocturnes effrayantes, mais bien des acteurs écologiques clés. Bien qu’il hésite à employer le terme d’« espèce clé de voûte », le biologiste Robert Schorr admet que l’importance des chauves-souris dans l’écosystème n’en est « pas loin ». Autant dire que l’apparition du syndrome du nez blanc dans le parc fait craindre des dégâts considérables sur la biodiversité locale. La confirmation officielle, le 26 juin 2025, de la présence du champignon sur trois chauves-souris retrouvées mortes dans le parc a sonné l’alarme

Cette découverte n’a pas vraiment surpris les spécialistes, car le champignon Pd responsable de la maladie avait été détecté dans le parc l’année précédente. En effet, dès 2024, des analyses de routine avaient révélé des traces du parasite sur des chauves-souris du secteur – signe précurseur de l’infection à venir. À l’échelle de l’État, le Colorado a enregistré son premier cas avéré de syndrome du nez blanc en 2022, dans le sud-est du territoire. Le mal gagne donc du terrain vers l’Ouest : après avoir touché le comté de Larimer (au nord du Colorado), il a désormais atteint le comté de Grand, de l’autre côté de la chaîne continentale.
« Nos informations sur la dispersion du champignon arrivent lentement et au compte-gouttes, car il sévit souvent dans des zones où il est difficile d’accéder aux chauves-souris » explique Schorr, frustré par l’élusivité de ces créatures. Autrement dit, le champignon pourrait être présent dans bien d’autres recoins des Rocheuses sans qu’on le sache, faute de pouvoir y capturer et tester des chauves-souris.
Notons que cette maladie, aussi dramatique soit-elle pour la gent chauve-souris, ne présente aucun danger pour l’homme. Toutefois, l’Homme peut devenir un vecteur involontaire en transportant des spores de Pd sur ses vêtements, ses chaussures ou son matériel. C’est d’ailleurs pour cette raison que certaines grottes touristiques ont été préventivement fermées par le passé, afin d’éviter que des visiteurs bien intentionnés ne dispersent le champignon d’un site à un autre. Le parc national des Montagnes Rocheuses, lui, ne compte heureusement aucune grotte majeure en son sein – ses chauves-souris hibernent plutôt dans de petites cavités isolées ou migrent vers le sud. Ce facteur pourrait limiter les dégâts. Néanmoins, seul l’avenir dira comment évolueront les populations de chiroptères dans la région, et les chercheurs demeurent en alerte.
Des grimpeurs à la rescousse de la science
Comment étudier une maladie qui frappe des animaux discrets, nocturnes, nichés haut dans des falaises inaccessibles ? C’est le défi qu’a décidé de relever Robert Schorr, zoologiste au Colorado Natural Heritage Program (Université d’État du Colorado). Sa botte secrète : mobiliser une armée de volontaires aguerris aux parois vertigineuses. En 2014, Schorr a cofondé Climbers for Bat Conservation (CBC), un programme de science participative qui fait appel aux grimpeurs du monde entier pour signaler la présence de chauves-souris sur les sites d’escalade. L’idée lui est venue en constatant que les grimpeurs sont souvent les seuls humains à partager le terrain de jeu des chauves-souris. « Les grimpeurs sont à peu près le seul groupe de loisirs à voir des chauves-souris là où elles se perchent naturellement, confie Schorr. Ils les trouvent dans les fissures qu’elles choisissent, à des hauteurs vertigineuses. Moi qui étudie les chauves-souris, je n’ai quasiment jamais l’occasion de les observer ainsi ! »
En effet, muni de cordes et d’un casque, un passionné d’escalade peut atteindre des crevasses insoupçonnées sur une falaise et y découvrir une colonie endormie – un spectacle qu’aucun biologiste cloué au sol ne pourrait admirer. Depuis son lancement, l’initiative Climbers for Bat Conservation a dépassé toutes les attentes.

Au fil des années, son réseau de sentinelles bénévoles s’est étendu bien au-delà des Rocheuses. Désormais, les remontées de terrain affluent des quatre coins du globe : près de 400 signalements ont déjà été transmis, provenant non seulement du Colorado mais aussi d’endroits aussi divers que le Kenya, la Bulgarie ou l’Italie. Ces contributions fournissent aux scientifiques une mine d’informations inédites sur l’écologie des chauves-souris. Grâce aux yeux perçants des grimpeurs, les biologistes commencent à comprendre comment ces mammifères utilisent les systèmes de fissures dans les falaises, quelles parois elles privilégient, à quelles altitudes… Autant de données précieuses qui aident à anticiper l’impact du syndrome du nez blanc sur les différentes colonies, et peut-être à atténuer sa progression.
Participer à cette aventure scientifique ne requiert ni diplôme en biologie ni inscription officielle. Tout grimpeur curieux peut apporter sa pierre à l’édifice de la conservation. La procédure est simple : si, au détour d’une voie, vous tombez sur des chauves-souris endormies dans une fissure, il suffit de se rendre sur le site web de Climbers for Bat Conservation et de cliquer sur « Submit a Sighting » (Signaler une observation)
Un petit formulaire vous invite à décrire le lieu, la taille de la colonie, éventuellement l’orientation de la paroi, et à joindre une photo souvenir de vos colocataires à fourrure. Ces informations seront transmises à l'équipe de chercheurs. Et pour vous remercier d’avoir joué les éclaireurs des cimes, le programme vous enverra même un t-shirt gratuit estampillé chauve-souris – la classe, non ?
Pas de fermeture des sites, mais vigilance de rigueur
L’apparition du syndrome du nez blanc fait craindre le pire pour les chauves-souris, mais pas question de crier « chauve qui peut » et d’interdire aux grimpeurs d’aller tutoyer les falaises. Contrairement à d’autres maladies invasives, ce champignon n’entraîne généralement pas de fermeture massive des grottes ou des sites d’escalade. Robert Schorr cite bien quelques exemples isolés de cavernes temporairement bouclées par précaution – Mallory Cave, près de Boulder, a ainsi été grillagée plusieurs années afin de protéger les chauves-souris qui y vivent. Cependant, ces mesures restent rares et exceptionnelles, le National Park Service n'a d'ailleurs annoncé aucune fermeture de secteur d’escalade suite à la confirmation de la maladie.
Les gestionnaires du parc comptent sur la responsabilité de chacun pour limiter les risques de contagion. Ils demandent aux visiteurs de s’abstenir de toucher les chauves-souris – qu’elles soient vivantes ou mortes – et de signaler immédiatement aux rangers la présence de toute chauve-souris trouvée morte au sol. Il est également impératif de désinfecter soigneusement son équipement (vêtements, chaussures, cordes, etc.) avant de repartir vers d’autres sites, afin de ne pas transporter le champignon.
Seul le temps dira si ces mammifères volants réussiront à survivre à l’assaut du champignon destructeur. En attendant, si vous partez grimper du côté de Rocky Mountain et que vous croisez, blotties dans une fissure, une petite famille de chauves-souris, surtout ne dérangez pas ces dames de la nuit – signalez plutôt votre observation à Climbers for Bat Conservation. Ce simple geste de science citoyenne sera d’une aide précieuse pour les biologistes, et il contribuera peut-être à sauver ces espèces en péril.
.