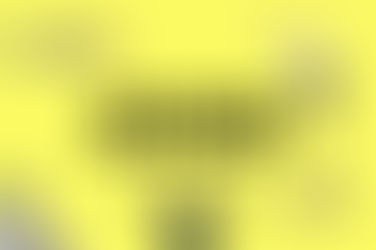Grimper sans piétiner : à Guadalajara, l’escalade cherche son point d’équilibre
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 25 mars 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 avr. 2025
Il fut un temps pas si lointain où l’escalade restait une affaire discrète, presque confidentielle. Une pratique un peu marginale, habitée par celles et ceux qui passaient plus de temps à chercher une ligne juste qu’à chercher la lumière. On dormait dans des vans cabossés, on traînait dans les campings, on partageait des topos griffonnés à la main comme des trésors. La falaise était un terrain d’aventure, mais aussi un espace de silence, de lenteur, de patience.

Puis le monde s’est refermé, le temps d’un confinement mondial. Et à sa réouverture, l’appel du dehors s’est fait plus fort, plus bruyant, plus immédiat. Les sports de pleine nature, et parmi eux l’escalade, ont gagné en visibilité ce qu’ils ont perdu en secret. Les salles ont servi de sas d’entrée, les marques ont répondu à la demande, et très vite, ce qui relevait d’une culture s’est transformé en tendance. La grimpe est devenue une activité à la mode, accessible, séduisante, partagée sur les réseaux et pratiquée en masse, souvent sans bagage technique, parfois sans repères.
Et c’est là que le bât blesse. Car la falaise, elle, n’a pas changé. Elle est restée ce qu’elle a toujours été : un milieu vivant, fragile, complexe, qui supporte mal l’accumulation sans régulation. À Guadalajara (en Espagne), dans certaines zones comme Patones ou Tamajón, cette tension est aujourd’hui visible à l’œil nu. Les sentiers s’élargissent. Le sol s’érode. Les oiseaux désertent. Les blocs résonnent d’échos nouveaux, plus mécaniques, moins attentifs.
De la grimpe sans conscience au besoin de structure
Ce n’est pas un procès contre les nouveaux venus. Ce n’est pas une ode aux anciens grimpeurs comme seuls gardiens légitimes du rocher. Ce qui est en jeu ici, c’est la manière dont une pratique change d’échelle sans changer de regard. On passe du pan au rocher avec la même légèreté que l’on change de playlist. On reproduit, parfois sans le savoir, les logiques de la salle sur des environnements qui n’y sont pas préparés : consommation rapide, faible ancrage local, pratiques bruyantes, techniques approximatives.
La question n’est pas tant de savoir si c’est bien ou mal, mais de reconnaître que cela a un coût. Et qu’à force de ne pas l’assumer, ce coût finit par retomber sur le vivant. Sur des espèces qui ne font pas de bruit, qui n’ont pas de comptes Instagram, et qui ont besoin de temps, d’espace, de calme.
Face à cela, à Guadalajara, un collectif s’est structuré. Il s’appelle Amegu, acronyme sec pour une ambition patiente : construire un pont entre les grimpeurs et les gestionnaires d’espaces naturels. Réunissant des clubs de montagne, des associations environnementales, des biologistes, des ingénieurs forestiers, des ouvreurs, des pratiquants, Amegu n’est pas une réaction de principe, c’est une réponse de terrain.

De la donnée, pas des dogmes
Leur approche n’est ni punitive, ni nostalgique. Elle part d’un constat simple : si l’on veut que l’escalade survive à son propre succès, il faut apprendre à la réguler autrement. Pas en fermant tout, pas en interdisant de manière aveugle, mais en comprenant précisément ce qui se joue sur chaque site.
Pour cela, Amegu a noué des partenariats avec deux universités – Rey Juan Carlos I et Grenade – et s’est lancé dans un travail inédit de recensement, d’observation et de cartographie. Où nichent les oiseaux rupestres ? Quels sont leurs cycles de reproduction ? Quelles sont les zones les plus fragiles ? Quelle pression une falaise peut-elle supporter ? Autant de questions qui, jusque-là, étaient laissées de côté au profit de l’intuition ou de la polémique.
En produisant ces données, Amegu rend possible une discussion sérieuse avec les collectivités, les mairies, les gestionnaires d’espaces naturels. Il ne s’agit plus de négocier dans le vide, mais de proposer des modalités concrètes d’accès, adaptées aux périodes, aux espèces présentes, aux usages locaux.
La falaise comme écosystème, pas comme décor
Cette approche fine, souple, informée, permet d’imaginer ce qu’Amegu appelle une “régulation dynamique” : une gestion des sites qui tienne compte des rythmes biologiques, des saisons, des années, et qui propose des alternatives à la fermeture brutale. On ne grimpe pas toute l’année partout. On évite certaines parois au printemps si des rapaces y nichent. On évalue l’impact réel de certaines techniques, comme le brossage intensif. Et surtout, on accepte que grimper, ce n’est pas neutre.
Ce changement de regard est profond. Il suppose de sortir de la logique du droit d’accès pour entrer dans celle du dialogue avec le milieu. On ne parle plus seulement d’ouverture de voie, mais d’ouverture au vivant. On ne se contente plus de repérer les prises, on apprend à reconnaître les espèces. Ce n’est pas un renoncement, c’est une extension du champ de la pratique.

Transmettre ce que l’on touche
Pour qu’un tel changement prenne racine, Amegu mise aussi sur la transmission. Chaque sortie est pensée comme une opportunité pédagogique : on grimpe, mais on observe, on échange, on découvre. Des guides naturalistes accompagnent les groupes. On parle géologie, flore, faune, histoire locale. On discute des voies ouvertes, des zones à protéger, des erreurs à éviter.
Et après la grimpe, il y a le village. Le bar. Le repas partagé. Parce que l’escalade, dans les zones rurales de Guadalajara, peut aussi être un levier économique. Mais pour cela, encore faut-il que les grimpeurs ne se contentent pas de consommer la falaise comme un spot à part, déconnecté du territoire. Il faut qu’ils y laissent autre chose que de la gomme et des stories.
Vers une écologie de la grimpe
Ce que tente Amegu n’est pas spectaculaire. Il n’y a pas de grand soir. Juste un effort continu pour rendre la grimpe plus habitable – pour ceux qui la pratiquent, pour ceux qui y vivent, et pour ceux qui ne font que passer, ailes ouvertes ou racines profondes.
Ce n’est pas une écologie punitive. C’est une écologie relationnelle. Qui ne cherche pas à exclure, mais à inclure autrement. Qui ne sacralise pas la falaise, mais la reconnaît comme un milieu habité. Qui assume que l’escalade a une empreinte, mais qu’on peut en réduire l’impact, à condition d’en parler, de l’étudier, de la penser.
À Guadalajara, ils essaient. Avec méthode, avec conviction, sans certitudes rigides. Ils posent les bases d’une manière de grimper qui ne s’arrête pas à l’effort physique, mais qui intègre le lieu, l’histoire, le vivant. Ils proposent une autre forme d’engagement, moins spectaculaire mais plus durable.
Et peut-être est-ce là le plus bel horizon de la grimpe : continuer à chercher l’équilibre, même quand on croit avoir atteint le sommet.