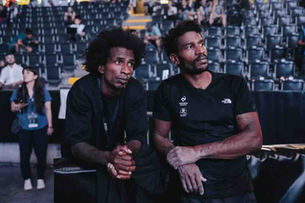Taranaki Maunga : La montagne qui a son mot à dire
- Adrien Bataille

- 19 févr. 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 févr. 2025
La Nouvelle-Zélande n’est pas du genre à faire les choses à moitié. Après avoir passé un passeport juridique à une forêt et à un fleuve, elle a décidé que Taranaki Maunga, son volcan fétiche, méritait lui aussi d’avoir son mot à dire. Le 30 janvier 2025, le voilà officiellement doté d’une existence juridique.
Un volcan qui, juridiquement, entre dans le cercle très fermé des entités légales. Une lubie d’avocat en manque de clients ? Pas du tout. Plutôt une claque symbolique, une manière de remettre les pendules à l’heure pour les peuples maoris, qui n’ont jamais vu cette montagne comme un simple tas de cailloux.

Un sommet qui regarde de haut
2 518 mètres d’altitude, un cône parfait, une silhouette qui en impose. Taranaki Maunga, ce n’est pas juste un paysage de carte postale, c’est un ancêtre, un guide, un repère. Du moins, c’est comme ça que le voient les huit iwi maoris du coin. Mais pendant plus d’un siècle, ils ont été coupés de leur montagne, expropriés en règle par la colonisation britannique.
Résultat : une bataille acharnée pour récupérer ce qui leur a été volé. Et après des décennies de discussions, de coups de pression et d’atermoiements, la justice a tranché : Taranaki Maunga n’est pas un décor, c’est une entité vivante.
De la roche aux textes de loi
Avec cette nouvelle loi, Taranaki Maunga devient "Te Kahui Tupua", "un tout vivant et indivisible". Ça sonne mystique, mais juridiquement, ça veut dire quelque chose : la montagne a les mêmes droits qu’une personne et sera représentée par un comité partagé entre Maoris et gouvernement.
En clair, fini le business as usual : chaque décision qui la concerne devra passer par ce conseil. Une manière d’assurer que la protection du site ne sera pas qu’un vague concept fourré au fond d’un tiroir administratif.
Debbie Ngarewa-Packer, figure du parti Te Pati Maori, a posé les mots justes :
« Aujourd'hui, Taranaki est libéré des chaînes... de l'injustice, de l'ignorance et de la haine. »
Une déclaration qui replace l’histoire dans son contexte.
La nature sort les griffes
Ce coup de maître n’est pas un one-shot. La Nouvelle-Zélande a déjà fait le coup en 2014 avec la forêt de Te Urewera et en 2017 avec le fleuve Whanganui. Résultat : un modèle qui fait des petits. En Inde, les fleuves Gange et Yamuna ont eux aussi décroché leur carte d’identité légale. En Colombie, c’est le fleuve Atrato qui a été sacralisé par la justice.
Ce n’est pas qu’un tour de passe-passe juridique, mais un vrai changement de paradigme. Ici, la montagne cesse d’être un simple relief sur une carte : elle devient un sujet de droit, avec tout ce que cela implique.
À quand le Mont-Blanc citoyen ?
En France, le débat sur la reconnaissance des droits de la nature progresse. Certaines initiatives comme le Parlement de la Loire explorent l’idée d’une personnalité juridique pour les cours d’eau, et des projets transfrontaliers existent pour une gouvernance commune du massif alpin.
L’exemple de Taranaki Maunga pourrait bien faire des vagues. En France, certaines voix réclament déjà que le Mont-Blanc et d’autres sites majeurs suivent le même chemin. Mais on en est encore loin. Pour l’instant, on préfère bétonner des stations et appeler ça du "développement durable".
Ce qui est sûr, c’est que la reconnaissance de Taranaki Maunga vient ajouter une pierre de plus à l’édifice d’une nouvelle vision du monde : une où la nature n’est plus un décor passif, mais un acteur à part entière.