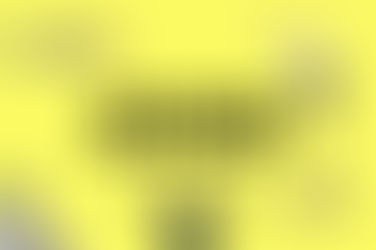Mont Fuji 2025 : ascension sous haute surveillance
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 3 juil. 2025
- 9 min de lecture
Dernière mise à jour : 9 juil. 2025
Pour gravir le célèbre volcan japonais cet été, il faudra désormais montrer patte blanche – et porte-monnaie. L’ouverture de la saison d’ascension 2025 s’accompagne de mesures inédites : droit d’accès, réservation obligatoire, couvre-feu nocturne et quota strict de randonneurs sur le sentier principal. Un tournant destiné à juguler le surtourisme qui menace ce site sacré, au prix d’une petite révolution dans les habitudes.

Chaque été, c'est la même ruée : des foules impatientes convergent vers le mont Fuji pour décrocher leur part de sacré, leur tranche d'éternité au lever du soleil depuis le toit du Japon. Mais depuis le 1er juillet 2025, la montagne aux estampes mythiques se découvre soudain un air inédit de citadelle sous haute surveillance. Tourniquets mécaniques, guichets monnayant le rêve, et rangers scrutant d’un œil sévère les chaussures des prétendants : « Fuji-san » ne cache plus ses ambitions de sélection naturelle. Fini l'ère des promeneurs du dimanche débarquant en sandales, appareil photo en bandoulière et insouciance en poche. Place à une ascension cadrée, codifiée, presque aseptisée : un pèlerinage 2.0 où la quête spirituelle croise l'exigence bureaucratique. C’est comme si le volcan légendaire, saturé par ses propres admirateurs, avait décidé de filtrer ceux dignes de fouler sa cendre, histoire de rappeler que même au pays des estampes et du kawaii, l’élégance reste une affaire de discipline.
Chronique d’une indigestion volcanique
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2013, le mont Fuji s’est retrouvé pris malgré lui dans un engrenage touristique, jusqu’à frôler l’asphyxie. La cinquième station Subaru, sorte de parking d’autoroute sacralisé servant de tremplin à l’ascension, accueillait déjà plus de 5 millions de visiteurs annuels en 2019, doublant sa fréquentation en seulement sept ans. Rien qu’en juillet 2023, près de 65 000 randonneurs ont touché le sommet, un pic inédit gonflé de 17 % par rapport à l’avant-pandémie. Mais sous cette avalanche de marcheurs compulsifs, la carte postale idyllique s’est vite effritée : embouteillages sur les sentiers, toilettes à la propreté douteuse, détritus semés comme autant d’offrandes indésirables sur les pentes sacrées. Même les réseaux sociaux, habituellement prompts à magnifier l’expérience, se sont émus devant l’état lamentable de certains points de passage.
C’est surtout la pratique du « bullet climbing » qui a mis le feu aux poudres. Cette ascension express, souvent improvisée en pleine nuit sans halte en refuge ni véritable temps de repos, est devenue populaire auprès des touristes pressés de capturer le lever du soleil au sommet. Ce « bullet climbing » nocturne pose problème, moins par sa durée – environ 6 heures – que par l’impréparation fréquente des marcheurs occasionnels, qui sous-estiment les risques liés aux températures nocturnes et au mal aigu des montagnes. Ce qui entraîné une multiplication alarmante des interventions de secours : 61 opérations en 2023 rien que du côté de Shizuoka, en hausse de 50 % sur un an, la plupart pour hypothermie ou mal aigu des montagnes. Fin 2023, dépassé par l’afflux de touristes imprudents en short et tongs, un responsable local qualifiait sans détour la situation de « hors de contrôle », craignant ouvertement que les véritables montagnards désertent un sommet transformé en Disneyland vertical.
« Pas de polaire ? Pas de Fuji ! »
Même l’UNESCO avait mis la pression dès l’inscription du site, exigeant du Japon des actions concrètes contre ce surtourisme menaçant directement la préservation du volcan. Faute d’amélioration, le prestigieux label était susceptible de voler en éclats. Le message, longtemps ignoré, a finalement percuté les autorités japonaises après un été 2023 chaotique. Inspirées, ou plutôt effrayées, par le sort d’autres lieux mythiques submergés par les foules — du Machu Picchu péruvien aux plages thaïlandaises — elles ont finalement décidé de prendre des mesures radicales. À l’aube de la saison 2025, Fuji-san a donc décidé d’ouvrir les portes du sanctuaire au compte-gouttes, quitte à vexer au passage quelques adorateurs de son cône parfait.
Fuji passe en mode VIP : quotas, réservations et couvre-feu au sommet
Face à l’afflux chronique de pèlerins improvisés, les préfectures de Yamanashi et Shizuoka ont décidé de remettre un peu d’ordre sur le Fuji, avec une série de mesures à la fois strictes et ingénieuses. Première innovation : l’ascension devient officiellement payante. Terminé le temps des dons symboliques de 1 000 yens glissés nonchalamment dans une boîte rouillée. Désormais, c’est un droit d’entrée obligatoire de 4 000 yens (environ 25 €) qui attend chaque aspirant randonneur. Certes, on est loin du coût d’une expédition sur l’Everest, mais l’idée est symbolique.
Deuxième mesure de taille : le plafonnement quotidien à 4 000 ascensions sur le sentier Yoshida, itinéraire vedette du versant nord. Pour entrer dans ce cercle restreint, une seule voie possible : réserver préalablement son créneau en ligne, en s’engageant par la même occasion à respecter un « contrat du randonneur », sorte de charte du parfait montagnard, incluant l’obligation de porter vêtements chauds, chaussures adéquates et bonne conduite. Les heureux élus reçoivent un QR code à présenter au point de contrôle ; quant aux retardataires, une maigre consolation : chaque jour, 1 000 places sont réservées aux moins prévoyants. Autant dire que ceux-là devront se lever tôt pour espérer décrocher leur place au soleil levant – sous peine de rester bredouille en bas du volcan, avec un souvenir amer et zéro selfie à la clé.
Troisième nouveauté, véritable couvre-feu sur les pentes du Fuji. Pour décourager la pratique du « bullet climbing », les autorités ferment désormais l’accès au sentier dès 14h, jusqu’à 3h du matin, à tous ceux qui ne disposent pas d’une réservation en refuge d’altitude. Fini donc l’escapade improvisée en pleine nuit pour attraper la première lueur sur le cratère : la barrière du Fuji ne laisse désormais passer que les randonneurs prévoyants, dûment équipés et munis d’un lit réservé. Certes, les amateurs d’aventure spontanée en maugréeront, mais entre sauver quelques orteils gelés et sacrifier une poignée de romantismes mal placés, le choix des autorités est vite vu.
Avec moins de passages, l’érosion des sols volcaniques fragiles devrait diminuer mécaniquement, tout comme la quantité de déchets à gérer sur les pentes sacrées.
Enfin, histoire de muscler davantage le dispositif, des « Mt. Fuji rangers », gardiens officiels du volcan, veillent désormais scrupuleusement à l’entrée du sentier. Mission : vérifier les réservations, mais surtout l’équipement des candidats à l’ascension. Exit les tongs, les shorts fluos et autres débardeurs estivaux. Dorénavant, c’est veste chaude, chaussures adaptées et tenue sérieuse exigées. Le slogan pourrait presque être : « Pas de polaire ? Pas de Fuji ! ». En bons physionomistes du trek alpin, ces rangers pourront donc refouler sans sourciller les touristes trop légers pour affronter les rigueurs d’une montagne qu’on oublie trop vite être une montagne. Ces vigiles bienveillants, façon videurs des hauteurs, assurent également un rôle de pédagogues, rappelant aux visiteurs quelques règles élémentaires : interdiction formelle de camper hors des refuges, défense absolue d’allumer des feux sauvages et, évidemment, de semer ses déchets en chemin.
À noter tout de même que ces règles strictes s’appliquent pour l’instant principalement au versant Yamanashi et à son sentier Yoshida. Du côté de Shizuoka, les trois autres voies (Subashiri, Gotemba et Fujinomiya) adoptent certes elles aussi le nouveau péage à partir du 10 juillet, mais restent pour le moment sans limitation journalière. Une générosité passagère, qui pourrait vite évoluer si les foules déboutées au nord venaient soudain à migrer massivement au sud. Quoi qu’il en soit, l’argent collecté via ce péage sera réinvesti dans l’amélioration des infrastructures d’accueil – entretien des sentiers, sanitaires, services d’assistance multilingues, voire dispositifs de secours renforcés – manière habile d’instituer un éco-péage en application directe du sacro-saint principe : « pollueur-payeur ». Le Fuji-san n’a peut-être pas dit son dernier mot, mais pour 2025, il a clairement décidé d’imposer ses propres règles du jeu.
Entre régulation du tourisme et reconquête écologique
Avec ces nouvelles mesures restrictives, la question n’est pas tant de savoir si le Fuji verra moins de monde cette année – c’est une évidence – mais de mesurer quelles en seront les conséquences concrètes. L’impact touristique immédiat paraît clair : un nombre de visiteurs réduit, c’est potentiellement moins de recettes pour les refuges et les commerces de la station, habitués jusqu'ici à profiter d’un flux quasi-ininterrompu de randonneurs. Mais ce calcul rapide pourrait cacher une dynamique plus subtile. Moins de visiteurs, certes, mais probablement mieux préparés, plus engagés, prêts à débourser davantage pour une expérience moins chaotique. Le pari des autorités est en somme celui d’un tourisme plus qualitatif, moins focalisé sur le volume que sur la valeur, où le plaisir de gravir le volcan mythique redeviendrait un luxe abordable mais non systématique.
Côté environnement, le bilan s’annonce nettement positif. Avec moins de passages, l’érosion des sols volcaniques fragiles devrait diminuer mécaniquement, tout comme la quantité de déchets à gérer sur les pentes sacrées. L’argent récolté grâce au péage obligatoire offrira des ressources financières précieuses pour restaurer les infrastructures de manière durable, à commencer par la gestion des déchets, l’entretien des sentiers et des sanitaires enfin dignes d'un site classé par l’UNESCO. Sur le papier, ce mécanisme de « pollueur-payeur » semble taillé pour réconcilier fréquentation touristique et préservation environnementale.
Si le mont Fuji fait aujourd’hui figure de pionnier involontaire dans la lutte contre le surtourisme, il est loin d’être le premier – et certainement pas le dernier – à tirer le signal d’alarme.
Mais la réussite de ce modèle repose sur une inconnue majeure : sa mise en œuvre sur le terrain. Le dispositif de contrôle pourra-t-il tenir ses promesses face aux réalités pratiques et humaines ? Rangers et barrières suffiront-ils à maintenir efficacement le filtre ? Et surtout, comment gérer l’inévitable report de fréquentation vers d’autres itinéraires – en particulier ceux du versant sud (Shizuoka) qui, pour l’instant, restent sans quotas ? Si l’on voit apparaître une ruée sur ces sentiers alternatifs, les autorités locales devront rapidement réagir pour éviter que le problème ne se déplace simplement de quelques kilomètres.
Le Fuji 2025 s’affiche donc comme une expérimentation grandeur nature, un laboratoire d’où pourrait émerger un nouveau modèle touristique, plus responsable, adapté aux réalités écologiques de notre époque. Son succès ou son échec apportera des enseignements précieux, bien au-delà des frontières japonaises, pour tous ceux qui tentent de résoudre l’équation complexe : comment préserver nos joyaux naturels sans les priver totalement de visiteurs ? En attendant, Fuji-san fait office de pionnier – malgré lui – dans une transition touristique dont le monde entier scrute désormais les résultats.
Fuji-san et compagnie : l’époque des grands espaces en accès limité ?
Si le mont Fuji fait aujourd’hui figure de pionnier involontaire dans la lutte contre le surtourisme, il est loin d’être le premier – et certainement pas le dernier – à tirer le signal d’alarme. Partout dans le monde, les sites naturels ou culturels emblématiques confrontés à une avalanche de visiteurs cherchent la parade idéale : quotas, billets réservés, tarifs gonflés, tout est bon pour endiguer le flot des foules.
Prenez le Machu Picchu au Pérou, cette cité inca que des hordes de voyageurs impatients menaçaient littéralement de réduire en poussière. Pour sauver les pierres sacrées de l’érosion touristique, les autorités péruviennes ont imposé depuis quelques années une jauge très stricte, limitée à 5 600 visiteurs par jour en haute saison, répartis sur des créneaux horaires précis et obligatoirement accompagnés de guides agréés. Obtenir un billet relève désormais du parcours du combattant – mais à ce prix seulement la « cité perdue » pourra retrouver un semblant de sérénité. Le Pérou a compris, peut-être avant tout le monde, que pour éviter l’asphyxie d’un site exceptionnel, le ticket d’entrée se devait d'être exigeant, et pas seulement symbolique.
En Italie, les Dolomites, patrimoine mondial de l’UNESCO prisé des instagrammeurs amateurs de turquoise parfait et de ciels limpides, sont entrées elles aussi en résistance. Face à des pics de fréquentation qui transformaient chaque été certaines vallées en embouteillage permanent, les autorités du Tyrol du Sud ont réagi dès 2023 en plafonnant carrément les nuitées au niveau de 2019 et en instaurant un gel total des nouvelles constructions touristiques. Certains sites-phare, comme l’incontournable lac de Braies, imposent désormais une réservation préalable obligatoire. Autant dire qu’on ne débarque plus dans les Alpes italiennes sur un coup de tête : là-bas aussi, la beauté naturelle se mérite désormais.
Mais le cas le plus emblématique reste peut-être l’Everest, transformé ces dernières années en autoroute d’altitude où les prétendants à l’exploit s’entassent parfois tragiquement dans la fameuse « zone de la mort ». Après une photo virale en 2019 montrant une interminable file d’attente au sommet, le Népal tente timidement de reprendre la main. Depuis 2025, le permis d’ascension est passé de 11 000 à 15 000 $, et chaque candidat doit désormais prouver qu’il a déjà gravi un sommet de 7 000 mètres minimum. Malgré ces garde-fous, la saison 2025 affichait encore plus de 500 permis distribués, soit potentiellement 1 000 personnes sur une même pente en quelques semaines. La route vers une véritable régulation reste longue pour le toit du monde, tiraillé entre l'impératif de sécurité et la manne économique que représente le tourisme d’altitude.
Ces exemples, du Machu Picchu aux Dolomites en passant par l’Himalaya, traduisent une tendance universelle : l’époque bénie où les sites naturels d’exception étaient librement accessibles à tous touche progressivement à sa fin. La régulation s’impose partout comme la seule voie raisonnable pour protéger un patrimoine mondial fragilisé par l’explosion du tourisme globalisé. Des temples indonésiens de Borobudur, où les prix ont quadruplé, à Venise, où l’on a déjà instauré un péage urbain, en passant par la plage thaïlandaise de Maya Bay, fermée plusieurs années pour cause de surfréquentation, la planète entière cherche à conjuguer fréquentation et préservation.
Ainsi, le mont Fuji n’est finalement qu’un laboratoire parmi d’autres – mais sa réussite ou son échec auront valeur d’exemple. Si le Japon parvient à préserver son volcan sacré sans vider totalement ses pentes, la démonstration sera faite que tourisme contrôlé peut rimer avec plaisir retrouvé. Dans le cas contraire, si les effets pervers l’emportent, il faudra repenser la stratégie. En attendant, Fuji-san aura eu le mérite de rappeler une évidence : même à l’époque du selfie et du tourisme de masse, les sommets ne se conquièrent pas sans respect ni discipline. Comme le disait déjà le proverbe, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». À gravir sans conscience, on abîme ce qu’on prétend aimer. Voilà sans doute le message le plus profond, caché derrière la nouvelle réglementation du plus célèbre volcan nippon.