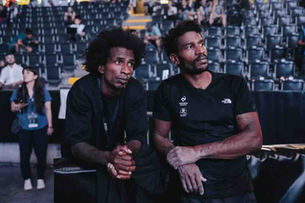À Erbil, les femmes prennent de la hauteur – et avec elles, tout le Kurdistan
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 4 juin 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 juin 2025
Entre l’élan des falaises du mont Safeen et le poids persistant des traditions, Erbil, capitale du Kurdistan irakien, voit émerger une génération de grimpeuses qui redéfinissent subtilement le paysage sportif local. Un récit encore confidentiel, mais dont les implications dépassent largement les parois.

Le Kurdistan, c’est la carte postale tragique : montagnes accidentées, conflits sans fin, guérillas en treillis. Mais à Erbil, une autre résistance s’organise en silence. Ici, pas de slogans ni de pancartes, mais des chaussons et des baudriers. Pas de barricades, mais des falaises à franchir : la révolution se fait discrète, verticale, et à majorité féminine.
L’escalade au Kurdistan : la révolte en chaussons
Grimper, dans une société où les femmes sont priées de rester à l’horizontale – au sens figuré, bien sûr –, c’est déjà franchir une frontière invisible. Sur les parois du mont Safeen, chaque ascension prend des airs de défi discret aux regards obliques et aux traditions qui plombent parfois plus lourd que la gravité.
Parmi ces rebelles discrètes, Mina Ayad, 29 ans, a longtemps porté seule sa corde comme une drôle de bannière. Après une brève pause pour reprendre souffle (et confiance), Mina est revenue sur la roche, entêtée mais sereine, prête à entraîner avec elle celles qui n’osaient pas encore y croire.
À Erbil on assume le statut d’outsider avec la malice de ceux qui savent qu’ils n’ont rien à perdre, tout à gagner.
Aujourd’hui, elle grimpe régulièrement avec Hedaya Azad, 25 ans, tombée dans l’escalade comme on tombe amoureuse, par hasard mais profondément, lors d’une sortie improvisée en 2024 à Music Valley. Depuis cette rencontre, elles passent quatre jours par semaine sur les parois de Safeen, apprenant à devenir monitrices pour que cette émancipation verticale ne soit pas qu’un accident de parcours mais une voie durable partagée.
Leur révolte n’est ni bruyante ni provocatrice, elle est simplement tenace. Mina et Hedaya grimpent pour affirmer tranquillement, mais fermement, que leur place se trouve au-dessus, et qu’elles n’ont pas besoin de crier pour être entendues.
Le mont Safeen : le Kurdistan prend de la hauteur (et c’est pas trop tôt)
À quelques kilomètres d’Erbil, le mont Safeen pointe ses 1900 mètres avec la nonchalance tranquille d’un sommet qui n’a rien à prouver. Pourtant, depuis peu, cette montagne longtemps oubliée est devenue le terrain de jeu favori de jeunes grimpeurs bien décidés à bousculer les clichés qui collent à leurs chaussons. Une quinzaine de voies y ont fleuri, du 4c douillet au 7b+ un peu teigneux, autant dire qu’ici, chacun peut trouver son plaisir – ou sa limite.
Si, dès 2010, quelques expats pionniers avaient déjà tâté timidement de la perceuse au site voisin de Rabin Boya, c’est bien la récente « Music Valley » qui fait aujourd’hui vibrer la corde féminine à Erbil. Chaque semaine, Mina, Hedaya et leur joyeuse bande investissent cette vallée devenue sans le vouloir le symbole d’une émancipation à la fois tranquille et irrésistible.
Pour les femmes, même cette forme d’ascension reste empreinte d’une forte dimension contestataire
Certes, côté sud, Souleimaniyeh continue de jouer la grande sœur agaçante avec ses falaises bien connues à Hazar Merd, un genre de Fontainebleau kurde. Mais loin d’en faire un complexe, à Erbil on assume le statut d’outsider avec la malice de ceux qui savent qu’ils n’ont rien à perdre, tout à gagner.
De son côté, la KMCF (Kurdistan Mountaineering and Climbing Federation), née en 2006 mais longtemps restée endormie, semble avoir finalement décidé de muscler son jeu. Depuis 2022, elle accélère la cadence : formations régulières, escalade sur rocher et glace, secours en montagne… Bref, elle met enfin les moyens là où il faut. De quoi permettre à Erbil de grimper au niveau de sa voisine, voire de la dépasser avec un sourire en coin.
L’ascension sociale : le 9a des conventions kurdes
L’escalade pourrait sembler être, au premier abord, un sport de pure liberté : une paire de chaussons, de la magnésie et un horizon vertical suffiraient à dépasser toutes les frontières. La réalité kurde est cependant plus complexe. Pour les femmes, le simple geste de s’accrocher à une corde revêt ici un caractère subversif. Beaucoup de familles hésitent encore à autoriser leurs filles à grimper, moins par peur d’un accident que par crainte d’un bouleversement silencieux des normes établies. L’altitude, avant même d’être physique, est avant tout symbolique.
Zhino Rafiq, alpiniste venue de Souleimaniyeh, le résumait simplement en 2022 lors de l’inauguration de la première via ferrata d’Irak à Rawanduz : « Quand tu montes, tu ne grimpes pas seulement la roche, tu affrontes aussi le regard des autres » (Rudaw, juillet 2022). Ce regard, souvent chargé de jugements implicites, constitue l’un des premiers obstacles à franchir.
La grimpe existe, elle est bien là, et il va falloir s’y faire.
Le succès grandissant de cette via ferrata, plus accessible et collective que la grimpe traditionnelle, révèle pourtant une appétence certaine pour la verticalité dans le quotidien des Kurdes. Mais pour les femmes, même cette forme d’ascension reste empreinte d’une forte dimension contestataire. Gravir devient un acte politique discret mais nécessaire, une grimpe sociale sans topo, où chaque mètre gagné compte.
.
Le crux économique
Sur le papier, l’escalade kurde est un beau projet de société : des falaises à équiper partout, des grimpeuses motivées, une Fédération enfin réveillée. Mais le papier ne tient pas bien longtemps sur une paroi mal équipée. Ici, chaque spit posé coûte une petite fortune, chaque relais se négocie avec un banquier imaginaire, plutôt du genre frileux dans un pays économiquement toujours instable.
En attendant, comme souvent, la débrouille fait des miracles. À Souleimaniyeh, une salle d’escalade flambant neuve, financée par des dons locaux, attire déjà une foule d’accros au vertical. Erbil regarde cette salle avec l’envie mal dissimulée du petit frère qui rêve de jouer dans la cour des grands. Faute de murs flamboyants, on s’entraîne sur celui du parc Peshmerga, où chaque séance prend des airs de manif pacifique : la grimpe existe, elle est bien là, et il va falloir s’y faire.
« L’escalade, c’est peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver, résume simplement Hedaya. Ça donne envie d’aller plus haut. » Derrière cette phrase toute simple, c’est toute une génération kurde longtemps collée au sol qui découvre enfin comment parler le langage de la hauteur.