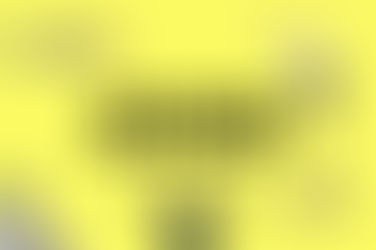Everest sous surveillance : les drones dans la zone de la mort
- Pierre-Gaël Pasquiou

- 27 mars 2025
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 avr. 2025
En 2024, un drone a franchi pour la première fois la barre des 8 000 mètres sur l’Everest. Une prouesse technologique dans la « zone de la mort », qui interroge moins sur ce sommet — déjà transformé en parc à thème vertical — que sur ce qu’elle autorise ailleurs. Car quand l’optimisation devient une évidence, c’est le contrat même de la montagne qui bascule. Et ce n’était qu’un début. Ce printemps, le gouvernement népalais pousse pour que ces engins deviennent partie intégrante de la logistique himalayenne. L’avenir des drones en haute altitude se joue là, maintenant, sur les pentes du toit du monde — entre efficacité assumée et inquiétude contenue.

Une première dans la zone de la mort
Ils filment là où les corps ne tiennent plus debout, là où les guides hésitent à monter, là où l’air s’effondre sous la pression. En mai 2024, un drone civil a dépassé les 8 300 mètres sur les pentes de l’Everest. L’engin, un DJI FlyCart 30 modifié pour résister aux températures extrêmes et à la pression atmosphérique délirante de cette zone, a été lancé depuis le camp de base avancé à 6 100 mètres, par une équipe népalaise en partenariat avec DJI, géant mondial du drone, et la société locale Airlift.
Une fenêtre météo parfaite, des rotors qui tournent deux fois plus vite qu’en plaine, un survol complet de plusieurs zones critiques, des images HD, et retour à l’envoyeur sans casse : le test est concluant. Techniquement, c’est une première. Symboliquement, c’est un pas vers autre chose.
L’Everest, déjà rationalisé
L’objectif était clair : montrer qu’un drone peut opérer là où les hélicoptères échouent. Dans une montagne saturée, devenue vitrine touristique et laboratoire d’extrême, cette démonstration de force tombe presque sous le sens. Ce n’est plus un exploit. C’est une suite logique. L’Everest, déjà cartographié, sécurisé, marchandisé, est devenu le candidat idéal pour accueillir ce type d’innovation. Et il faut bien le reconnaître : la technologie ici ne fait que s’insérer dans un paysage déjà rationnalisé jusqu’à l’absurde.
Une efficacité logistique indéniable
Depuis plusieurs années, les autorités népalaises s’inquiètent de l’état du toit du monde. Chaque printemps, des centaines de grimpeurs — souvent très encadrés — s’y entassent par vagues. Et la montagne, elle, encaisse : tentes abandonnées, bouteilles d’oxygène vides, cordes fixes oubliées, déchets plastiques figés dans la glace.
Lors des dernières campagnes de nettoyage, près de 11 tonnes ont été extraites. Les drones, dans ce contexte, permettent de cibler les zones les plus critiques, d’éviter les fouilles à l’aveugle, de planifier des expéditions de nettoyage plus efficaces.
Ils peuvent aussi repérer des corps. Certains sont là depuis 1996. Figés, oubliés, puis soudain retrouvés. À mesure que la montagne se numérise, même les morts finissent par réintégrer le flux d’information. Ce qui, autrefois, échappait à toute mesure est désormais localisable. Coordonnée. Comptabilisé.
Soulager les sherpas, ou les surveiller ?
Parmi les justifications avancées, celle-ci revient souvent : les drones permettraient de soulager les sherpas. Pas les grimpeurs, mais ceux qui rendent leur ascension possible. Ce sont eux qui montent l’oxygène, installent les camps, fixent les cordes, redescendent les bouteilles vides, parfois les cadavres. Ce sont eux qui prennent les risques, pas pour un exploit personnel, mais pour gagner leur vie. Sur l’Everest, le danger n’est pas un choix partagé. Certains grimpent pour se dépasser. D’autres pour payer le riz. Et tous affrontent le même vide.
Oui, un drone peut alléger certaines charges. Mais il ne redistribue rien. Il ne rééquilibre pas les rôles. Il soulage ponctuellement, sans jamais toucher au modèle économique qui repose sur une main-d’œuvre invisible et exposée. Le drone n’est pas un remède. Il est une rustine.
Et encore faut-il qu’il tienne. L’engin vole, oui. Mais à la moindre bourrasque, il reste cloué. Il transporte du matériel, mais pas grand-chose. Il soulage, mais n’inverse rien. C’est une amélioration marginale, pas une révolution. Un gadget sous conditions, pas une solution de fond.
Et c’est là que l’ambiguïté devient inquiétude. Car ce qui ne fonctionne pas toujours pour alléger, fonctionne très bien pour surveiller. Filmer. Suivre. Localiser. Organiser. On imagine mal un drone porter des caisses tous les jours à 8 000 mètres. On l’imagine très bien transmettre des coordonnées GPS toutes les dix secondes.
De l’assistance au contrôle
Ce que les autorités entrevoient déjà, c’est une montée en puissance du drone comme outil de gestion. Observation des files d’attente, surveillance des comportements à risque, suivi GPS des grimpeurs, anticipation des goulets d’étranglement : la montagne devient un circuit à modéliser.
À terme, chaque permis d’ascension pourrait être couplé à un traceur. Sur l’Everest, le parcours est déjà figé. Ailleurs, ce type de surveillance pourrait rogner ce qu’il reste d’imprévu. Big Brother ne regarde plus la télé, il balise les itinéraires.
Ce n’est pas l’Everest le problème. C’est ce qu’il annonce
C’est là que l’Everest, une fois de plus, joue son rôle de laboratoire. Ce drone qui plane à 8 300 mètres ne scandalise plus personne. Il ne transgresse rien, parce qu’il n’y a plus rien à transgresser. Le sommet est déjà standardisé, déjà désacralisé. On y monte à la queue leu leu, on y prend des selfies, on y meurt parfois sans que personne ne le remarque.
Dans ce contexte, cartographier les déchets ou rationaliser les flux n’est pas une hérésie : c’est presque une forme d’hygiène. Mais c’est précisément là que s’ouvre la vraie faille. Ce qui passe ici, sur cette montagne devenue produit, pourrait demain s’imposer ailleurs. Dans des espaces moins domestiqués, moins visibles, encore porteurs d’une certaine idée du silence, du risque, de la liberté.
L’alpinisme sous algorithme ?
L’expérimentation de 2024 a été saluée un peu partout. National Geographic y voit une avancée écologique. Outside Magazine parle d’un tournant logistique pour l’Himalaya. Mais ce tournant ouvre des portes que l’on ne referme pas. Drones sur le K2. Surveillance du Lhotse. Missions de cartographie dans l’Himalaya indien. Usages touristiques, militaires, commerciaux. À mesure que les sommets deviennent des dashboards, on perd le vertige.
L’économie de la mesure, ou le refus de l’optimisation totale
C’est ici que Gilles Rotillon, économiste de l’environnement, nous tend une corde. Dans La leçon d’Aristote, il rappelle que pour le philosophe grec, l’économie n’était pas une science de l’accumulation, mais une pratique de la mesure. Penser la limite, c’était déjà penser la liberté. Ce que la montagne rappelait, jusqu’ici, c’est qu’il existait encore des lieux où l’incertitude avait droit de cité. Là où la Formule 1 réforme chaque accident, l’alpinisme engageait un contrat moral plus ancien, plus brut, où l’on acceptait que le tragique ne se résout pas toujours dans un tableau Excel.
Mais avec les drones, ce contrat se recompose. Ce n’est plus l’alpiniste qui affronte le vide. C’est l’algorithme qui le mesure. La montagne était un miroir. Elle devient un écran. Et bientôt, peut-être, un tableau de bord.